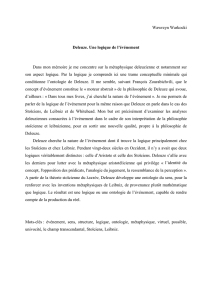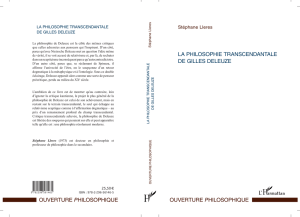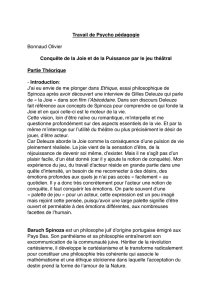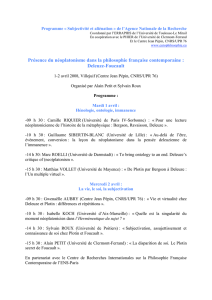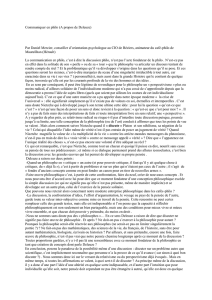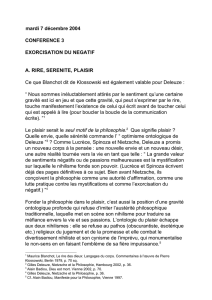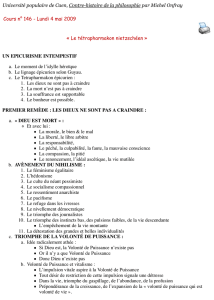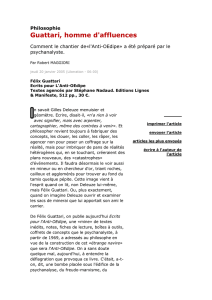PDF sample - Hawaii Military Wives


« RÉFLEXIONS FAITES »
Pratique et Théorie
« Réflexions faites » part de la conviction que la pratique et la théorie ont toujours besoin l’une de l’autre, aussi bien en littérature
qu’en d’autres domaines. La réflexion ne tue pas la création, elle la prépare, la renforce, la relance. Refusant les cloisonnements et les
ghettos, cette collection est ouverte à tous les champs de la vie artistique et des sciences humaines.
Cet ouvrage est publié
avec l’aide de la Communauté Française de Belgique.
Photo de couverture : © Hélène Bamberger
© Les Impressions Nouvelles – 2011
www.lesimpressionsnouvelles.com
info@lesimpressionsnouvelles.com

Collectif – Sous la direction d’Adnen Jdey
LES STYLES DE DELEUZE
Esthétique et philosophie
LES IMPRESSIONS NOUVELLES

ADNEN JDEY
INTRODUCTION
« Le temps approche où il ne sera guère possible d’écrire un livre de philosophie comme on en fait depuis si longtemps : Ah ! le
vieux style… La recherche de nouveaux moyens d’expression philosophiques fut inaugurée par Nietzsche, et doit
être aujourd’hui poursuivie en rapport avec le renouvellement de certains autres arts, comme le théâtre et le cinéma. »
Gilles Deleuze
Différence et répétition, 1969
« Le baptême du concept sollicite un goût proprement philosophique qui procède avec violence ou avec insinuation, et qui
constitue dans la langue une langue de la philosophie, non seulement un vocabulaire, mais une syntaxe atteignant au sublime ou
à une grande beauté. Or, quoique datés, signés et baptisés, les concepts ont leur manière de ne pas mourir, et pourtant sont
soumis à des contraintes de renouvellement, de remplacement, de mutation qui donnent à la philosophie une histoire et aussi une
géographie agitées, dont chaque moment, chaque lieu se conservent, mais dans le temps, et passent, mais en dehors du temps. »
Gilles Deleuze & Félix Guattari
Qu’est-ce que la philosophie ?, 1991
Disons-le d’emblée. Rares sont les philosophies qui intègrent la question du style à une démarche
strictement philosophique. Plus rares encore sont les philosophies qui ressaisissent dans le « problème
d’écrire » les linéaments d’une réflexion apte à dire ce que fait le concept. La pensée de Gilles
Deleuze, peut-être plus qu’une autre, se prête sans doute à cette démarche croisée, ne justifiant en
contrepoint la nécessité d’une stylistique de la pensée qu’à ce qu’elle remet en jeu sous les plis d’une
pensée du style. Les raisons n’en tiennent pas seulement à la manière bien particulière qu’avait
Deleuze de nouer le rapport constructif et relativement complexe avec les modes d’énonciation
conceptuels ou non-conceptuels de la philosophie ; elles concernent surtout la spécificité même de
l’acte de création qui, bien que variant selon qu’il s’actualise dans les arts, les sciences ou les
philosophies, n’en exige pas moins que son individuation soit signée. Si cet aspect, peu étudié jusqu’à
aujourd’hui de l’œuvre de Deleuze, pourrait avoir une véritable portée dans la réévaluation de sa
pensée, c’est sans doute en ce qu’il contribue à nouveaux frais à la compréhension de la voix qui fut la
sienne dans le débat philosophique de la fin du siècle dernier. Néanmoins, dans ce choix, on ne verra
pas une insidieuse tentative de tirer le travail de Deleuze du côté d’on ne sait quelle littérarisation de
la philosophie. Bien plutôt, au croisement de multiples champs où la question du style vient se nouer,
c’est tout un maniérisme du concept qui trouve son volume.
De l’histoire de la philosophie, pratiquée dès lors comme collage pictural et assortie de ses
portraits noétiques expressionnistes, ou de l’empirisme supérieur hissé à une espèce très particulière
de « roman policier » et de « science-fiction », les décrochages stylistiques de la pensée de Deleuze
nous déportent vers les vitesses virtuelles du concept et ses ralentissements teintés d’affect, en passant
par le maniérisme des intensités en leurs contrepoints artistiques en compagnie de Leibniz, Bacon ou
Boulez, et par la pragmatique de l’expression et la cartographie intensive de la syntaxe qui viennent
relancer en littérature les procédés de minoration impersonnelle à la limite du « non-style ». Qu’on ne
s’y méprenne pas toutefois : si la diversité de ces préoccupations philosophiques et esthétiques
fait qu’il paraît difficile, à première vue, de dégager un fil conducteur autour duquel devait s’organiser
une stylistique chez Deleuze, on aurait tort de croire celle-ci confuse dans ses objectifs. Plus qu’une

systématisation, en effet, c’est une remise en question des continuités discursives que produit la
pensée deleuzienne, de Différence et répétition à Qu’est-ce que la philosophie ? et Critique et
clinique, se déployant sur plus d’un plan à la fois, passant avec le même bonheur de Spinoza à
Leibniz, de Proust à Carmelo Bene, de Nietzsche à Kafka. Ce faisceau de gestes et de relais théoriques
converge vers une même direction : la nécessité de désenclaver le concept et la pratique du style des
poncifs où il s’est embourbé, pour le penser en retour sous le signe d’une philosophie pratique. Car,
non seulement le style demande à être appréhendé dans la singularité irréductible de ses
modes d’énonciation noétiques et esthétiques ; mais il exige également qu’il soit examiné à l’aune des
fonctions proprement pratiques et opératoires qui lui sont à chaque fois assignées. Peut-être est-ce là
un des enjeux les plus troublants de la question chez Deleuze, et ce qui peut justifier qu’on maintienne
l’idée des styles de son œuvre.
Si l’interrogation sur la théorie et la pratique du style se met ici au pluriel, nous offrant d’un
même geste et une ouverture précieuse sur la manière dont la pensée de Deleuze procède et une
possibilité de savoir en quel sens le philosophe sait, lui aussi, ce que parler veut dire, elle n’en appelle
pas moins en revanche à une lecture nuancée et non réductrice de ses textes, qu’on aborde souvent en
pensant savoir par avance ce qu’ils ont à nous dire. Entre théorie et pratique du style, ou plutôt dans
l’oscillation malaisée qui soumettrait chacune aux exigences de l’autre, le propos du présent ouvrage
est de faire jouer les perspectives, examiner les prémisses de cette articulation et en peser
sérieusement les attendus. Et ce, en lisant deux fois Deleuze.
Que fait donc le style en philosophie, le style à la philosophie ? Le premier moment de lecture,
alliant réflexions et études de cas, propose de relever quelques stratégies énonciatives de Deleuze et
d’en mesurer aussi bien l’originalité que les paradoxes. Fonctionnant en accords discordants,
produisant par coupures, pliages et raccords ce qui, non seulement n’appartient à aucun des codes
constitués de la machine textuelle, mais se refuse au cloisonnement des formes d’expression, les
diverses facettes du seul style pratiqué par Deleuze se prêtent pourtant mal à l’ordinaire sémantique
conceptuelle. Elles seront ici examinées du triple point de vue de leurs modes de fonctionnement
discursif, de la fonction argumentative qu’elles y assument, et de leur implication dans la pédagogie
du concept.
Si Deleuze conserve parfois le sens daté du style comme façon particulière de dire les mêmes
choses, détachant ainsi le fond et la forme, il faut convenir que l’une des originalités de sa démarche
en histoire de la philosophie ne tient pas tant aux distorsions d’une philologie hasardeuse qu’au refus
du commentaire, s’échappant du sillage auctorial et favorisant plutôt l’intervention créatrice dans les
systèmes. Et si c’est d’un seul et même mouvement qu’il relit les philosophes en « commentateur »,
ou reformule un problème mal posé, ou encore crée ses propres concepts, la fonction performative
qu’il confie chaque fois au style est éminemment philosophique ; elle ne se conquiert que dans l’état
d’une pensée hors d’elle-même, qui n’est puissante qu’au point extrême de son impuissance. La
contextualisation par Philippe Mengue de la logique qui fédère cette variation, ne la situe pas
seulement dans la différence des styles deleuziens – différence bien sensible depuis Empirisme et
subjectivité jusqu’aux derniers textes, en passant bien sûr par le très polémique Anti-Œdipe de 1972 –,
mais aussi dans les variations à l’intérieur de l’unité d’un même style, dans les modulations que
Deleuze introduit dans sa propre prose philosophique. On y verra aussi que, dans la manière dont il
réoriente aussi bien la pratique que la conception de la philosophie, mainte lumière surgit des portraits
noétiques et machiniques que Deleuze enfile en miroir, et comment cela produit une stylistique qui
effeuille tous les plans qu’elle recoupe comme autant de pièces définitives dont les effets de sens ne
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
1
/
24
100%