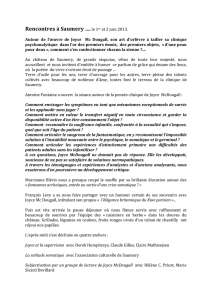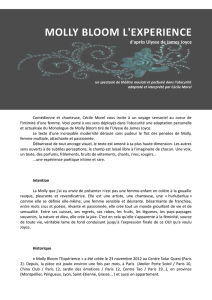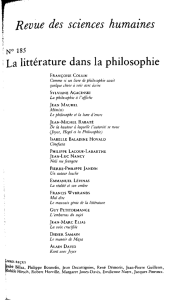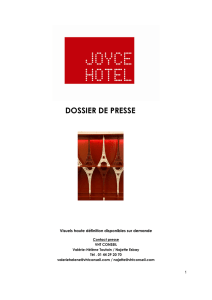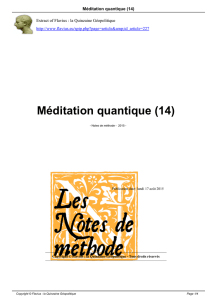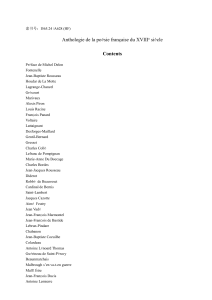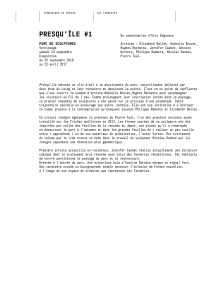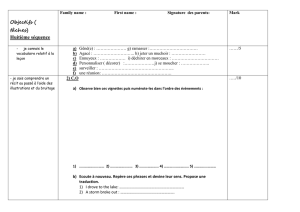revue de presse-Finnegans Wake-Joyce

REVUE DE PRESSE
17 janvier > 19 février 2012
FINNEGANS WAKE - Chap. 1
D’erre rive en rêvière
d’après Finnegans Wake de James Joyce
traduction française Philippe Lavergne (Ed. Gallimard, 1982) !
mise en scène Antoine Caubet
(Théâtre Cazaril, cie associée au Théâtre de l’Aquarium)
avec Sharif Andoura
lumière Antoine Caubet, Pascal Joris,
son Valérie Bajcsa,
composition Louis-Marie Seveno pour le violon,
film Hervé Bellamy, accessoires Cécile Cholet,
costumes Cidalia Da Costa assistée d’Anne Yarmola
régie générale et plateau Yunick Vaimatapako
régie lumière Pascal Joris
remerciements pour le spectacle : Daniel Ferrer, Ivan Boivin, Gérard Rocher du CFA du Spectacle
Vivant et de l’Audiovisuel et CFPTS de Bagnolet, Lydia Sevette, Jean- Marc Valay (The Dubliners)
et pour leur soutien : André Topia et Daniel Ferrer ; Jo Attié, Jacques Aubert, Judith Miller,
François Regnault, membres de l’École de la Cause freudienne, l’office du Tourisme
Irlandais, l’Ambassade d’Irlande en France, le Centre culturel Irlandais, Gaël Staunton pour le Irish
Club, la Fondation Pierre Bergé - Yves Saint-Laurent, le Centre culturel Italien
production Théâtre Cazaril, Théâtre de l’Aquarium, l’Apostrophe-scène nationale de Cergy-Pontoise
et du Val d’Oise, Arcadi
> contact presse
Catherine Guizard. 01 48 40 97 88 & 06 60 43 21 13
LA STRADA & CIES
Pavillon fond de cour
7 rue des Chalets
93230 Romainville

James Joyce ! N’ayez pas de complexes, si vous n’avez pas lu FINNEGANS WAKE, que James Joyce a
mis 17 ans à écrire, après avoir assisté à l’adaptation théâtrale de son premier chapitre (à partir de la
remarquable traduction de Philippe LAVERGNE de l’ouvrage qui comporte 900 pages) au Théâtre de
l’Aquarium, vous pourrez dire : Je connais James Joyce, je l’ai rencontré.
Si la rivière à portée d’écran sur la scène pouvait cligner de l’oeil et parler, nul doute qu’elle prendrait
une sorte de forme féminine, captivée par la voix d’un homme, capable de faire bruire aussi bien le
soleil des forêts que le tremblement de terre des êtres qui la parcourent.
En exergue à la présentation du spectacle, Antoine Caubet un metteur scène habité, rappelle la
phrase de NOUGARO : Et tu verras tous ceux qu’on croyait décédés reprendre souffle et vie dans la
chair de ma voix jusqu’à la fin des mondes.
En l’occurrence, le décédé c’est Finnegans lui même, un maçon en état d’ébriété en train de regarder
du haut de son échelle, la rivière qui traverse la ville de Dublin avant de se jeter dans la mer. Voici
pour l’anecdote, mais à vrai dire, même s’il s’agit d’un éblouissement, il n’est pas besoin de
s’harnacher de repères, l’attention requise fait appel à tous ces sens furtifs qui entrainent la voix et
l’écoule, un peu comme le bruit d’une source ou même ce qui suinte des murs, la parole d’une main
prête à s’envoler au-dessus d’une rame.
C’est que les mots ici ne prennent leur sens que par la respiration, la transpiration du corps, ils ne
sont plus abstraits, ils s‘incarnent chez un homme, de la même façon qu’un paysage est capable de
réfléchir nos états d’âme. Comme il existe des bains de boue pour purifier la peau, il faut croire que la
langue de Joyce, colorée, sensuelle, nous convie à un bain de mots rendus à leur origine, celle du jeu
et du plaisir, celle des surprises.
Et la voix de Sharif Andoura s’étonne sans cesse, tout en restant égale, elle prolonge les éclats
parsemés d’une sorte de mosaïque, ici une aire de jeux pour les enfants, un grand bac à sable
recouvert d’un compost de brisures de liège aux lueurs de paille.
Dire que Joyce invente une langue, c’est lui rendre hommage, et pourtant cette langue qui a
découragé quelques lecteurs trop cartésiens sans doute, elle est palpable, elle est délivrance
orientant la tache sur le net, elle est boule de neige de mots qui ont envie de fusionner répondant aux
caprices de nos corps qui soupirent parfois cernés par la grammaire et la logique.
IL faudrait une langue du pied, une langue des orteils, une langue du cuir chevelu et ainsi de suite…Il
faudrait une fête de mots en état d’ébriété, en état de suspension, vive la langue libre !
Mais la liberté demande beaucoup de travail. La souplesse dont font preuve Sharif Andoura et le
metteur en scène, en réussissant à filtrer l’esprit à la fois cossu et espiègle de Joyce, tient de
l’exploit.
Sans doute ont-ils conscience d’exploiter une mine d’or et de faire partie des artistes alchimistes de
notre humanité, humblement nôtres puisque sans le savoir, nous sommes tous peu ou prou des
alchimistes en herbe en remuant la terre avec nos langues.
A la fin du spectacle, une spectatrice est venue saluer l’acteur, elle avait besoin de lui dire qu’elle
avait assisté déjà plusieurs fois à FINNEGANS WAKE et qu’elle lui envoyait du monde. Je me range à
ses côtés, pour signer qu’il s’agit d’une des meilleures créations de la saison.
Chapeau bas à toute l’équipe !
Evelyne Trân - THEATRE AU VENT - 29 janvier 2012

Antoine Caubet met en scène le monument littéraire de Joyce et réussit, grâce au génie du
comédien Sharif Andoura, à rendre accessible ce texte extraordinaire, réputé illisible.
« Que l’huile bouillante et le miel sauvage me tombent dessus si je peux ne serai-ce que
comprendre un mot de ce turc en finnois dans ce foutu patois que tu me rotterdames ! ».
Voilà sans doute le meilleur résumé de l’impression qui saisit le spectateur, pétrifié par la
logorrhée que débite Sharif Andoura, magistral comédien, auquel Antoine Caubet a confié la
gageure de mémoriser, de dire et d’interpréter la langue inouïe de Joyce, remarquablement
traduite par Philippe Lavergne : huile bouillante de la torture imposée à l’esprit qui s’essaie
à comprendre, et miel sauvage d’une expérience inédite, lorsque l’entendement accepte
enfin le secours des sens pour se repérer dans les entrelacs sémantiques, les
circonvolutions référentielles, les crases poétiques et les audaces linguistiques de ce texte
incroyable, auquel le théâtre sert de révélateur. Sharif Andoura est à la fois pythie, maniant
une langue riche de toutes les cultures et faite des parlers du monde entier (de l’hébreu et
du grec à l’argot des barrières), et herméneute, jouant de son corps, de ses postures et des
modulations de sa voix pour rendre plus explicite le foisonnement anecdotique et
l’inventivité littéraire de sa partition. Fort du conseil que donnait Joyce pour répondre à ceux
qui accusaient l’impénétrabilité de son texte (« Si vous ne comprenez pas, lisez à voix haute,
ça ira beaucoup mieux. »), Antoine Caubet a patiemment attendu que l’œuvre de Joyce
tombe dans le domaine public pour en offrir l’adaptation théâtrale au public.
Une expérience esthétique rare et jubilatoire
Ce cadeau touche le spectateur, autant que la prouesse de la mise en scène et du jeu
provoquent son admiration. On embarque pour cette balade sur la Liffey, fleuve dublinois qui
charrie les pépites de ce texte aurifère (
« D’erre rive en rêvière »
, dit le sous-titre du
spectacle), avec l’impression que cette invitation est autant un don merveilleux que la
marque de l’infini respect que portent Caubet et les siens au public, en les croyant capables
et dignes de les accompagner dans le plaisir de ce périple. Les très belles images en noir et
blanc du film d’Hervé Bellamy montrent les berges d’une rivière sur laquelle on avance
lentement. Pendant ce temps, la marionnette qui figure le maçon Finnegan, tombé de son
échelle pour s’être essayé à jouir en plein ciel, va du tapis de copeaux qui recouvre le sol
jusqu’aux cintres, comme un compagnon malicieux qui se jouerait du récit de ses propres
errements éthyliques et masturbatoires. Sharif Andoura fait preuve, en s’emparant avec une
aisance sidérante et éblouissante de ce texte que chacun de ses gestes contribue à dire en
même temps que sa voix, d’un talent qui confine au génie. Rares sont les interprètes de cet
acabit ; rares sont les spectacles de cette qualité ; rares sont les théâtres qui, comme
l’Aquarium, osent accueillir ce genre de
« pari fou »
, selon les mots de François Rancillac,
son directeur. Force est de saluer toutes ces audaces, et d’admettre que le théâtre est un
art d’excellence lorsqu’il offre l’occasion d’une telle expérience esthétique.
Catherine Robert – février 2012

Joyce-Lacan, rencontre sur les planches
« Joyce était-il fou ? Par quoi ses écrits lui ont-ils été inspirés ? » Ces questions posées par le
psychanalyste Jacques Lacan, admiratif de l'écrivain irlandais, Antoine Caubet leur donne vie
aujourd'hui avec brio sur le plateau du Théâtre de l'Aquarium.
Le metteur en scène adapte le premier chapitre, sous-titré « D'erre rive en rêvière », du dernier chef-
d'oeuvre de l'Irlandais James Joyce : Finnegans Wake, histoire d'un maçon ivre qui se masturbe au
sommet d'une échelle en pensant à sa femme avant de « titubéguer » et de tomber à terre. L'homme
Finnegan mort, mis en bière, son âme est ressuscitée, par la grâce du whiskey et de la Guiness
déversés dans son cercueil. Il plane désormais sur Dublin. Avec l'aide du remarquable comédien
Sharif Andoura, acteur inépuisable, le spectacle déroule en une heure et vingt minutes, sans
anicroches ni difficulté, en aisance, la logorrhée mystique, magique et mystérieuse de Joyce. Suivant
les indications d'Antoine Caubet : « Joyce invente, met en oeuvre et livre une guerre au langage. Il
détruit la langue, la langue anglaise, sa langue maternelle, et il en invente une autre qui va chercher
latéralement, horizontalement, puis verticalement toutes les langues en Europe. […] À partir de là, il
réécrit une histoire du monde, à travers des éléments très banals en effet, une histoire qui dit
l'entièreté des composantes inconscientes qui forment nos vies. Ce n'est pas fermé, c'est secret. »
Ce secret a fasciné Jacques Lacan, héraut extravagant et charismatique de la psychanalyse post-
freudienne des années 1970 (lire Philosophie
magazine
, numéro 52). Star du structuralisme, esthète
dont le divan est couru du Tout-Paris, gourou d'une génération professant en veste violette et
manteau d'astrakan ses leçons inspirées à la Sorbonne, Jacques Lacan lit Joyce par l'entremise d'un
universitaire. Alors engagé sur les chemins obscurs d'une recherche d'absolu, entendant découvrir
un langage qui permette de traduire l'indicible, l'inconscient et tout le non-dit de la psychanalyse,
Lacan trouve avec Joyce l'expression de la «
splendeur de l'être
», une épiphanie, qu'il appelle,
malicieux, le «
sinthome
», soit la «
soudaine manifestation spirituelle se traduisant par la vulgarité
de la parole ou du geste, ou bien par quelque phrase mémorable de l'esprit même
».
Le sinthome – ou symptôme, ou synthomme –, sorte de concaténation verbale, prend tantôt la forme
d'un calembour tantôt celle d'un allographe ou d'un mot-valise, bref, jeu d'un mot que l'on aurait pu
croire intraduisible, mais que la puissance du théâtre finalement exprime,
ascène
– pour mimer Joyce
et Lacan – et rend audible. Il en révèle les richesses. Car la mise en scène dépouillée d'Antoine
Caubet, faite d'un sol de sable, fondation mouvante et souple, symbole d'origine, d'une marionnette
représentant Finnegan, l'ouvrier maçon, miroir du comédien et interlocuteur de lui-même, et d'une
toile projetant un horizon vidéo permettant au discours de l’inconscient de s'abîmer, rend grâce à la
richesse imaginaire de Joyce. Elle en saisit la fantaisie, que Lacan, sans esprit de sérieux, n'avait pas
manqué, lui qui concluait dans une publication des actes d'un colloque consacré au Saint-homme :
«
Joyce le Symptôme à entendre comme Jésus-la-Caille : c'est son nom. Pouvait-on s'attendre à
autre chose d'emmoi : je nomme. Que ça fasse jeune homme est une retombée d'où je ne veux retirer
qu'une seule chose. C'est que nous sommes z'hommes. LOM : en français ça dit bien ce que ça veut
dire. Il suffit de l'écrire phonétiquement : ça le faunétique (faun…), à sa mesure : l'eaubscène. Écrivez
ça eaub… pour rappeler que le beau n'est pas autre chose.
» Qui veut plonger dans Joyce et sa beauté
obscène ira se mouiller à l'Aquarium, et ne sera pas déçu par l'audacieux travail d'Antoine Caubet et
de Sharif Andoura. Ah, les sainthomes…
Cédric Enjalbert - 30 Janvier 2012

Théâtre. ]oyce enfin
libre sur scène
On se souvient de la « Lettre
du Voyant » de Rimbaud :
«Ça ne veut pas rien dire. »
De 1922 a 1939 James Joyce,
déjà auteur des Gens de Dublin,
de Dedalus et d Ulysse, écrit
Finnegans Wake, oeuvre
qui franchit souvent les limites
de la lisibilité. À HarnetShaw
Weaver, sa mécène, qui lui
reprochait de ne pas même
écrire en anglais (le texte
intègre une cinquantaine
de langues), Joyce répondit
« Oh, ce n’est pas écrit du tout.
Ce n est même pas fait
pour être lu. C’est fait pour
être regardé et entendu »
Ce genre d’indication ne
pouvait que renforcer I’envie
d'Antoine Caubet, metteur en
scène, en 1993, du monologue
de Molly Bloom (extrait
d’Ulysse) et grand lecteur
de Joyce, de se lancer dans
la folle et géniale aventure
de porter au théâtre
Finnegans
Wake.
Pour cela, il fallait
attendre le 1er janvier, date
a laquelle I‘oeuvre de Joyce
tombe dans le domaine public.
Depuis longtemps en effet,
Stephen Joyce, petit-fils de
I’auteur et ayant droit, méprise
les critiques et interdit
tout projet artistique à partir
de I’œuvre. Antoine Caubet
a donc préparé son coup.
II a choisi la traduction de
Philippe Lavergne|l982|,
qu’il a trouvée plus orale que
celle d’André du Bouchet [1962).
II I’a lue a haute voix puis
a demandé à I’entendre. Le
va-et-vient entre jouissance et
agacement, qui avait marqué
sa lecture à voix basse, a cédé
la place à un étonnement sans
cesse renouvelé pour cette
langue qui détruit le langage
en en bouleversant les règles
les plus élémentaires,
ne tenant au sens qu’en
composant des mots-valises
et à la syntaxe qu’en I’oubliant
dans I’envolée des périodes
musicales.
Oralisée, cette langue est
encore écrite mieux,
elle exhibe son écriture
et y trouve (encore Rimbaud!
toute sa vigueur.
Voici donc « Finnegan
le Constructeur, stathouder
de sa main, maçon
des hommes francs », qui
« calculait par multiplicables
aletitude et maltitudejusqu’à
voir se balancer à la lumière
de son Doublin où I’était né »
Sharif Andoura, seul en scène,
donne à voir et à entendre le
premier chapitre de
Finnegans
Wake
ou les grands thèmes
de I’œuvre se mettent en place,
à commencer par I’histoire
de Dublin et de l’Irlande. Il se
place en position de conteur,
parfois d’écrivain. II est au
centre d’une arène. Au fond, un
film montre la femme-rivière
de I’œuvre qui traverse Dublin.
Suspendu et anime, un pantin
d’un mètre trente figure
Finnegan. II apparaît
et disparaît, manipulé par
I’acteur. II fixe la perception
du spectateur. Tout ce
dispositif orchestre la voix
de Shanf Andoura. L’objectif
est simple pour reprendre
le mot de Joyce, nous
« abestourdir à la langue »
Christophe Bident
Janvier 2012 - Mensuel
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%