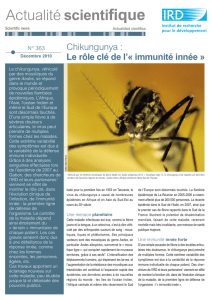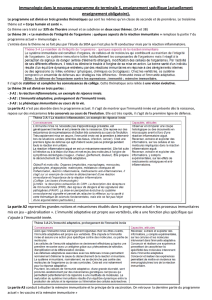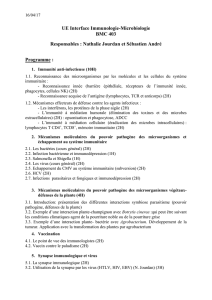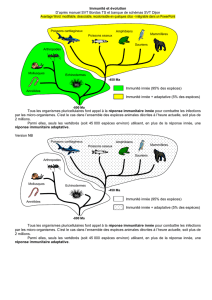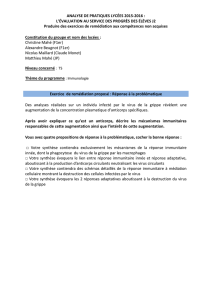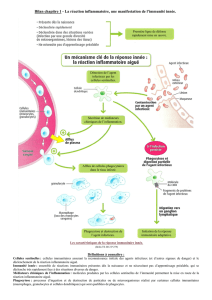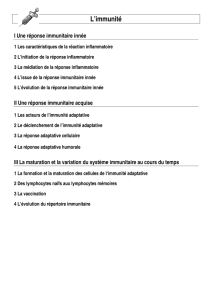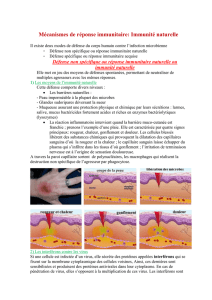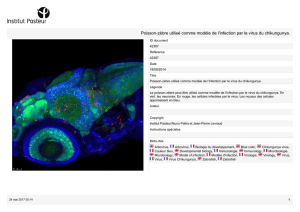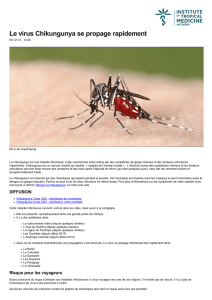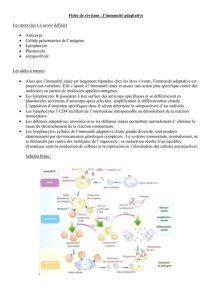chikungunya : le rôle clé de l` immunité innée

Cahiers Santé 20, n° 4, octobre-novembre-décembre 2010
233
Info
CHIKUNGUNYA : LE RÔLE CLÉ
DE L’ IMMUNITÉ INNÉE
Le chikungunya, véhiculé par des moustiques
du genre Aedes, se répand dans le monde et
provoque périodiquement de nouvelles flambées
épidémiques. L’Afrique, l’Asie, l’océan Indien et
même le Sud de l’Europe sont désormais touchés.
D’une simple fièvre à de sévères douleurs articu-
laires, le virus peut prendre de multiples formes
chez les malades. Cette extrême variabilité des
symptômes est due à la variabilité de la défense
immune individuelle. Grâce à des analyses
sanguines effectuées lors de l’épidémie de 2007
au Gabon, des chercheurs de l’IRD et leurs parte-
naires(1) viennent en effet de montrer le rôle
clé, dans l’évolution clinique de l’infection, de
l’immunité innée : la première ligne de défense de
l’organisme. Le contrôle de la maladie dépend
ainsi étroitement du « terrain » immunitaire de
chaque patient. Les cas graves seraient donc dus
à une défaillance de la réponse innée, comme chez
les femmes enceintes, les personnes âgées, etc.
Ces travaux apportent un éclairage nouveau
sur cette maladie, peu étudiée jusque-là et
délaissée des pouvoirs publics.
Isolé pour la première fois en 1953 en
Tanzanie, le virus du chikungunya a causé
de nombreuses épidémies en Afrique et en
Asie du Sud-Est au cours du 20e siècle.
Une menace planétaire
Cette maladie infectieuse est due, comme
la fièvre jaune et la dengue, à un arbovirus,
c’est-à-dire véhiculé par des arthropodes
suceurs de sang : moustiques, tiques et
phlébotomes. Ses principaux vecteurs sont
des moustiques du genre Aedes, en particu-
lier Aedes albopictus, surnommé le « mous-
tique tigre », qui conquiert rapidement de
nouveaux territoires, grâce à ses œufs. L’in-
tensification des déplacements humains,
qui dispersent les larves, et l’augmentation
de la résistance des moustiques aux insec-
ticides ont contribué à l’expansion rapide
des épidémies ces dernières années à de
nouvelles régions du monde : les îles de
l’océan Indien, l’Afrique centrale et même
très récemment le Sud de l’Europe sont
désormais touchés. La flambée épidémique
de La Réunion en 2005-2006 a notamment
affecté plus de 260 000 personnes. La
récente épidémie dans le Sud de l’Italie,
en 2007, ainsi que le premier cas de fièvre
rapporté dans le Sud de la France illustrent
doi : 10.1684/san.2010.0215
le potentiel de dissémination mondiale,
faisant de cette maladie, rarement mortelle
mais très invalidante, une menace de santé
publique majeure.
Une immunité innée forte
D’une simple poussée de fièvre à des
troubles articulaires très douloureux, le
chikungunya peut prendre de multiples
formes. Cette extrême variabilité des symp-
tômes est due à la variabilité de la réponse
immune individuelle de chaque patient.
Des chercheurs de l’IRD et leurs parte-
naires1 viennent en effet de montrer la
fonction clé, dans l’évolution clinique de
la maladie, de la première ligne de défense
de l’organisme : l’« immunité innée ».
En réponse à la présence d’ADN étranger
dans l’organisme, suite à une infection virale,
bactérienne ou parasitaire, ou à la présence
de cellules tumorales, l’organisme active
son système immunitaire. Cette réponse
immune, ou inflammatoire, est consti-
tuée de deux grandes étapes : la défense
non-spécifique, aussi appelée « immunité
innée », qui ne tient pas compte de la
nature du micro-organisme qu’elle combat,
et la réponse spécifique, qui cible l’agent
pathogène dans les cellules infectées.
Chez les malades du chikungunya, la
première étape est très efficace. L’analyse
de près de 70 échantillons sanguins prélevés
au cours de l’épidémie de 2007 à Libreville,
la capitale du Gabon, a en effet révélé la
présence, au cours des quatre premiers
jours de symptômes, d’une quantité élevée
d’interférons, de cytokines et de chimio-
kines
2
, des sortes d’hormones du système
immunitaire. Les premiers jouent un rôle
prédominant dans la défense inflamma-
toire immédiate : ils interfèrent, d’où leur
nom, avec la réplication du virus dans
les cellules de l’hôte et inhibent ainsi ce
dernier de manière très précoce. Les cyto-
kines et les chimiokines, quant à elles, ont
pour fonction d’activer la seconde étape : la
réponse spécifique. Pour cela, ces protéines
1 Ces travaux ont été réalisés en collaboration
avec des chercheurs du Centre International
de Recherches Médicales de Franceville et de
l’université des Sciences de la Santé à Libreville
au Gabon et de l’INSERM.
2
Les interférons, cytokines et chimiokines sont
des protéines produites par les cellules du système
immunitaire.
attirent les cellules immunitaires, appelées
leucocytes, vers chaque site de réplication
du virus et orchestrent le déploiement des
défenses antivirales de l’organisme.
Le contrôle de la maladie dépend ainsi
étroitement du « terrain » immunitaire
de chaque patient. Les cas graves seraient
donc dus à une défaillance du mécanisme
de la réponse innée, comme chez les
femmes enceintes, les personnes âgées ou
encore les malades du sida.
Une maladie extrêmement invalidante
Dès lors apparaîtraient les formes graves
provoquant les raideurs articulaires très
invalidantes dont l’infection tient son
nom : chikungunya signifie la « maladie
de l’homme courbé » en makondé, langue
d’Afrique australe. Ces symptômes durent
en général trois à sept jours, le temps que
les cellules immunitaires fassent leur travail,
mais peuvent aussi devenir chroniques et
persister pendant des mois, voire des années.
Des complications neurologiques et hépati-
ques peuvent également survenir dans les
formes les plus sévères. Aucun traitement
spécifique n’existant à ce jour, la prise en
charge thérapeutique vise uniquement à
soulager ces symptômes, avec des médica-
ments antalgiques et anti-inflammatoires.
Les médecins sont à l’aube de leurs recher-
ches sur la maladie, longtemps délaissée
par les pouvoirs publics. L’équipe de
recherche explore de même le rôle, dans
l’inhibition du pathogène, des cellules
appelées Natural Killer, capables de tuer
directement les cellules infectées. En paral-
lèle, des travaux sont également en cours
sur la modulation de la réponse immu-
nitaire dans les cas de co-infection avec
le virus de la dengue, récemment décou-
verts au Gabon, une nouvelle menace qui
conjugue les deux fléaux.
Fiche d’actualité IRD
N° 363, décembre 2010
Pour en savoir plus :
Éric Leroy
<Eric.leroy@ird.fr>
Référence :
Wauquier N, Becquart Pierre, Nkoghe D, Padilla C,
Ndjoyi-Mbiguino A, Leroy E. The acute phase of
mild Chikungunya virus infection in humans is
associated with strong innate immunity and T CD8
cell activation. Journal of Infectious Diseases 2010.
doi : 10.1093/infdis/jiq006
jlesan00281.indd 233jlesan00281.indd 233 2/24/2011 3:15:30 PM2/24/2011 3:15:30 PM
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.
1
/
1
100%