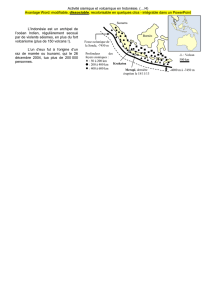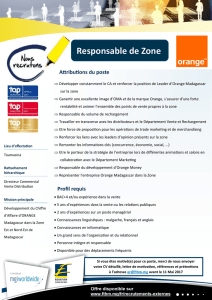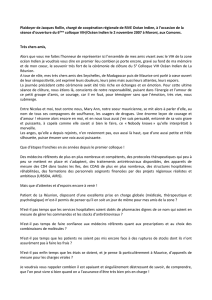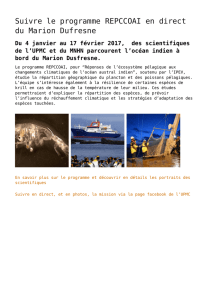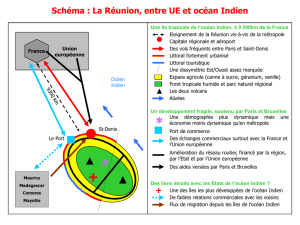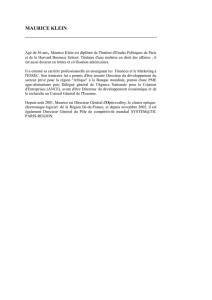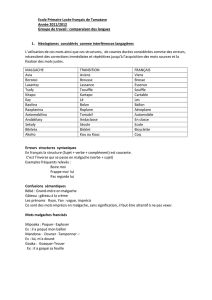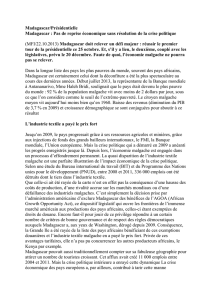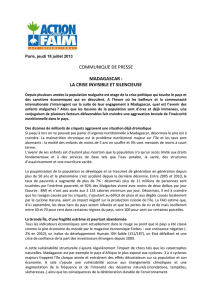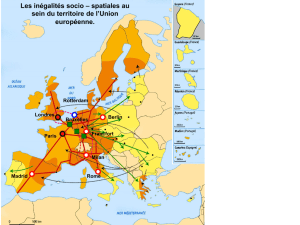océan indien - Département d`information et de communication

OCÉAN INDIEN
Plusieurs îles
ou
archipels
du
sud-ouest
de
l'océan Indien font partie de la Francophonie.
Les
Comores, indépendantes depuis 1975, constituent une république fédérale islami-
que.
Elles
furent protectorat (1886) et territoire outre-mer français (1946). L'arabe et le
français sont langues officielles.
On
y parle surtout le comorien (d'origine arabe et ban-
toue) et
le
swahili. Certains parlent le kibushi (d'origine malgache).
Mayotte, île séparée des Comores
en
1974, est
une
collectivité territoriale française.
Le
français est langue officielle et
on
retrouve les composantes linguistiques de l'archipel
comorien.
Madagascar a proclamé son indépendance
en
1960. Ancien protectorat français (1885),
elle fut annexée par la France comme colonie
en
1896.
Les
langues officielles sont le
malgache et
le
français. D'origine malayo-polynésienne, le malgache, langue maternelle
de la population, présente
une
grande unité linguistique à travers
le
pays malgré
ses
variantes dialectales.
Maurice, hôte
du
V' Sommet de la Francophonie
en
1993, est
un
pays indépendant
depuis 1968, après avoir été possession française (1715) et anglaise (1810). L'anglais est
langue officielle de l'Assemblée législative et de l'enseignement.
Le
français, très présent,
a
un
rôle semi-officiel.
Le
créole est largement employé par la population.
On
y parle
également les langues indiennes (hindi, bohjpouri, tamoul, ourdou, etc.) et chinoises.
La Réunion, possession française depuis 1649, est
un
département outre-mer de la France
depuis 1946.
Le
français y est donc langue officielle.
Le
créole est le
moyen
de communi-
cation naturel de la population. Des langues indiennes
ou
chinoises (cantonnais) sont
parlées par
un
nombre
restreint de familles.
Les
Seychelles forment
un
État
indépendant
depuis 1976. Elles devinrent possession
française
en
1756 et anglaise
en
1811.
Le
créole, l'anglais
et
le français constituent le
trilinguisme officiel mais le créole demeure la langue naturelle, tandis que l'anglais y est
plus parlé que le français.

Principales
importations Viande, riz,
véhicules
automobile,
vêtements
ÛCÉAN INDIEN
Produits
chimiques,
pétrole brut,
machineries
Biens
d'équipement,
produits
alimentaires,
hydrocarbure,
produits
chimiques
Produits
alimentaires,
hydre carbure,
machineries,
équipements
de
transport

"
OCEAN INDIEN
Jean-Louis
JOUBERT
Université Paris XIII
Avec
la collaboration
de
Charlotte
ARRISOA-RAFENOMANJATO,
Madagascar
Arnina
OSMAN,
Maurice
Jean-Claude
CASTELAIN,
rédacteur
en
chef de la revue
Universités
Créole,
français,
anglais,
langues
orientales,
cohabitent
dans
l'Océan
indien,
dont
les
îles
connaissent
des
fortunes
diverses.
D'où
l'émergence
d'économies
parallèles
et
des
jeux
d'influences.
COMORES
La République fédérale islamique des Comores a
connu
en
1995 plusieurs
crises graves.
La
décision du gouvernement Balladur d'exiger à nouveau,
à partir
du
20 janvier 1995,
un
visa d'entrée pour les Comoriens désireux
de
se
rendre à Mayotte a suscité des protestations gouvernementales et
une
assez vive agitation populaire.
Le
gouvernement français a
dû
envoyer
une
mission officielle pour donner des apaisements.
L'émotion soulevée par
les
conditions contestées
d'un
projet de privatisa-
tion
de la compagnie
Air
Comores avait conduit à la destitution du premier
ministre, Mohamed Abdou Madi, remplacé
en
octobre 1994 par Halifa
Houmadi. Une longue grève des
e~seignants
et
du
personnel de Dix-
santé, exaspérés par
les
retards de l'Etat dans
le
paiement de leurs . ,
salaires, avait perturbé
le
deuxième semestre de 1994.
La
prépara-
septle~e
tion
des élections aux postes de conseillers, prévues pour
le
23
avril
tentative
1995, a provoqué de nouvelles turbulences politiques, des menaces de
coup
de boycottage de la part de l'opposition et finalement
un
report du d'État
scrutin.
La
tension interne a obligé le président de la République,
Saïd Mohamed Djohar, a démettre le premier ministre
auquel
il a substitué,
le 25 avril1995,
un
ancien ministre des finances, Caambi
El
Yachourtou.
Le
28 septembre,
Bob
Denard, qui était déjà « intervenu »aux Comores pour
soutenir le président Ahmed Abdallah (jusqu'au mystérieux assassinat de

OCÉAN INDIEN
celui-ci
en
1989, assassinat dans lequel
on
l'a accusé d'avoir trempé) débar-
que à la Grande Comore
en
compagnie
d'une
trentaine de mercenaires.
Se-
lon les observateurs, c'est la dix-septième tentative de coup d'État depuis
l'indépendance proclamée
en
1975. Une opération des troupes françaises
(opération«
Azalée>>)
devait finalement avoir raison de ce putsch. L'affaire
s'est soldée par plusieurs morts, parmi les soldats comoriens qui avaient ral-
lié Bob Denard
et
parmi les civils.
Elle
a aussi mis sur la touche le vieux
président Saïd Mohamed Djohar, passablement déconsidéré, exilé à la
Réu-
nion
et
pour
un
moment
interdit de retour à Moroni.
Cette tentative de coup d'État reste passablement mystérieuse.
Le
recul
du
temps permettra peut-être
aux
historiens de démêler ses implications di-
verses : rivalités personnelles
ou
familiales, luttes des factions politiques,
jeu des grandes puissances, intérêts économiques, etc.
L'ancien premier ministre Caambi
El
Yachourtou assume l'intérim prési-
dentiel
en
attendant
les prochaines élections générales.
La
situation écono-
mique difficile (le tourisme,
qui
commençait à se développer, a beaucoup
souffert de l'intervention des mercenaires
et
de l'incertitude politique) de-
mande
de
délicates négociations avec
le
Fonds monétaire international.
MADAGASCAR
La
situation politique malgache a été dominée
par
les problèmes nés des
luttes d'influence entre les trois sources
du
pouvoir : le président
de
la
République, Albert Zafy; le premier ministre, Francisque Ravony (jusqu'en
septembre
1995);
et
le
président
de
l'Assemblée
nationale,
Richard
Andriamanjato.
Le
remaniement
ministériel
d'août
1994
n'a
pas changé la
Des luttes
donne.
En fait,
deux
politiques se
sont
affrontées : celle
de
Francis-
que
Ravony
supposant
rigueur
et
libéralisation économique tan-
d'influ- dis
que
le président Albert Zafy (comme Richard Andriamanjato)
ence préfère
un
maintien
du
contrôle des changes
et
del'
indépendance
par
rapport à la Banque mondiale
(ce
qui
autorise la recherche de
«financements parallèles>>).
Le
début de 1995 a été
marqué
par le scandale
Flamco (du
nom
d'une
société commerciale présidée
par
le prince Cons-
tantin
du
Liechtenstein) : l'accumulation des dettes auprès de
banques
malgaches a entraîné le remplacement
du
gouverneur
de
la Banque cen-
trale.
Les
négociations avec les institutions financières mondiales
ont
traîné
et
de
nombreux
désaccords persistent.
Le
référendum
de
septembre 1995 a tranché,
en
acceptant
un
amende-
ment
à
la
Constitution
de
la
III•
République malgache, le conflit de légiti-
mité
entre
le président de la République (élu
au
suffrage universel)
et
le
premier ministre (élu
par
l'Assemblée nationale). Désormais, le président
de la République
nomme
le premier ministre : dès octobre Francisque
Ravony a démissionné
pour
être remplacé par Emmanuel Rakotovahiny,
un
fidèle
du
présient
Zafy.
204 L'Année francophone internationale, édition 1996

MADAGASCAR
La situation économique
de
l'île reste fragile : si la pêche
se
développe
(surtout dans le secteur des crevettes
et
crustacés), le tourisme
ne
décolle
pas (l'infrastructure hôtelière est dépassée, les transports aériens
trop
coû-
teux).
Les
autorités financières internationales
n'encouragent
guère les in-
vestisseurs à s'intéresser à Madagascar. L'existence
d'une
économie paral-
lèle multiforme permet encore d'amortir les conséquences
d'une
croissance
déficiente (le chiffre officiel l'établit à 1,5
o/o
pour
1995).
Un
événement
douloureusement ressenti par les Malgaches est
venu
as-
sombrir les perspectives
du
pays :
un
incendie (probablement criminel) a
ravagé
début
novembre le Palais de la Reine,
monument
élevé par les sou-
verains merina
du
XIXe siècle sur la colline
dominant
Antananarivo. L'acte
a été vécu
comme
un
sacrilège
et
peut-être
comme
une
tentative
pour
dé-
chirer définitivement le pays.
La
maison malgache
Charlotte-Arrisoa
RAFENOMANJATO
En
1993,
le
premier Ministre
de
la
période
transitoire,
M.
Guy Willy Razanamasy
écri-
vait dans son
Livre
blanc
«La
maison malga·
che est sauve
...
sans être saine». Cette phrase
reste une mise en garde à l'endroit
des
diri·
geants
de
la Troisième République qui pen-
seraient que la démocratie est
la
seule valeur
requise pour mener
le
pays
vers
le
bien-être
sodal,
vers
une économie performante et une
culture solide.
Le
profil
de
démocrate ne s'ob-
tient qu'avec des preuves tangibles
de
matu-
rité politique, dans
la
bonne gestion et l'ex-
ploitation
des
richesses.
La
maison malgache est apparemment
sauve, mais l'assainissement
n'a
pas eu lieu;
un
mal la ronge, la sinistrose et une an-
goissante incrédulité. Pourtant des points
positifs devraient nous inciter à juger la
crise ponctuelle, disons une crise de crois-
sance ou
un
laborieux apprentissage.
Mais
si
l'âme malgache pousse malgré tout à
la
recherche
d'un
fol
espoir, c'est surtout
le
refus de la chute et de l'irréparable.
Le
mal
malgache
Quelques données: diminution
en
un
an
de près de
40%
du pouvoir d'achat;
un
taux de
75%
de la population au dessous
du seuil de la pauvreté; baisse de
70
%
de-
puis quelques années du taux de scolarisa-
tion des enfants; hémorragie des richesses
nationales; déviation du potentiel humain
vers des actes insensés de survie; dégrada-
tion du culturel
en
dépit du maintien des
références aux valeurs malgaches; sous-ad-
ministration et corruption; verbiage popu-
lacier et gesticulations de la classe politi-
que; insécurité au quotidien aussi bien en
milieu urbain que rural.
Cela pourrait paraître d'une banalité no-
toire pour
un
pays du tiers-monde? Mais
dire qu'avec ses spécificités culturelles et
historiques, avec
sa
potentialité humaine
et ses richesses naturelles, Madagascar
pourrait être le Géant de l'Océan indien.
Si
la
question m'est posée des racines
du
mal,
je
désignerai en premier lieu et sans
hésiter
le
monde rural. Nos ressources na-
turelles et humaines y sont
en
grande par-
tie concentrées, mais
on
le
considère trop
souvent comme
un
silo isolé peuplé de
ci-
toyens de seconde zone: villages enclavés
n'ayant aucun accès à la modernité; pays
profond où
le
mode de vie
n'a
pas changé
depuis le début
du
siècle. Le bien le plus
précieux est la vie,
non
une simple peau à
conserver: c'est
la
mère et l'enfant aux yeux
tournés vers les hommes de la cité, vers
la
justice sociale,
le
travail rémunéré à
sa
juste
valeur,
la
vie décente pour tous.
La
popula-
tion rurale, importante, ne demande qu'à
travailler
si
elle
en
a
la
force physique.
La
malnutrition, le sous-alimentation, les ma-
ladies, l'insécurité, l'absence de moyens et
d'infrastructures sont des handicaps.
Il
faut
bien sûr
<<travailler
pour vivre», mais
on
continue à demander
un
optimum de tra-
vail à
ces
Malgaches sans qu'ils aient, ni
nourriture correcte, ni couverture sociale ni
protection
de
leurs biens et de leurs person-
nes. L'autosuffisance alimentaire du pays
est urgente,
on
le
répète depuis des décen-
nies. Mais le monde rural ne pourra don-
ner que
si
on
l'aide à labourer
la
terre plu-
tôt qu'à
le
marteler de mots creux popu-
listes. Pourtant, chacun constate les effets
bénéfiques des réalisations effectuées avec
L'Année francophone internationale, édition 1996 205
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%