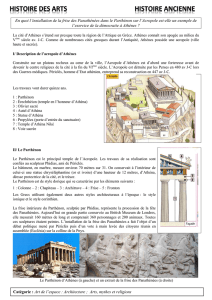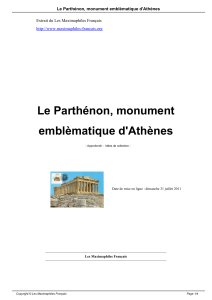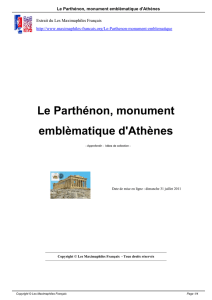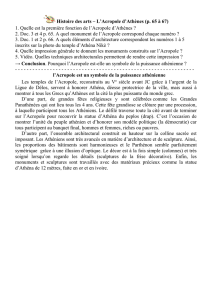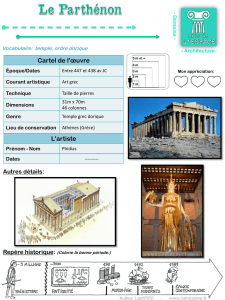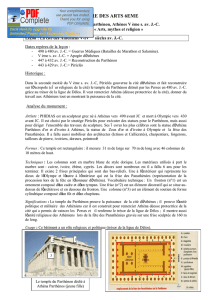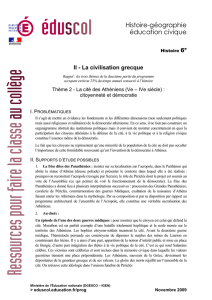Le Musée de l`Acropole d`Athènes Le 13 août 2004 était pour toute

Le Musée de l’Acropole d’Athènes
L’Acropole, à la fin de l’hiver 2003
Le 13 août 2004 était pour toute la Grèce, et
pour Athènes en particulier une date attendue :
l’ouverture des jeux olympiques, événement célébré
avec effervesence par une grande partie de la
communauté hellénique. En amont de la réception des
JO, l’année 2004 devait marquer un autre événement
pleinement associé à la retransmission télévisuelle des
concours sportifs : l’achèvement et l’ouverture du
musée de l’Acropole qui devait offrir à la planète la
vision d’une attente insistante et permanente à la
manière de Vladimir et d’Estragon du retour triomphal
d’icônes perdues, dans l’écrin créé pour les abriter.
Mais la structure destinée à régler une
controverse était elle-même devenue un objet de
controverse. Les affrontements sur la conception du
bâti mettant en danger les vestiges archéologiques d’un
quartier du VIIè siècle de notre ére, permettant de faire
la lumière sur les âges sombres de l’Antiquité tardive
de la ville, et les préocupations légitimes des habitants
du quartier de Makryanni ont conduit à des recours
juridiques. Face à cette levée de boucliers du bon sens
et du droit, le délai d’achèvement du musée pour la
cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques était
désespérément hors d'atteinte. Comme un athlète qui
s'entraîne durant des années pour s’aligner au départ
d’une course, comme Liu Xiang franchissant des
milliers de haies, et déclarant forfait le jour de la
compétition pour cause d’élongation, le nouveau musée
de l'Acropole n’était le 13 août 2004, lorsque la
flamme olympique s’éleva du stade Spyridon Louis
dans le ciel de Maroussi qu’une excavation géante.
Le programme de création du musée de l’Acropole
L’ancien musée de l’Acropole, construit sur le
rocher par l'architecte P. Kalkos en 1865 n'était plus en
mesure depuis longtemps déjà de contenir et de
présenter la grande quantité de sculpture en constante
augmentation au fur et à mesure qu’étaient retirés des
fragments des monuments dans «l'intérêt de leur
sauvegarde».
La nécessité de créer un nouveau musée pour
abriter les objets de l’Acropole était soulignée par les
architectes et les archéologues. Cette situation a
conduit le ministère de la Culture à organiser deux
concours d'architecture, en 1976 et 1979. Le musée
devrait être contenu dans l'espace libre du bloc de
bâtiments abritant le Centre d'études sur l'Acropole au
pied du rocher, dans le quartier de Makryianni. Les
deux concours ont échoué en raison de la place
restreinte en relation avec le programme de
construction, mais aussi en fonction de la faiblesse de
l'analyse insuffisamment documentée des données
présentées.
Quelques années plus tard le ministère de la
culture confiait à un groupe d'étude la tâche d'étudier la
question du Musée et de proposer d'autres sites
possibles pour sa construction. L’étude a débouchée sur
l’organisation d’un concours international
d’architecture basé sur un programme prenant en
compte la proximité du rocher, de sorte à ne pas briser
les liens entre les bâtiments et leur parure. Le concours
a été proclamée le 16 Mai 1989 par le ministère de la
culture et a été organisée sous l'égide de l'Union
Internationale des Architectes (UIA) à Paris.
Les trois sites retenus
Tous situés au Sud de l’Acropole, trois sites
ont été retenus, dans le prolongement linéaire de
l’Olympiéion.
1) Le site de Makryianni tout au pied du rocher, dans
la zone du bâtiment abritant le Centre d'études sur
l'Acropole, défini par les rues D. Areopagitou,
Makryianni, Chatzichristou et Mitsaion. Une zone
d’une surface totale de 24 I50m2, contenant des
bâtiments inaliénables :
a. le bâtiment du Centre d'études sur
l’Acropole
b. La petite église de Saint Cosme et Saint
Damien située à l’angle nord-ouest du Centre d'études
sur l'Acropole.
c. Le bâtiment néo-classique dans l’angle
nord-est du bloc de constructions.
d. Les trois immeubles sur D. Areopagitou.
L’autorisation était donnée d’exproprier les
immeubles du quartier afin de faciliter l'érection du
Musée. Du point de vue archéologique, cette région
était considérée comme ayant été pleinement étudiée et
donc hors d'intervention structurelle, avec la seule
réserve concernant la préservation d'une découverte
archéologique dans l’angle nord-est du polygone. La
hauteur du Centre d'études sur l'Acropole donnait la
limite de la plus grande élévation admissible de tout
nouveau bâtiment.
2) Le site du restaurant Dionysos plus à l’Ouest, et la
zone de stationnement existante, et à l’arrière l’îlot de
verdure, soit une superficie totale de 5 895m2. Le
secteur triangulaire, désormais classé en zone verte,
était mis à disposition en tant que zone de loisirs pour
le nouveau Musée, à la condition qu'il reste peu

développé. Le secteur n'ayant pas été entièrement
étudié sur le plan archéologique, il existait donc une
possibilité que d'anciens vestiges soient enfouis à une
grande profondeur. Pour cette raison, des restrictions
ont été retenues sur la profondeur et l'étendue d'un
sous-sol. En outre, la protection de l'environnement
naturel et la zone archéologique a exigé que la hauteur
du nouveau musée ne dépasse pas deux étages (rez-de-
chaussée et premier étage) à partir du niveau de la
route.
3) Le site Koilè, à l'ouest de la colline de Philopappos,
et en particulier le domaine du théâtre. Il est situé sur le
côté ouest de la colline Philopappos et est séparé du
quartier de Petralona par la route Philopappos. La zone
inclut la partie semi-circulaire du théâtre pour une
surface totale de 25.434 m2. Koilè conserve les
vestiges de tracés d’anciennes routes, maisons et
bâtiments qui témoignent de sa place, dans histoire. Les
concurrents était donc tenu de respecter ces vestiges et
de les inclure dans les alentours du Musée.
L'importance historique du secteur exigeait que
l'excavation en profondeur du sous-sol soit restreinte.
La plus grande hauteur admissible autorisée était de
deux étages (rez-de-chaussée et premier étage) au
niveau du rocher.
La première étape du cahier des charges
concernait :
1) l'implantation du nouveau musée ou du complexe
muséal dans un ou plusieurs des sites mentionnés ci-
dessus.
2) une zone de développement étendue (avec des
propositions de circulation et aires de stationnement)
3) l'inscription éventuelle de l'ancien Musée de
l’Acropole et du Centre d'études sur l’Acropole dans la
fonction du nouveau musée.
4) les domaines de l'organisation du musée.
La seconde étape prévoyait 13 secteurs
d’exposition
A) Préhistoire et objets géométriques
B) Les grands frontons en poros
D) Les frontons de marbre de l'ancien temple d'Athéna
E) Les corés et les sculptures archaïques
F) Les vases et bronzes
G) Les oeuvres de style sévère
H) Les sculptures du Parthénon
La galerie du Parthénon au musée abritera la
décoration sculpturale unique du temple : les métopes,
les frontons et les frises. Ces sculptures sont dans le
musée de l'Acropole et dans ses magasins, tandis que
beaucoup sont encore sur le monument lui-même. A
des fins de conservation - la plupart ne sont pas en bon
état aujourd'hui - les œuvres doivent être placées dans
un environnement strictement contrôlé.
Dans le Musée, des moulages de sculptures
conservées dans les musées à l'étranger seront exhibés
comme une entité séparée. Depuis que le rapatriement

des sculptures originales du Parthénon est envisagée,
cette salle doit permettre leur présentation avec les
fragments grecs. Il est évident que lorsque les marbres
du Parthénon sont rendus à la Grèce par le British
Museum, l'unité sera complète, et l’exposition de
transition sera démantelée.
Plus spécifiquement, les parties suivantes
seront présentées :
1. Métopes
Au nombre de 92, chaque métope mesure 1,35 x 1,35
m. Toutes les métopes existantes seront présentées.
2. Frise
La longueur totale de la frise du Parthénon est de 161
mètres. Toutes les pièces d'origine de la frise
aujourd’hui encore sur le monument seront exposées
(une longueur totale de 24 m) ainsi que celles qui sont
aujourd'hui dans le musée de l'Acropole (longueur
totale de 27 m.). Les copies des plaques totalisant une
longuer de 80 m actuellement au british Museum seront
présentées.
3. Frontons
Chacun des deux frontons occupe une surface de
31mètres de longueur, sur l mètre de profondeur et 3.45
mètres de hauteur. Tous les marbres des frontons
encore en place sur le monument ou dans le musée de
l'Acropole seront inclus.
En outre, les copies des fragements des
frontons présentées dans les musées étrangers seront
montrés comme unité distincte.
I) Les sculptures et fragments d'architecture de
l'Erechthéion
L'Erechthéion, au nord du Parthénon, est un
petit temple ionique construit sur un plan inhabituel.
Les dimensions de la cella sont de 22,22 x 11,62 m.
Les six colonnes du côté est ont une hauteur de 6,59 m.
Le portique nord, mesurant 5,40 x 8,17 m est inférieur
à celui du portique sud d'environ 3m. La crépis à 3
degrés soutient six colonnes ioniques de 7,63 m de
hauteur. Le Portique des Caryatides situé sur le côté
sud du temple mesure 3,37 x 5. 95 m. Les six corés ou
caryatides mesurent 2,40 m de hauteur. Elles reposent
sur un parapet de 1,77m de hauteur. Elles soutiennent
l'entablement du monument. Des fragments de la frise
et des morceaux d'architecture seront également
exposées.
J) La décoration du temple d'Athéna Niké
K) Les fragments d’architecture des Propylées.
L) Les offrandes de la période classique
M) Les reliefs de la période classique
N) La sculptures romaine et les portraits
O) Les oeuvres byzantines
P) Les oeuvres médiévales
Q) La période ottomane.
R) Les travaux de restauration de l’Acropole
Dès la fin de la Révolution grecque de 1831,
commencèrent les travaux de protection et de
conservation des monuments de l'Acropole. Plans,
dessins et photographies seront affichées à partir de la
première tentatives de restauration et des propositions
multiples au fil du temps.
Autres services
Le programme de construction pour le
nouveau Musée comprend également des installations
pour les visiteurs, les domaines culturels, salles
d'exposition temporaires, des ateliers de conservation,
salles administratives etc...
Le résultat du concours
Le projet de construction du musée de
l'Acropole d'Athènes, l’histoire de l’Acropole et de ses
monuments, a agi comme un aimant pour un grand
nombre d'architectes du monde entier. 1270 cabinets
d'architectes de 52 pays différents ont répondu, dont
156 ateliers d’architectes grecs. Après une première
sélection, 438 études de 26 pays ont été retenues. Une
seconde étape le 28 avril 1990, a retenu 24 études dont
10 ont été sélectionnées pour procéder à la deuxième
étape.
Le 11 Novembre 1990, la compétition s'est
terminée avec l'annonce des lauréats. Le premier prix
était attribué aux architectes italiens, Manfredi
Nicoletti, et Lucio Passarelli (site Makryianni). Le
deuxième prix aux architectes grecs Tasos et Dimitris
Biris, Panos Kokkoris, et Eleni Amerikanou (site
Koilé). Le troisième prix revenait à l’architecte
américano-autrichien, Raimund Abraham (site
Makryianni). Une mention spéciale était donnée aux
architectes Chi Wing Lo et Panagiota Davladi (site
Makryianni).
Avec le recul, on peut dire que la spéculation
initiale et les doutes sur le site du Musée était avérés,
car aucun des trois sites n’a été privilégié. Un tiers des
études a choisi de diviser les fonctions du musée, tandis
que les quelques 300 études qui ont choisi un lieu
unique ont été réparties de façon égale entre les trois
sites. Le Concours a souligné que le site de Dionysos
était peu convaincant en raison de la taille réduite de la
parcelle et les restrictions concernant la protection du
paysage. Cependant les particularités du site n'ont pas
été des facteurs négatifs puisque les solutions
proposées couvraient l'éventail complet des
possibilités, de structures muséales creusées à même la
roche, à des bâtiments fortement projetés employant un
langage architectural imposant et dynamique.
Les deux autres sites ont été traités d'une
manière complètement différente, avec des résultats
également différents. Sur le site Koilè, la plupart des
architectes ont tenté d'inscrire un dialogue entre le
Musée et la surface rocheuse naturelle. La zone était
couverte soit par un toit à membranes ou planifiée avec
un bâtiment suggestif plutôt qu’une présence
manifeste. Dans les solutions proposées sur le site
Makryianni visant à associer le Musée en se
juxtaposant à la neutralité de l'environnement, le choix
de l'étude de Chi Wing Lo et Panagiota Davladi a été
une surprise, tant elle a montré qu’une solution
originale pour le musée pouvait être proposée sur un

terrain plus modeste, contournant ainsi les problèmes
sociaux que posent l'expropriation des immeubles
d'appartements sur le site.
Presque tous les concurrents ont suivi le
programme donné par l'organisateur du concours, la
sculpture du Parthénon constituant la composition de
l'architecture de base. Seules quelques études ont
présenté une solution souple et documentée relative à la
situation actuelle, à savoir qu’une grande partie des
sculptures du Parthénon ne sont que des copies. Il
semble que les campagnes lancées par l'État grec pour
le retour des marbres du Parthénon, mêmes si elles
n'ont pas réussi à influencer les autorités compétentes
du Royaume-Uni, ont convaincu la communauté
architecturale internationale.
De nombreux concurrents ont choisi de
disperser le nouveau Musée sur plus d'un site. Le jury a
considéré que cette idée rendait difficile le
fonctionnement harmonieux du Musée.
Du point de vue typologique, toutes les
tendances actuelles de l'architecture contemporaine ont
été représentées, et toutes ces solutions ont été
respectées par le jury pour autant que l'architecte
réussise à mettre ses idées en accords avec une
proposition satisfaisante.
Vues, plans, et scénographie du Musée conçu par Manfredi
Nicoletti, et Lucio Passarelli (site Makryianni) : 1er prix

Raimund Abraham (site Makryiani) : 3ème prix
Chi Wing Lo et Panagiota Davladi (site Makryianni) :
mention spéciale du jury
Las, le projet fit long feu, et le concours
remporté par des architectes italiens Manfredi Nicoletti
et Lucio Passarelli, a été abandonnée après que des
vestiges archéologiques du VIIè siècle de notre ère ont
été trouvés sur l’ensemble des 5,68 ha. du site
Je développerai ultérieurement tous les
principes que les réponses que les architectes ont
apportés à l’édification du Musée de l’Acropole.
Un nouveau concours a lieu. Le jury
comprenait les architectes Santiago Calatrava a qui on
doit la toiture du stade olympique de Maroussi, et
Denis Sharp, architecte britannique et théoricien de
l’architecture. Onze architectes sont retenus parmi
lesquels Daniel Libeskind et Arata Isozaki. L’architecte
franco-suisse Bernard Tschumi et son associé grec
Michael Photiadis remporte le concours, en 2000.
Annoncé initialement comme un défi à la
Grande Bretagne pour réclamer le retour des marbres
Elgin à l’occasion des Jeux Olympiques d’Athènes de
l’été 2004, les travaux n’ont commencé en réalité qu’en
novembre 2004. La réalisation de Tschumi est un
ensemble de verre et de béton. L’architecte a dû
résoudre un grand nombre de problèmes liés au lieu :
comment concevoir un musée sur un site complexe,
flottant au dessus de fouilles archéologiques tout en
recherchant une transparence maximum à travers de
larges surfaces vitrées, le tout dans un climat chaud et
une région sismique ? Comment proposer une stratégie
architecturale pour un musée situé au pied du
Parthénon, un édifice des plus influents de l’Histoire de
l’architecture ?
Le principe choisi par les architectes était «
d’affiner l’approche architecturale afin d’adresser les
complexités de la collection du site avec la plus grande
concision. Notre but était une sobriété maximale. Si
l’architecture peut être décrite comme la
matérialisation d’un concept, l’édifice est dans la clarté
d’un circuit de visite exprimée à travers trois matériaux
: le marbre, le béton et le verre. Dans le cadre des
contraintes inhabituelles du site, le projet doit
simplement exprimer la force de l’évidence : une base
sur pilotis au dessus des ruines, un milieu contenant les
principales galeries, et un couronnement de verre en
haut contenant les frises du Parthénon. Le but de cette
simplicité est de focaliser l’affect et l’intellect sur ces
œuvres extraordinaires. »
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%