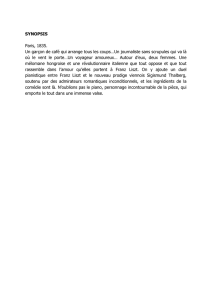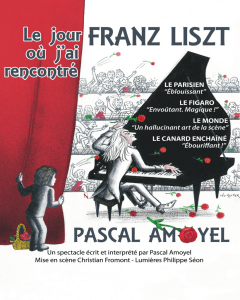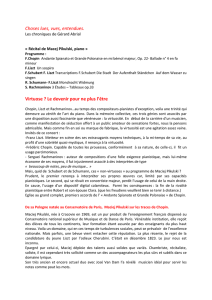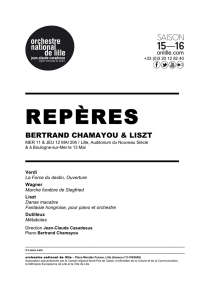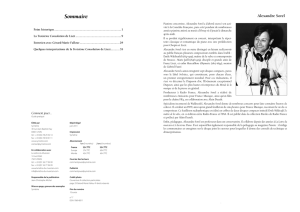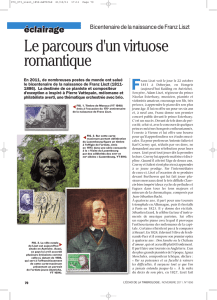FRANZ LISZT 1811-1886 Le piano fit sa gloire, le génie son

p 1/3
Franz Liszt est en effet l’une des gures majeures du Romantisme musical
et l’un des plus grands novateurs de la musique occidentale, à l’instar d’un
Machaut, d’un Monteverdi ou d’un Beethoven. A dire vrai, ce moderniste
effréné n’occupe peut-être pas la place qui devrait être la sienne, faute d’une
diffusion éclectique d’un immense corpus dont seulement quelques aspects
ont été popularisés. Avant tout, la virtuosité frénétique de sa musique pour
piano a ravi les monstres du clavier qui ont fait du maître de Weimar leur
indéfectible faire-valoir. Cette image est bien réductrice et il faut espérer que
cette année du bicentenaire – à laquelle les Flâneries apportent leur fervente
contribution- permettra d’afner le portrait musical du compositeur.
L’activité créatrice de Liszt s’est déployée dans des domaines aussi variés
que l’écriture musicale (dont l’harmonie est un vecteur essentiel), la technique
instrumentale, l’orchestration et, bien évidemment, la composition proprement
dite. A ces activités créatrices, il faut ajouter l’extrême intérêt que Liszt prenait
à faire connaître la musique de ses confrères, amis ou non, mais également
des maîtres du passé tels que Bach, Mozart, Beethoven, Schubert…
C’est à sa prodigieuse technique digitale que le maître doit sa réputation
universelle. « Inventeur » du récital, il sillonna l’Europe en héros, repoussant
en permanence les limites techniques du piano, lui octroyant une dimension
symphonique, et sidérant tous ses auditeurs… de Beethoven à Saint-
Saëns. Aussi scrupuleux que l’était Chopin dans la clarté de l’articulation et
l’indépendance des mains, il y glissait en sus une impétuosité, une fougue
tout à fait inattendue au XIXème siècle. Ce jeu éblouissant, usant avec délices
de toute l’étendue du clavier, animera bientôt les grandes pages pianistiques
d’un Debussy et d’un Messiaen.
Compositeur prolixe (environ 700 œuvres), Liszt a donné au piano des
chefs-d’œuvre aussi variés que les 19 Rhapsodies hongroises, la
Sonate en si mineur, ou les Années de pèlerinage. Les Rhapsodies -
effroyablement difciles ! - sont parfois jugées avec condescendance,
tant elles caressent l’instinct populaire. C’est vite oublier qu’elles
par FRANCIS ALBOU, professeur agrégé de musicologie
FRANZ LISZT 1811-1886
Le piano fit sa gloire, le génie son immortalité…

p 2/3Flâneries Musicales 2011 / tous droits réservés
intègrent pour la première fois dans la musique « savante » des éléments
ethniques magniant les joies et les drames du peuple… en l’occurrence celui
d’Europe Centrale. Principe que reprendront au XXème siècle Bartók, Milhaud,
Ravel et Piazzolla. Quant au amboyant monolithe que représente la Sonate
en si mineur, il renouvelle totalement la forme fétiche du XVIIIème siècle par
une morphologie inédite conjuguée à une thématique unitaire originale qui
développe dans ses extrêmes limites le concept du mono thématisme.
L’orchestre fut l’un des moyens d’expression favoris de Liszt. Il en usa avec
génie. Son gendre Richard Wagner ne se priva pas de lui ravir sans vergogne
nombre de ses trouvailles… comme il le t aussi dans le domaine de l’écriture
harmonique ! A l’actif du compositeur, il faut noter l’invention (reprenant en
cela les idées de son ami Berlioz) du « poème symphonique » qui scelle la
sensuelle osmose entre le verbe et le son, entre le son et l’image… annonçant
le processus du ballet et peut- être du cinéma ( ?). Les treize partitions
symphonico-narratives de Liszt annoncent les deux grandes symphonies
du maître évoquant, par le seul médium orchestral, les épopées de Dante
et de Faust.
Face cachée du maître, la musique religieuse est inexplicablement occultée.
Une soixantaine de pages dont les Messes de Gran, du Couronnement, des
Motets, des Hymnes, des Psaumes, des méditations pour piano ou pour
orgue, que dominent les deux admirables
oratorios « La légende
de Sainte Elisabeth »
et « Christus » écrits au moment où Liszt
se décidait à devenir abbé. N’hésitant pas
à citer le plain-chant, habilement mêlé à la
pureté palestrinienne et aux tournures
les plus neuves, le compositeur tisse un
lien ténu entre l’opéra
(qu’il a délaissé depuis
l’âge de treize ans) et l’oratorio, froidement abandonné par les Romantiques.
A ces vastes architectures il faut joindre le poignant « Via Crucis » pour piano
et chœur, sombre méditation aux reets déjà expressionnistes.
Il serait injuste sous prétexte que nous sommes loin de l’aura d’un Schubert
ou d’un Schuman de ne pas s’arrêter sur les quelques 80 lieder ou mélodies
que Liszt composa sur des textes allemands (Gœthe), français (Hugo et
Gautier) ou italiens et qui recèlent de pures merveilles tant au niveau musical
qu’à celui de l’expression.
D’une générosité sans faille, d’une profonde humanité, - cela est beaucoup
moins connu -Liszt a consacré une grande partie de son temps et de son
génie à la diffusion des ouvrages d’autrui. Compositeurs du passé ou collègues
contemporains, Liszt a permis de faire connaître et apprécier des pans entiers
de la musique occidentale. Il faut bien observer qu’au XIX
ème
siècle, ni radio, ni
enregistrements ne permettaient de divulguer la musique. La seule manière de
l’approcher en dehors du concert ou du spectacle était donc de la faire vivre
par des adaptations que l’on interprétait dans les salons. Sur les 686 opus
de Franz Liszt, 335 sont des transcriptions ! Ces pages venues d’ailleurs se
répartissent en plusieurs catégories qu’il convient de bien distinguer.
L’orchestre fut
l’un des moyens
d’expression
favoris de Liszt. Il
en usa avec génie.
A
n
i
m
a
E
t
e
r
n
a
B
r
u
g
g
e
@
A
l
e
x
V
a
n
h
e
e
E
i
n
a
v
Y
a
r
d
e
n
@
B
a
l
a
z
s
B
o
r
o
c
z
J
o
s
v
a
n
I
m
m
e
r
s
e
e
l
@
A
l
e
x
V
a
n
h
e
e
C
h
œ
u
r
A
r
s
y
s
B
o
u
r
g
o
g
n
e
@
F
r
a
n
ç
o
i
s
Z
u
i
d
b
e
r
g
J
a
y
G
o
t
t
l
i
e
b
@
D
R

p 3/3Flâneries Musicales 2011 / tous droits réservés
Tout d’abord les transcriptions pour piano proprement dites où Liszt ne
s’autorise aucune fantaisie : les 9 symphonies de Beethoven, des pages
de Mozart, plusieurs grands diptyques pour orgue de J.S. Bach, auxquels il
faudrait joindre des lieder de Schubert, des mélodies de Chopin, la Symphonie
Fantastique de Berlioz, le « Prélude et mort d’Isolde » de Wagner…
On trouve également d’autres formes de « variations » que Liszt a parfois
appelées « réminiscences » dans lesquelles il construit une œuvre magniant
le souvenir d’une représentation d’opéra : Mozart, Bellini, Donizetti, Meyerbeer,
Verdi sont alors ses inspirateurs.
Ailleurs encore, il subtilise un thème à un confrère et en fait la substantique
mœlle d’une vaste composition en forme de variations. Ainsi naquirent deux
des grandes partitions pour orgue, les « Variations sur Weiner, Klagen, Sorgen,
Sagen », d’après le chœur d’entrée de la cantate BWV 12 de Bach, et la
grande « Fantaisie et fugue sur « Ad nos ad salutarem undam » fondée
sur le choral de l’opéra « Le Prophète » de Meyerbeer et si proche dans sa
conception de la sonate en si mineur !
La plus grande partie du succès de Liszt était due, en son temps, à ces
paraphrases qui électrisaient le public des salons, épris d’opéras à la mode.
C’est au piano que le vieux Liszt, tonsuré, soutané… cone ses ultimes
méditations musicales. Mais quelle musique ! Les rythmes se simplient et
la tonalité se désagrège peu à peu. Le XXe siècle s’annonce et la musique
atonale point à l’horizon. « La lugubre gondole », « Disastro », « Nuages gris »,
« Bagatelle sans tonalité »… Le virtuose se tait peu à peu. Le prophète parle.
Jamais il ne cessera de nous interpeler.
1
/
3
100%