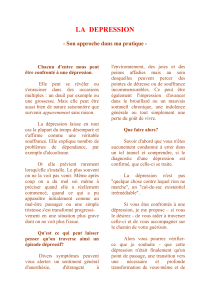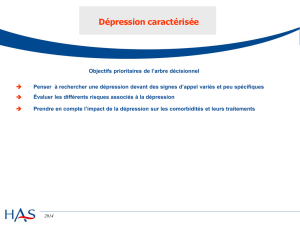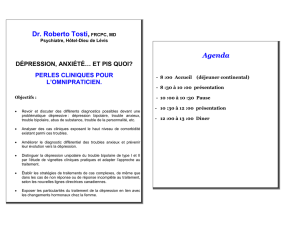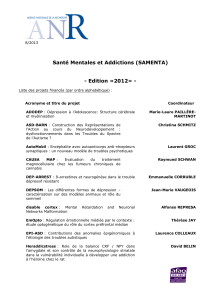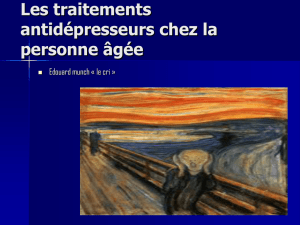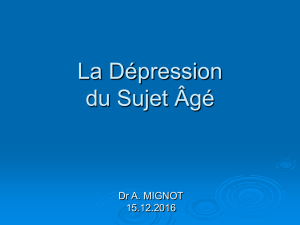Démences et dépression

Synthèse
Démences et dépression
CHRISTIAN DEROUESNÉ
1
LUCETTE LACOMBLEZ
2
1
Faculté de médecine
Pitié-Salpêtrière,
Université Paris VI
2
Fédération de neurologie
Mazarin,
Département
de pharmacologie,
Groupe Hospitalier
Pitié-Salpêtrière, Paris
Résumé. La littérature portant sur les relations entre démence et dépression est confuse en
raison de nombreux biais méthodologiques liés aux différences entre les populations
étudiées, mais aussi à la situation des observateurs, au type d’approche employée et aux
instruments utilisés pour définir la dépression. La difficulté du diagnostic différentiel entre
démence et dépression est largement surestimée dans le cas de la maladie d’Alzheimer
(MA). En dépit de la réduction d’activités commune aux deux syndromes, il existe des
différences dans la sémiologie des troubles, la nature des déficits mnésiques et les données
de l’imagerie cérébrale qui permettent aisément de faire la distinction. En revanche, il peut
être beaucoup plus difficile de différencier la dépression d’une démence frontale ou sous-
corticale. Les biais méthodologiques rendent également compte du caractère contradictoire
des données des travaux consacrés à la possibilité que la dépression constitue un facteur de
risque pour la survenue d’une MA comme à l’évaluation de la fréquence, de la sémiologie et
du retentissement de la dépression associée à la MA. En réalité, les modifications compor-
tementales de la MA sont plus liées à un trouble de la motivation (apathie) qu’à un trouble de
l’humeur (dysphorie) et à des modifications affectives à type d’émoussement ou d’inconti-
nence émotionnelle. L’origine de la symptomatologie dépressive fait intervenir des facteurs
neurobiologiques, accessibles aux antidépresseurs, mais aussi des réactions psychologi-
ques qui nécessitent une prise en charge de type psychothérapique dirigée vers le patient
mais aussi vers l’entourage familial.
Mots clés : dépression, démence, maladie d’Alzheimer, démence frontotemporale, apathie,
émoussement affectif
Summary. Data from the literature devoted to the relationships between dementia and
depression are controversial on account of numerous methodological biases (community
studies or from neurological or psychiatric departments), categorical versus dimensional
approaches and variability of assessment tools for depression, aim of the study (depression
versus dementia or versus Alzheimer’s disease, AD). The difficulty to discriminate depres-
sion from AD is largely overestimated due to the confusion between depression, depressive
symptomatology and apathy. The distinction is greatly facilitated by taking into account the
qualitative differences of the memory deficits and cerebral imagery. Distinction of depres-
sion from frontotemporal or subcortical dementias could be much more difficult. Rela-
tionships between depression and AD are controversial. Most reports of depression as a risk
factor for AD in the subsequent years, actually describe depressed symptomatology linked
to apathy in preclinical AD. However, some studies found a relationship between AD and
depression occuring more than 10 years before the onset of AD symptomatology, sugges-
ting some common risk factors. The so-called symptoms of depression in AD are more
related to apathy and affective disturbances than to dysphoria. The frequency of major
depressive episode (MDE), greatly varies according to studies, but the frequency of suicide
is low. Depression in dementia is related to neurobiological factors as well as to psycholo-
gical mechanisms. Therefore, its treatment should associate antidepressant drugs and
psychological support directed to the patient and family.
Key words: depression, apathy, dementia, Alzheimer disease, frontotemporal dementia,
affective blunting
Dans les deux dernières décennies, la littérature
consacrée aux rapports entre démences et dé-
pression n’a cessé d’être très abondante. La
problématique qui sous-tend cette question est double :
1) sur le plan pratique, le désir de ne pas confondre
une affection qui, en dépit des progrès thérapeutiques,
demeure incurable, la démence, avec une affection
réversible lorsqu’elle est correctement traitée, la
dépression ;
2) sur le plan théorique, elle pose la question des
rapports entre les affections dégénératives à expression
démentielle et la dépression, c’est-à-dire entre le fonc-
tionnement cérébral et le fonctionnement psychique.
Psychol NeuroPsychiatr Vieillissement 2004 ; vol. 2 (Suppl. 1) : S35-S42 S35
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

Dépression ou démence ?
La question du diagnostic différentiel
Cette question se pose car la définition de ces deux
entités est purement clinique et leurs sémiologies se
recouvrent partiellement. En réalité, la difficulté du dia-
gnostic différentiel apparaît largement surestimée dans
la littérature, au moins en ce qui concerne la maladie
d’Alzheimer (MA). Elle peut être beaucoup plus grande
dans le cas des démences frontotemporales (DFT), et
des démences dites sous-corticales.
Il est essentiel de rappeler que le noyau central des
affections démentielles est un déficit cognitif, même si,
très tôt, les manifestations cognitives sont associées à
des perturbations psychoaffectives, alors que la dépres-
sion est essentiellement caractérisée par un trouble
particulier de l’humeur, même si cette dysphorie retentit
sur l’activité générale comme sur les fonctions cogniti-
ves.
Dépression ou maladie d’Alzheimer ?
La difficulté diagnostique varie selon le milieu d’ob-
servation (population générale, structures neurologi-
ques, psychiatriques, institutions) et la formation du
clinicien à la neurologie et à la psychiatrie. Position du
problème : les affections démentielles provoquent des
modifications de l’activité qui sont associées à des trou-
bles cognitifs alors que, dans la dépression, ces modifi-
cations sont la conséquence du trouble de l’humeur.
Les manifestations communes :
la diminution d’activité
MA et dépression ont en commun une restriction
des champs d’activité, une perte d’intérêt, un repli sur
soi, une perte de l’initiative. Mais il existe déjà des
différences importantes au niveau de cette perte d’acti-
vité et de la façon dont elle est vécue.
La baisse d’activité dans la MA est liée à une perte de
la motivation ou apathie [1, 2] qui se manifeste égale-
ment par une absence d’intérêt pour sa santé (c’est
habituellement la famille qui est à l’origine de la consul-
tation), sa personne, ses activités. Le patient présente
moins d’initiative, tend à devenir dépendant des autres
et, le plus souvent, minimise ses difficultés dans la vie
quotidienne.
À l’inverse, le déprimé est inquiet pour sa santé,
présente des plaintes somatiques multiples. Il s’in-
quiète de son manque d’activité, se trouve bon à rien et
résiste aux stimulations de l’extérieur. Il consulte habi-
tuellement de lui-même.
Les troubles de l’affectivité
Le vécu des déprimés est marqué par un sentiment
pénible de tristesse, de solitude, d’abandon, une dou-
leur morale, le dégoût de soi et des autres. Le sujet
déprimé est indifférent aux affects positifs, il a perdu le
goût de la recherche du plaisir (anhédonie), mais il reste
très sensible aux émotions négatives. Son trouble de
l’humeur (dysphorie) est permanent au cours de la
journée avec toutefois une prédominance matinale.
L’apathie de la MA se manifeste, à l’inverse, par un
affect plat, une diminution des réactions aux émotions
qu’elles soient positives ou négatives. L’émoussement
affectif laisse place, par moments, à une véritable incon-
tinence émotionnelle, laissant apparaître anxiété, senti-
ments dépressifs, mais ces éléments sont transitoires,
l’humeur est labile.
Les éléments d’appoint
Il est toujours difficile de faire préciser le début d’une
MA, qu’il s’agisse de difficultés de mémoire ou de modi-
fications du comportement. Le début est lent, insidieux
et remonte dans la plupart des cas à un an, voire plus.
Lorsque la famille mentionne un début récent, à l’occa-
sion d’un événement qui l’a frappée, l’interrogatoire
met aisément en évidence la présence de troubles beau-
coup plus anciens qui n’avaient pas inquiété l’entou-
rage et qui ne prennent toute leur signification qu’à
l’occasion de l’épisode récent. À l’inverse, le début
Points clés
+La distinction entre dépression et maladie d’Alzhei-
mer est habituellement aisée du fait de différences
dans la sémiologie, les troubles de mémoire et les
données de l’imagerie cérébrale.
+Les difficultés peuvent être beaucoup plus grandes
dans le cas des démences frontotemporales ou des
démences sous-corticales dans lesquelles les trou-
bles de mémoire comme les données de l’imagerie
ne permettent pas la distinction.
+Les symptômes « dépressifs » sont très fréquents
dès le début de la maladie d’Alzheimer, mais ils
relèvent d’un trouble de la motivation (apathie) plus
que d’un trouble de l’humeur.
+Dans leur genèse interviennent des facteurs biolo-
giques mal précisés, mais également le retentisse-
ment des perturbations cognitives sur le psychisme
du patient et de son entourage.
+Leur traitement doit donc associer médicaments
antidépresseurs et prise en charge psychologique du
patient comme de son entourage.
C. Derouesné et L. Lacomblez
Psychol NeuroPsychiatr Vieillissement 2004 ; vol. 2 (Suppl. 1) : S35-S42S36
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

d’une dépression est souvent plus net, secondaire à un
épisode affectif qui remonte à moins de six mois.
La présence d’antécédents psychiatriques, d’épiso-
des antérieurs de dépression est, bien entendu, un élé-
ment d’appoint pour le diagnostic de dépression. Mais il
n’est pas rare qu’une dépression survienne chez un
sujet âgé sans aucun antécédent et l’absence d’antécé-
dents n’élimine pas la dépression ; à l’inverse, la pré-
sence d’antécédents psychiatriques n’élimine pas la
MA.
Au cours de l’examen, le comportement du sujet
atteint de MA est habituellement normal. Il s’exprime
d’une voix normale et sans difficultés en l’absence de
troubles du langage. S’il apparaît ralenti dans les tâches
intellectuelles, sa vivacité est préservée sur le plan mo-
teur. Le sujet déprimé s’exprime lentement, volontiers
d’une voix monotone, et ses gestes témoignent d’un
ralentissement psychomoteur.
Un élément de différenciation fondamental :
les troubles mnésiques
Les troubles mnésiques sont présents dès le début
de la MA dont ils constituent l’élément le plus caracté-
ristique pour le médecin comme pour l’entourage. Le
patient est le plus souvent conscient de ses difficultés,
mais tend à les minimiser, les rapportant à l’âge, à
l’exagération ou à l’angoisse de son entourage. Il nie
volontiers qu’ils soient à l’origine d’une diminution de
son activité. La plainte mnésique du déprimé est rare-
ment isolée. Elle s’intègre dans un contexte de plaintes
somatiques, d’inhibition intellectuelle, de défaut de
concentration.
Le fait essentiel est que les difficultés de mémoire de
la MA et de la dépression relèvent de mécanismes tout
à fait différents, ce qui se traduit dans leur sémiologie et
peut être mis en évidence simplement. Le trouble mné-
sique de la MA est lié à une difficulté à mémoriser les
informations nouvelles en mémoire épisodique : il ne
porte que sur des événements du passé récent. Le sujet
répète les questions, pose une question alors que l’in-
formation vient de lui être donnée ; parfois l’oubli porte
sur un événement entier survenu au cours des heures,
des jours, des semaines précédents. À l’inverse, le
passé ancien apparaît longtemps préservé. Les difficul-
tés du patient déprimé sont liées à une perturbation des
mécanismes de rappel : ils portent autant sur le passé
ancien que sur le passé récent et plus volontiers sur les
souvenirs dont la restitution nécessite une recherche
active (noms propres, détails d’événements{) ou les
souvenirs autobiographiques à connotation affective
positive alors qu’il peut, à l’inverse, ruminer les souve-
nirs à connotation négative.
Cette différence peut être aisément mise en évi-
dence par l’examen. Lorsqu’on demande aux sujets
d’apprendre une liste de mots et de les restituer après
avoir inhibé la répétition mentale (par exemple en les
faisant compter à l’envers de 20 à 0), sujets déprimés et
sujets atteints de MA ont également des difficultés à
restituer les mots de la liste (rappel libre). Mais si les
processus de rappel sont facilités par l’apport d’indices
de rappel au moment de l’acquisition des mots (par
exemple en faisant associer le mot à sa catégorie, rap-
pel dit indicé : tulipe = fleur) ou en les présentant au
milieu d’autres mots (reconnaissance), la difficulté dis-
paraît ou est grandement améliorée lorsqu’elle traduit
un trouble des mécanismes de rappel. À l’inverse, elle
est peu ou pas modifiée lorsqu’elle relève d’un trouble
de la mémorisation.
Cette technique peut être facilement utilisée en de-
mandant au sujet de rappeler une liste de 4 ou 5 mots
appartenant à des catégories différentes non reliés en-
tre elles (exemple : fleur = dahlia ; légume = poireau ;
arbre = platane ; outil = tenaille) [3]. La non restitution
d’un seul mot en rappel indicé ou la présence d’une
intrusion (mot étranger) doivent être considérées
comme hautement suspectes et nécessitent de pousser
les investigations.
Les données des examens paracliniques
Deux examens sont importants pour le diagnostic
différentiel entre dépression et MA.
L’examen neuropsychologique apporte des élé-
ments essentiels en précisant l’importance et le type
des troubles de mémoire par un test qui permet de
différencier les troubles de la mémorisation des trou-
bles du rappel (seul le test de Grober et Buschke [4]
répond actuellement à ces exigences ; c’est un appren-
tissage d’une liste de 16 mots après vérification de l’en-
codage, confrontation des résultats en rappel libre, rap-
pel indicé et reconnaissance). L’examen
neuropsychologique permet également de préciser
l’éventuelle atteinte d’autres fonctions supérieures
comme le langage, ce qui constituerait un élément
d’appoint en faveur de la MA. Il faut noter que les tests
d’évaluation globale, comme le mini mental state exa-
mination (MMSE), ne permettent pas de différencier
une MA au début d’une dépression, car la dépression
peut entraîner une diminution des performances cogni-
tives globales.
L’imagerie cérébrale est le second élément impor-
tant. Les lésions de la MA débutent toujours au niveau
des régions temporales internes et les premières ano-
malies, fonctionnelles et structurales, apparaissent au
niveau des régions hippocampiques. Elles se tradui-
Démences et dépression
Psychol NeuroPsychiatr Vieillissement 2004 ; vol. 2 (Suppl. 1) : S35-S42 S37
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

sent, au scanner-X ou à l’IRM, par un élargissement des
citernes périhippocampiques et des cornes tempora-
les : il est donc essentiel de préciser que l’examen neu-
roradiologique doit être centré sur les cornes tempora-
les. L’absence d’atrophie hippocampique doit faire
remettre en question le diagnostic de MA. Un élargisse-
ment des sillons corticaux, la présence d’anomalies de
type vasculaire n’ont aucune valeur diagnostique car
elles peuvent se rencontrer chez le sujet âgé dans l’une
et l’autre des pathologies.
Dans certains cas, un examen tomoscintigraphique
peut aider en mettant en évidence un déficit de la per-
fusion cérébrale au niveau des régions hippocampiques
ou du cortex pariéto-temporal dans la MA. Au cours de
la dépression, la perfusion cérébrale est le plus souvent
normale, mais un déficit peut être observé au niveau
des régions frontales. Il épargne toutefois les régions
hippocampiques et postérieures.
Dépression ou démence frontotemporale ?
Bien que les DFT soient habituellement observées
chez des sujets plus jeunes que la MA, des données
récentes montrent qu’elles ne sont pas exceptionnelles
après 65 ans. Le diagnostic avec une dépression peut
être ici beaucoup plus difficile car les manifestations
comportementales sont au premier plan dans les deux
pathologies.
La distinction repose avant tout sur l’analyse de ces
manifestations. Les DFT peuvent se traduire par une
apathie majeure [5]. Le diagnostic est facilité lorsque s’y
associent des manifestations de désinhibition évocatri-
ces de lésions frontales. Il est beaucoup plus difficile
lorsque l’apathie est isolée. En effet, les troubles de
mémoire des lésions frontales sont de même nature
que ceux de la dépression et relèvent de troubles des
mécanismes de rappel. L’examen neuropsychologique
peut être normal dans les DFT alors que les troubles du
comportement sont nets. Lorsqu’ils existent, ils portent
sur des épreuves explorant le fonctionnement exécutif
(planification, contrôle de l’activité, inhibition{) qui peu-
vent être perturbées dans la dépression. Si la présence
d’une atrophie des lobes frontaux est, bien évidem-
ment, en faveur d’une DFT, son absence ne l’élimine pas
car elle peut n’apparaître que tardivement par rapport
aux troubles comportementaux. L’existence d’un déficit
de la perfusion cérébrale dans les régions frontales est
un argument en faveur de la DFT, mais elle peut être
observée dans certaines dépressions.
Le diagnostic peut également être plus difficile dans
les démences vasculaires ou les démences sous-
corticales car les troubles de mémoire sont de même
type que ceux observés dans la dépression.
Qu’attendre du traitement d’épreuve ?
En cas de doute, il est habituel de prescrire un trai-
tement d’épreuve par antidépresseurs. Toutefois, ce
traitement ne saurait être considéré comme un test, car
les antidépresseurs peuvent améliorer certains symptô-
mes des affections démentielles (notamment l’apathie,
les manifestations anxio-dépressives associées) alors
qu’il existe un nombre non négligeable de dépressions
résistantes.
Si un traitement antidépresseur est néanmoins pres-
crit, il faut utiliser des doses efficaces pendant un temps
suffisant et il faut exiger une réponse franche, notam-
ment sur les manifestations cognitives. Ce traitement,
toutefois, ne doit pas être systématique car :
1) il peut provoquer des effets latéraux sérieux chez
des patients atteints d’affection dégénérative (en parti-
culier avec l’utilisation d’antidépresseurs ayant des ef-
fets anticholinergiques dans la MA ou aggravant les
troubles comportementaux dans les DFT) ;
2) il peut conforter la famille dans une attitude erro-
née par rapport au patient ;
3) l’apparition de traitements efficaces dans la MA a
modifié les perspectives d’autant que leur action sem-
ble être plus importante s’ils sont prescrits précoce-
ment. En revanche, le problème est beaucoup plus
difficile dans les DFT pour lesquelles nous n’avons
aucun traitement efficace. Il est tout aussi essentiel de
ne pas méconnaître une dépression chimio-résistante :
le seul recours est alors l’électroconvulsivothérapie.
Démence et dépression
Les rapports entre ces deux entités sont complexes
et les résultats des études qui leur sont consacrées sont
contradictoires. La fréquence de l’association entre dé-
pression et démence varie ainsi de0à87%dans la
littérature ! Ces contradictions mettent en relief des
divergences liées à la situation des observateurs (étu-
des effectuées en milieu psychiatrique, neurologique
ou dans la population générale), la méthodologie em-
ployée (approche catégorielle utilisant des critères dia-
gnostiques pour définir la dépression ou dimension-
nelle reposant sur l’utilisation d’échelles de dépression,
spécifiques ou non, de recueil des données direct par
l’examen des patients ou indirect par l’interrogatoire
des proches) et la différence des populations étudiées
(certaines études portent sur les relations entre la dé-
pression et la démence en général sans spécifier l’étio-
logie, d’autres plus précisément sur la MA ou une autre
pathologie).
Deux questions principales sont abordées : la dé-
pression constitue-t-elle un facteur de risque pour le
C. Derouesné et L. Lacomblez
Psychol NeuroPsychiatr Vieillissement 2004 ; vol. 2 (Suppl. 1) : S35-S42S38
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

développement d’une affection démentielle ? Quelles
sont les particularités cliniques et thérapeutiques de la
dépression lorsqu’elle survient chez un sujet présentant
une affection de ce type ?
La dépression est-elle un facteur de risque
de développement d’une affection démentielle ?
Deux types d’arguments ont été avancés pour consi-
dérer que la dépression pourrait être un facteur de
risque du développement d’une pathologie démentielle
chez le sujet âgé. Les données épidémiologiques appa-
raissent les mieux établies, bien qu’elles soient grevées
des biais méthodologiques exposés plus haut [6]. Plu-
sieurs études ont montré qu’une proportion notable de
dépressions survenant chez les sujets âgés évoluait
vers l’installation d’une démence dans les années sui-
vantes. Ces études sont criticables car, dans beaucoup
de cas, l’affection démentielle existait déjà au moment
de la « dépression ». Il faut ici rappeler que les critères
internationaux exigent la présence d’une démence (dé-
ficit cognitif multiple retentissant sur la vie quotidienne)
pour le diagnostic de MA. Or, nous savons aujourd’hui
que l’installation de la démence est précédée par une
phase de plusieurs années et que la symptomatologie
dépressive ou l’apathie sont, avec les troubles de mé-
moire, les manifestations initiales de la maladie. La
plupart des dépressions évoluant vers une MA tradui-
sent, en réalité, le début d’une MA, à la phase pré-
démentielle. La présence de lésions vasculaires asso-
ciées expliquerait que cette évolution soit plus nette
chez les hommes que chez les femmes [7]. Plus trou-
blantes sont les études montrant la fréquence élevée
des dépressions survenues plus de dix ans avant les
troubles cognitifs [8] qui fait évoquer la possibilité d’une
fragilité génétique commune ou l’influence, sur les
deux pathologies, de troubles de la personnalité ou
d’événements de vie défavorables [9].
Par ailleurs, certains auteurs, psychanalystes ou sys-
témiciens, soutiennent l’origine psychologique de la
démence, considérée comme une défense contre la
dépression, individuelle ou familiale. Les arguments
sont ici purement théoriques et ne reposent, au mieux,
que sur l’étude de cas isolés. Si l’hypothèse de l’in-
fluence de facteurs psychosomatiques dans l’apparition
ou l’évolution des pathologies démentielles mérite
d’être prise en compte, il est difficile d’admettre une
pure psychogenèse de ces pathologies et d’abolir la
distinction entre les affections mentales relevant de
perturbations purement fonctionnelles du cerveau,
donc réversibles, et les affections liées à des lésions
cérébrales irréversibles [10].
Les particularités de la dépression chez les sujets
présentant une affection démentielle
Là encore, les données de la littérature sont contra-
dictoires en raison des mêmes problèmes méthodolo-
giques. Nous envisagerons d’abord les données
concernant la MA, de loin l’affection la plus fréquente,
réservant un chapitre séparé à la question des autres
étiologies.
Les particularités sémiologiques
La question qui se pose est de savoir si les critères
diagnostiques de la dépression primaire et les échelles
utilisées pour évaluer la sévérité de la symptomatologie
dépressive sont applicables ou non aux patients ayant
des lésions cérébrales, en particulier dans les affections
démentielles, du fait du recouvrement partiel de la sé-
miologie. Les réponses à cette question varient grande-
ment dans la littérature. Deux sources de confusion
supplémentaire viennent s’ajouter aux biais méthodo-
logiques habituels : la confusion entre dépression et
apathie et l’absence de prise en compte de l’anxiété
dans la grande majorité de la littérature anglo-saxonne.
Les tentatives de définition de critères spécifiques de la
dépression dans la MA ne semblent pas résoudre ces
problèmes [11, 12].
En fonction de notre expérience et des données de la
littérature, nous voulons souligner plusieurs points :
1. Une symptomatologie de type dépressif, comme
d’ailleurs une symptomatologie anxieuse, est fréquente
dans la MA et ce, dès son début, alors que les dépres-
sions caractérisées sont rares. Dans un travail, effectué
en collaboration avec l’unité de recherche du profes-
seur Widlöcher [13], nous n’avons observé aucune dé-
pression majeure et seulement 10 % de trouble dysthy-
mique chez 118 patients atteints de MA. En revanche,
une symptomatologie de type dépressif, comme
d’ailleurs une symptomatologie anxieuse, était très fré-
quente. Les scores aux échelles de dépression et d’an-
xiété, bien que très inférieurs à ceux d’une population
contrôle de sujets présentant une dépression caractéri-
sée, étaient en effet supérieurs à ceux observés chez des
sujets âgés normaux. La présence d’apathie, d’anxiété
et d’incontinence émotionnelle a été observée chez plus
des deux tiers des patients ayant un score au
MMSE > 23 et chez plus de la moitié de ceux dont le
score était > 26 [14].
2. Il existe des particularités sémiologiques dans la
symptomatologie des sujets atteints de MA. La sympto-
matologie dite dépressive est, en réalité, faite de mani-
festations liées à l’apathie et à des perturbations émo-
tionnelles (émoussement affectif, anxiété et
incontinence émotionnelle). Nous avons pu montrer
Démences et dépression
Psychol NeuroPsychiatr Vieillissement 2004 ; vol. 2 (Suppl. 1) : S35-S42 S39
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%