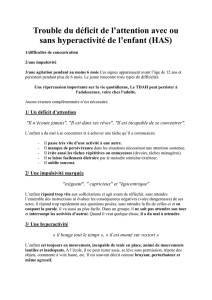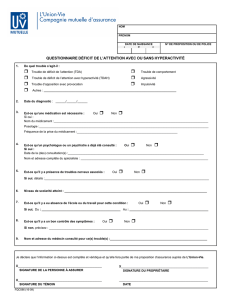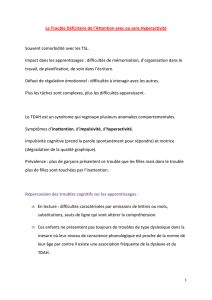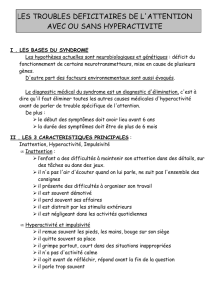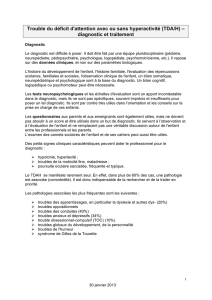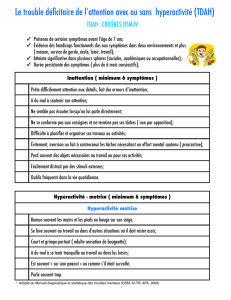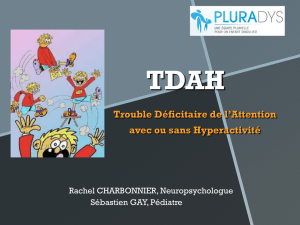Dossier Hyperactivité et trouble de l`attention chez l`enfant

Dossier
Hyperactivité et trouble
de l’attention chez l’enfant
Nancy Pionnié
Fondation Vallée, 7, rue Bensérade, 94257 Gentilly Cedex
RÉSUMÉ
Le concept d’hyperactivité a évolué tout au long du XXe siècle et a été l’objet de
nombreux travaux, tant de la part des pédopsychiatres français que de l’école
anglo-saxonne. Les idées ont fluctué quant à la vision symptomatique ou
syndromique du trouble, ainsi que quant à son étiopathogénie. Aujourd’hui, le
concept se retrouve dans les trois principales classifications diagnostiques sous
des terminologies légèrement différentes. Le diagnostic repose sur la présence
d’un trépied associant hyperactivité, impulsivité, et troubles de l’attention. Il
doit rester clinique, éliminant une pathologie plus envahissante du développe-
ment pouvant produire les mêmes symptômes. Il importe de reconnaître
cependant la fréquence des comorbidités associées à ce trouble. La compré-
hension étiopathogénique du trouble bénéficie de la multiplicité des recher-
ches : neurosciences, neuropsychologie, approche psychodynamique. Le trai-
tement devra ne pas prendre en compte uniquement les symptômes, mais
l’enfant dans la globalité de son fonctionnement psychoaffectif et de son
environnement.
Mots clés : hyperactivité, troubles de l’attention
Il s’agit d’un des motifs de consulta-
tion les plus fréquents en pédopsy-
chiatrie aux États-Unis et l’une des
formes cliniques les plus discutées
aujourd’hui, tant dans les cercles
scientifiques, que par l’ampleur de la
médiatisation de ce trouble. Tel qu’il
est désigné par la nosographie interna-
tionale, « trouble déficitaire de
l’attention-hyperactivité (TDAH) »,
issu principalement du DSM IV amé-
ricain, il renvoie à un mode de classi-
fication centré sur la description du
symptôme qui ne satisfait pas nombre
de pédopsychiatres français, soucieux
d’appréhender l’enfant dans une pers-
pective plus psychodynamique et
dans ses modalités relationnelles avec
son entourage.
Quoi qu’il en soit, c’est un trouble
autour duquel la multiplicité des ap-
proches ne peut qu’être complémen-
taire : les apports de la psychopatho-
logie d’inspiration psychodynamique
ne sont pas démentis par les apports
des recherches en psychologie cogni-
tive, en neuropsychologie et en neu-
rosciences. Ce trouble mérite une ap-
proche intégrative de la
compréhension du symptôme et de
ses déterminismes [1].
Historique du concept
C’est autour des années 1900 que
de nombreux auteurs ont commencé à
décrire l’instabilité, et il est intéressant
de constater que très rapidement se
sont posées les questions qui nous
préoccupent encore de nos jours.
Évoquons d’abord les multiples
terminologies qui se sont succédé :
m
t
p
Tirés à part : N. Pionnié
mt pédiatrie, vol. 8, n° 1, janvier-février 2005 17
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

« psychopathes instables » de Kraeplin, 1899, « écolier
instable » de Paul et Philippe Boncour (1905), « enfant
turbulent » de H. Wallon (1925), « hyperkinésie » (Eisen-
berg, 1957) ; « syndrome hyperkinétique » des auteurs
anglais, « instabilité psychomotrice » (G. Heuyer, 1914)
en France, et enfin hyperactivité.
La question de la vision syndromique ou symptomati-
que du trouble a également très vite fait débat : d’une
description initialement purement symptomatique (chez
des auteurs comme Bourneville (1897) qui décrivent ce
trouble chez des enfants arriérés), on arrive rapidement à
une conception plus syndromique, en lien non seulement
avec l’association remarquée de plusieurs types de com-
portement (hyperactivité, impulsivité, défaut d’attention)
mais aussi en fonction du risque évolutif constaté chez ces
enfants, comme le risque accru de développer des condui-
tes antisociales.
Enfin, la question de l’organogenèse ou de la psycho-
génèse a été très vite posée, avec en particulier un fort
courant organiciste pendant toute la première moitié du
XX
e
siècle. C’est un médecin anglais du nom de Still qui
parle le premier de Brain Damage Syndrom, pour décrire
une hyperkinésie motrice secondaire chez des enfants
traumatisés crâniens ou ayant eu une méningo-
encéphalite. En 1937, Bradley, un autre médecin anglais
mène une étude princeps où il montre l’amélioration
paradoxale des troubles du comportement et des perfor-
mances scolaires par la prescription d’amphétamines
(benzédrine, DL-amphétamine). C’est la première étape
dans l’hypothèse d’une participation neurobiologique
dans ce trouble.
En 1947, Strauss et Lehtinen décrivent le syndrome de
Minimal Brain Injury (lésions cérébrales a minima), attri-
buant les troubles à des lésions cérébrales a minima,
passées inaperçues, et responsables des désordres cogni-
tifs et perceptivo-moteurs chez ces enfants.
Cette notion est remplacée en 1963 par celle de Mini-
mal Brain Dysfunction de Baxs et Mackeith. L’acceptation
de l’étiologie organique est alors tellement forte que le
« dysfonctionnement cérébral minime » devient l’équiva-
lent du syndrome hyperkinétique dans la nosographie
anglo-saxonne. Ces auteurs s’appuient sur la présence de
signes neurologiques mineurs (soft signs) présents de fa-
çon plus fréquente pour étayer leur théorie.
À la fin des années 60, c’est le déclin des théories
organogéniques, au profit d’auteurs comme le célèbre
pédiatre et psychanalyste anglais, Donald W. Winnicott,
qui souligne l’aspect psychoaffectif du trouble qui témoi-
gne selon lui d’un conflit affectif non encore élaboré par
l’enfant et contre lequel il lutte. L’hyperactivité peut être
vue comme un moyen de défense pathologique pour ne
pas être submergé par des affects douloureux. Elle serait
donc plutôt à comprendre comme l’expression sympto-
matique de perturbations concernant l’organisation même
de la personnalité. Dans la même lignée, Jean Bergès et
Hubert Flavigny vont insister sur le fait que l’instabilité de
l’enfant fait appel au corps de celui qui l’apprécie, qui la
supporte. Ils posent ainsi la question de la tolérance du
milieu face à ce trouble qui « vient frapper le regard,
l’ouïe, le tact », et mettent en avant le caractère intrinsè-
quement interactif du trouble qui n’est pas « solitaire ». Ils
évoquent la dimension d’excitation corporelle peu élabo-
rable présente dans ce trouble, ainsi que le lien de dépen-
dance qui est maintenu très fortement par le fait que ces
enfants doivent être surveillés en permanence. Bref, c’est
l’aspect interactif et de pathologie du lien qui est évoqué.
Pour finir ce rappel historique, citons les travaux psy-
chopathologiques d’orientation systémique, qui mettent
en avant le rôle potentiellement stabilisateur de l’enfant
hyperkinétique permettant de maintenir l’équilibre fami-
lial en détournant par ses frasques l’attention des problè-
mes conjugaux, et faisant ainsi réaliser au couple l’écono-
mie de ses propres tensions.
Données épidémiologiques
et nosographie
Même si ce syndrome est reconnu depuis la fin du XIX
e
siècle, sa définition et ses critères ont été l’objet de nom-
breux débats. Il ne fait son entrée dans la nosographie
américaine que dans la deuxième version du Manuel
diagnostique et statistique des troubles mentaux, en 1968,
sous la terminologie « réaction hyperkinétique de l’en-
fance ou de l’adolescence ». Dans la troisième version,
c’est le trouble de l’attention qui est mis en avant, et dans
la version actuelle, quatrième édition du Manuel diagnos-
tique et statistique des troubles mentaux dit DSM IV (Ame-
rican Psychiatric Association, 1994), les deux dimensions
sont retenues avec trois sous-types : on parle alors de
« trouble déficitaire de l’attention/hyperactivité » (TDAH),
avec inattention prédominante, avec hyperactivité prédo-
minante, ou de forme mixte [2].
La dixième révision de la Classification internationale
des maladies de l’OMS (ICD-10, 1992) retient quant à elle
comme catégorie diagnostique les « troubles hyperkinéti-
ques » [3]. Quant à la classification française des troubles
mentaux de l’enfant et de l’adolescent (CFTMEA R-2000),
d’inspiration psychodynamique et qui s’inscrit dans une
approche pluridimensionnelle à travers laquelle tous les
psychiatres peuvent communiquer, elle retient le diagnos-
tic de « trouble hyperkinétique » au sein d’une catégorie
plus large de troubles des conduites et du comportement
[4]. Une enquête nationale ayant eu lieu en France en
1998 utilisant cette classification chez des enfants dits
hyperkinétiques concluait que dans deux tiers des cas, ce
syndrome était à relier à une autre pathologie (névrotique
ou organisation limite de l’enfance), et que dans un tiers
des cas seulement il constituait le diagnostic principal.
Selon le DSM IV, la prévalence du trouble est estimée
entre 3 et 5 % des enfants d’âge scolaire ; il est beaucoup
Hyperactivité et trouble de l’attention chez l’enfant
mt pédiatrie, vol. 8, n° 1, janvier-février 2005
18
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

plus fréquent chez les garçons que chez les filles, le sexe
ratio varie, selon les études, de6à9.Ceschiffres corres-
pondent à ceux obtenus en France dans une étude sur
5 000 dossiers réalisée à l’hôpital Robert Debré entre
1988 et 1995.
Diagnostic clinique
Il repose sur la présence d’un trépied symptomatique
associant hyperactivité, impulsivité et troubles attention-
nels, en l’absence de signes cliniques pouvant évoquer
des pathologies plus graves comme un trouble envahis-
sant du développement, une schizophrénie ou un autre
trouble psychotique. On ne pose pas non plus le diagnos-
tic si ces symptômes sont mieux expliqués par un autre
trouble, comme un trouble de l’humeur ou des troubles
anxieux, ni si les symptômes apparaissent dans le cadre
d’une affection médicale générale ou d’une prise médica-
menteuse (comme les bronchodilatateurs).
Ces symptômes doivent être plus sévères et plus fré-
quents que ceux observés chez des sujets d’un niveau de
développement similaire. Ils peuvent être très fluctuants,
au cours de la journée et selon les situations. Ils entraînent
une souffrance et une altération du fonctionnement sco-
laire, social ou familial.
Le diagnostic repose sur une anamnèse précise de
l’histoire des troubles, et nécessite de recouper les indica-
tions issues de l’observation directe avec ce que peuvent
en dire l’entourage, la famille ou l’école. L’évaluation
semi-quantitative et le seuil au-dessus duquel le compor-
tement est jugé excessif sont nécessairement arbitraires, et
c’est pourquoi l’expérience et le jugement clinique du
praticien sont d’une grande importance. Aucun examen
complémentaire (tests neurophysiologiques ou des ques-
tionnaires d’évaluation comme celui de Conners, pour
parents et enseignants) ne peut être considéré comme
ayant une valeur diagnostique. Ces outils sont plus desti-
nés à des études de recherche clinique, ou éventuellement
à tester l’efficacité d’un traitement médicamenteux. De
plus, en ce qui concerne les questionnaires, tous mesurent
conjointement d’autres problèmes de comportement (par
exemple la Child behavior Checklist d’Achenbach ou
inventaire des comportements de l’enfant, 1983).
En revanche, il peut être intéressant d’effectuer des
tests psychométriques (WISC-R), pour l’évaluation intel-
lectuelle, tests projectifs (comme le Rorschach ou le TAT
permettant de mieux appréhender le fonctionnement psy-
chique et la structure de la personnalité), afin d’affiner
l’approche clinique globale, indépendamment de l’aspect
comportemental des troubles. En particulier, des tests psy-
chologiques mettront en évidence une fragilité identitaire
et narcissique, orienteront le clinicien vers une compré-
hension plus symptomatique que syndromique des trou-
bles du comportement observés, et une prise en charge
plus clairement orientée vers le soutien psychothérapeu-
tique.
Les enfants hyperactifs restent difficilement assis, se
tortillent sur leur chaise, se balancent, agitent les mains ou
les pieds. Ils courent et grimpent partout. Leurs mouve-
ments paraissent désorganisés, et non pertinents par rap-
port à la situation. En classe, ils se lèvent sans permission,
jouent avec les objets qui les entourent. Ils donnent l’im-
pression d’être montés sur des ressorts. Ils veulent faire
plusieurs activités à la fois, ont du mal à suivre une
consigne.
Le manque d’attention se caractérise chez les enfants
par une difficulté à terminer une tâche, une distractibilité
élevée, des fautes d’étourderies fréquentes dans leurs de-
voirs scolaires. Ils ne prêtent pas attention aux détails,
donnent l’impression d’avoir l’esprit ailleurs. Ils changent
fréquemment d’activité, sans en finir aucune, ont du mal à
organiser leur travail, et peuvent perdre ou détériorer leurs
instruments de travail.
L’impulsivité apparaît étroitement liée à la difficulté de
soutenir l’attention. Il peut s’agir d’une impulsivité cogni-
tive ou comportementale. L’impulsivité cognitive se ca-
ractérise par une façon rapide et incorrecte de répondre à
une tâche, sans attendre la fin de la consigne ou sans
arriver à suivre les étapes successives de façon ordonnée.
Ils font des réponses prématurées ou des commentaires,
répondent quand ce n’est pas leur tour ou avant même la
fin de la question. Ces enfants prennent aussi des risques
non calculés, ce qui les rend plus susceptibles d’être
victimes d’accidents ou d’en causer. L’impulsivité com-
portementale correspond à l’incapacité de corriger ou
d’inhiber des comportements verbaux ou physiques ina-
daptés. L’impulsivité se traduit par une difficulté à obéir,
une recherche de plaisir immédiat, une impatience qui
devient problématique : faire la queue, attendre son tour.
Cet aspect de l’impulsivité crée des problèmes dans des
situations scolaires, sociales ou familiales : l’ensemble de
ces symptômes entraîne souvent des attitudes de rejet par
les pairs, ou des sanctions de la part des enseignants, qui
concourent à une image de soi négative et à une faible
estime de soi.
Comorbidités et troubles associés
Le diagnostic reste néanmoins délicat à poser en raison
de la fréquence des comorbidités.
Prenons l’exemple des troubles oppositionnels avec
provocation, présents dans environ 50 % des cas : on
pourrait se demander si les symptômes du TDAH ne sont
pas une facette de ce trouble associé. Cependant, les
études montrent bien que les symptômes TDAH ont une
évolution indépendante des troubles comorbides, et que
les formes comorbides de TDAH partagent globalement la
mt pédiatrie, vol. 8, n° 1, janvier-février 2005 19
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

même évolution que les TDAH purs et ont les mêmes
caractéristiques neuropsychologiques. On peut donc as-
sez raisonnablement parler de comorbidité sur le plan
scientifique, dans le sens d’une association plus fréquente
de deux troubles, qui ne préjuge pas du lien entre les deux.
Cela laisse la porte ouverte aux approches psychodynami-
ques qui vont tenter d’établir un lien de compréhension
entre ces associations de troubles.
L’autre trouble comorbide le plus fréquent est le trou-
ble des apprentissages, c’est-à-dire une différence entre
aptitude et réalisation dans le langage oral, écrit, orthogra-
phique et mathématique, non lié à un retard mental, un
handicap, à des facteurs sociaux ou à des troubles émo-
tionnels. Quelques chiffres indicatifs : 25 % des enfants
dyslexiques ont un TDAH, et 33 % des enfants présentant
un TDAH souffrent de dyslexie. Semblent impliqués, des
difficultés d’encodage, une diminution de la mémoire de
travail et de la mémoire de rappel, un déficit de filtre
attentionnel.
La coexistence de troubles anxiodépressifs atteint 20 à
30 %, et peut avoir un impact sur l’expression clinique du
trouble, en faisant apparaître des symptômes comme l’irri-
tabilité ou un ralentissement. Il semblerait aussi que cette
comorbidité protège de l’évolution vers des conduites
antisociales.
Perspective développementale
Même si le diagnostic est le plus souvent fait vers
6-7 ans, on croit que ce trouble apparaît dans la première
enfance. D’après certaines études, l’âge moyen d’appari-
tion des symptômes serait d’environ 3 ans, et la précocité
d’apparition des troubles serait associée à une symptoma-
tologie et une comorbidité plus sévères. Néanmoins,
beaucoup d’enfants présentent une période d’hyperacti-
vité vers 3-4 ans, qui ne persistera pas plus de 6 mois.
Dans l’anamnèse de ces enfants, on retrouve volon-
tiers une difficulté à établir des rythmes physiologiques
dans le premier semestre, des retards d’acquisition de la
propreté et du langage oral, un tempérament « éveil diffi-
cile », des crises de colère et de frustration importantes,
avec des manifestations de blocage de respiration, de
vomissements provoqués.
À l’adolescence, on observe une diminution de l’inten-
sité des symptômes pour la majorité des jeunes, qui serait
de nature développementale et peu liée aux traitements
reçus. Mais le diagnostic est difficile à établir à l’adoles-
cence, en raison du nombre élevé de défenses comporte-
mentales observées à cet âge. Par ailleurs, les symptômes
paraissent alors moins spécifiques : un sentiment de ner-
vosité, des troubles de concentration, un échec scolaire.
Par ailleurs, l’hyperactivité dans l’enfance, même si elle
s’atténue à l’adolescence, peut laisser des séquelles au
niveau de l’image et de l’estime de soi, avec des ponts vers
d’autres pathologies : troubles de la personnalité, risque
plus élevé de développer une consommation de drogues.
À l’âge adulte, 70 % des patients présentent encore de
la distractivité et de l’impulsivité ; le niveau d’études est
inférieur comparé à la population normale, le nombre de
personnalités antisociales plus élevé. Des études révèlent
des changements d’emploi plus fréquents, un niveau
socio-économique plus bas et des conflits plus fréquents
avec les pairs.
Apport des recherches
en neuroscience
Malgré le nombre impressionnant de recherches por-
tant sur les déterminismes de ce trouble, on ne retient
toujours pas de facteur étiologique précis.
Cependant, l’hypothèse la plus consistante implique le
rôle de la dopamine et de dysfonctionnements au niveau
du lobe frontal et du système réticulé, avec en particulier
l’hypothèse d’une déficience sélective d’une disponibilité
de la dopamine dans ces régions. Les déficits des lobes
frontaux toucheraient plus particulièrement les fonctions
d’inhibition et de contrôle stratégique.
Il existerait une prédisposition génétique dans l’insta-
bilité idiopathique, comme en témoignent certaines étu-
des d’agrégation familiale et de jumeaux, sans pour autant
qu’on ait pu identifier un mode de transmission. Les
hypothèses penchent vers une interaction de plusieurs
gènes impliqués dans les mécanismes dopaminergiques.
En imagerie, les études par scanner ou IRM n’ont pas
démontré de différence entre la structure des cerveaux
d’enfants étiquetés « TDAH » et celle d’enfants normaux.
Certains résultats mentionnent cependant des facteurs
neuroanatomiques non spécifiques : des anomalies mor-
phologiques des ganglions de la base et du corps calleux.
Cependant, les nouvelles techniques permettent
l’étude simultanée de la structure, du fonctionnement et
du flux sanguin cérébral. Certaines études ont ainsi mis en
évidence une hypoperfusion du lobe frontal et de la région
droite du striatum, corrigée par l’administration de mé-
thylphénidate. Ces résultats nécessitent cependant des
recherches plus poussées et une réflexion approfondie sur
les corrélations à établir entre ces anomalies fonctionnel-
les et la symptomatologie clinique.
En ce qui concerne les facteurs développementaux, on
évoque des anomalies cyto-architecturales liées à une
perturbation des processus de sélection synaptique et des
mécanismes de migration neuronale dans les circuits
fronto-striés, dont l’origine pourrait être des facteurs hy-
poxiques survenant dans la période anténatale ou périna-
tale (le striatum aurait une vulnérabilité particulière à
l’hypoxie).
Dans tous les cas de figure, les éléments constitution-
nels qu’ils soient génétiques ou neurodéveloppementaux
Hyperactivité et trouble de l’attention chez l’enfant
mt pédiatrie, vol. 8, n° 1, janvier-février 2005
20
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

ne constituent pas en soi des facteurs étiologiques mais
plutôt des facteurs de vulnérabilité qui, associés à des
facteurs socio-environnementaux pourraient favoriser
l’expression symptomatique du trouble.
Explorations neuropsychologiques
Sur le plan neuropsychologique, le concept est actuel-
lement défini comme un « spectre de dysfonctionnements
exécutifs et comportementaux apparaissant souvent en-
semble et répondant à des traitements similaires ».
On sait que c’est le système mésencéphalo-frontal qui
est à la base des mécanismes de l’attention, ce qui
confirme les hypothèses précédemment évoquées. Par
ailleurs, des analyses factorielles ont montré que le TDAH
était sous-tendu par deux dimensions distinctes que sont
les dimensions hyperactivité-impulsivité d’une part, trou-
ble de l’attention d’autre part. Au sein du concept d’atten-
tion, on peut distinguer deux dimensions, que sont la
sélectivité et l’intensité.
L’intensité de l’attention est mesurée par divers tests :
tâches de performances continues, ou tâches de concen-
tration, tests d’apprentissage pairé, etc.
L’attention sélective est un aspect qualitatif de l’atten-
tion qui évalue la sensibilité aux distracteurs externes ; le
phénomène de conditionnement sélectif qui permet de
donner priorité sur un objet plutôt qu’un autre, et met en
jeu le phénomène d’habituation (diminution de l’impor-
tance d’un signal lorsqu’il est répété) et d’interaction (in-
fluence d’un stimulus antérieur dans la perception du
stimulus actuel) : il est démontré expérimentalement que
les enfants présentant un TDAH ont un déficit de la
sélectivité attentionnelle, telle qu’elle peut être mesurée
par le test de Stroop (Stroop Color Word Test). Ce test,
sensible et robuste, crée une sorte de microconflit cognitif
dont la résolution nécessite la mise en place d’un phéno-
mène d’inhibition de la mauvaise réponse. L’hypothèse
déduite est qu’il existe un manque d’intensité des méca-
nismes d’inhibition.
Un autre test neuropsychologique, le Wisconsin Card
Sorting Test permet d’étudier la tendance à la persévéra-
tion, qui serait augmentée chez les sujets TDAH.
De nombreuses explorations ont lieu dans ce do-
maine, avec des résultats de recherche expérimentale
intéressants quoique parfois disparates, et des ponts avec
la clinique. Nous ne pouvons tous les aborder dans le
présent article, et renvoyons le lecteur au très bon ouvrage
de J. Thomas et G. Willems qui traite de l’approche
neurocognitive de ces troubles [5].
Approche psychodynamique
Il nous semble important de comprendre la place que
prend l’instabilité psychomotrice dans l’économie globale
de la personnalité de l’enfant, et d’évaluer le mode d’inte-
raction parent-enfant, si l’on veut donner aux entretiens
avec nos patients une « position rigoureusement psycho-
thérapeutique », comme le souligne Roger Misès, et ne
pas rester dans l’idée qu’un recueil objectif de données
par le psychiatre, assorti d’une prescription médicamen-
teuse, peut suffire à réduire ce trouble. En revanche, on
peut considérer que dans certaines situations, l’améliora-
tion apportée par une médication permet d’envisager une
élaboration psychodynamique qui apportera un mieux-
être dans le long terme et dans une perspective dévelop-
pementale.
Les psychodynamiciens sont tous d’accord pour envi-
sager ce syndrome sous l’angle d’une pathologie du lien
interindividuel et d’un défaut des fonctions dites de conte-
nance [6]. Ces enfants ont du mal à mettre en place un
système dit de « pare-excitation », qui permet de métabo-
liser, de psychiser les stimulations endogènes et exogènes
dont nous sommes tous bombardés, que ce soit par exem-
ple l’excitation libidinale œdipienne présente dans la
relation avec les parents, ou l’excitation liée à la sexualité
infantile et aux fantasmes ou activités masturbatoires nor-
males. Le défaut de mentalisation conduit ces enfants à
décharger leur excitation dans l’agir. Il y a ce qu’on
appelle une défaillance du champ transitionnel, de la
capacité de rêverie, qui en principe permet de traiter un
certain nombre de conflits sans les transposer dans la
réalité. Cette excitation permanente est également à met-
tre en rapport avec une difficulté à se déprimer, alors qu’il
existe une angoisse assez forte autour des craintes d’aban-
don et de séparation. Mais ce manque de sécurité interne,
plutôt que de conduire à l’expression d’une tristesse ou
d’une inquiétude, conduit à des manifestations d’attaques
du milieu, qui sont un besoin de contenance et de limite.
Le trouble hyperkinétique se rapproche assez des dyshar-
monies d’évolution où il existe une différence de maturité
assez forte entre l’intelligence, les capacités langagières et
la dimension affective qui est très fragile et immature.
D’autre part, ces enfants paraissent pris dans des rela-
tions à dominance duelle, d’abord avec la mère, puis par
extension dans leur modalité relationnelle sociale : le
besoin d’être étayé par un adulte est très présent, sinon ils
se sentent « lâchés » et activent leurs défenses par le corps
et l’agir. Dans les familles d’enfants hyperactifs, il est
souvent noté une grande proximité inconsciente de la
mère, qui peut paradoxalement avoir du mal à être mater-
nante, et qui peut se sentir envahie par des sentiments
ambivalents à l’égard de son enfant. Le père paraît souvent
comme une figure distante ou défiée. Il est très important
que l’intervention thérapeutique se situe à la fois du côté
de l’enfant par un renforcement du narcissisme et des
enveloppes contenantes, et du côté familial pour déjouer
les modalités d’interactions familiales pathogènes qui
contribuent à entretenir le trouble.
mt pédiatrie, vol. 8, n° 1, janvier-février 2005 21
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.
 6
6
1
/
6
100%