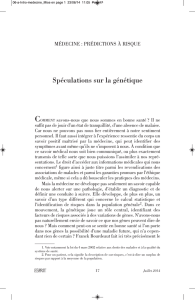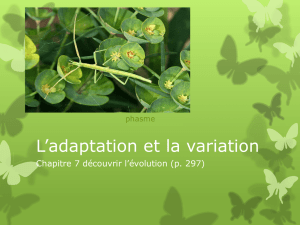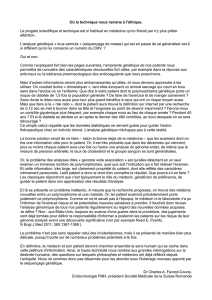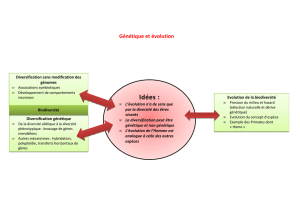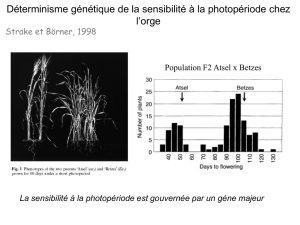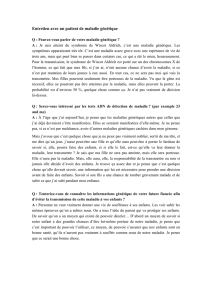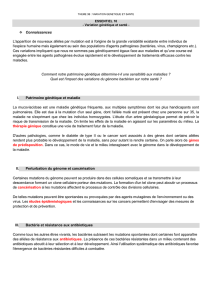1 Jean-Louis MANDEL CHAIRE DE GÉNÉTIQUE HUMAINE

1
Jean-Louis MANDEL
CHAIRE DE GÉNÉTIQUE HUMAINE
Synthèse de la leçon inaugurale
La création d’une troisième chaire de génétique au Collège de France correspond à
l’importance de cette discipline en biologie, tant au plan conceptuel que du point de
vue des méthodes et de la masse d’informations qu’elle met au service de la
compréhension du développement et de la physiologie des organismes vivants,
mais aussi de l’évolution des espèces ou de l’écologie. La génétique humaine est en
fait présente depuis plus de trente ans, sous des formes diverses, au Collège de
France. Elle répond à des préoccupations très anciennes concernant la transmission
familiale de caractères physiques ou même moraux. Son domaine est en fait
d’analyser la contribution du patrimoine génétique aux trois questions
fondamentales qui sont le titre d’un des derniers tableaux de Gauguin : D’où
venons nous ? Que sommes nous ? Où allons nous ? Questions que l’on peut
aborder pour l’espèce homo sapiens et ses populations (génétique de l’évolution et
des populations) ou au plan individuel : quels variants génétiques m’ont transmis
mes parents, et par delà, mes ancêtres plus éloignés, et quels sont les conséquences,
notamment pour ma santé présente et future.
L’histoire de la génétique humaine sera évoquée. On trouve des allusions à
l’hémophilie dans des textes du Talmud, et des descriptions précises de certaines
maladies au 19ème siècle, mais les débuts d’une approche plus interprétative et
mécanistique sont très lents, en dépit du travail fondateur de Garrod (1902, 1909). Il
faut attendre les années 1950 à 1960 pour voir se développer la génétique
biochimique, puis la cytogénétique, avec leur cortège d’applications diagnostiques,
permettant des actions au niveau individuel (conseil génétique, diagnostic prénatal)
ou de la population (dépistage néonatal systématique pour la phénylcétonurie,
dépistage des couples à risque pour les thalassémies ou la maladie de Tay-Sachs
dans certaines populations). Mais ce n’est qu’à partir de 1980 que les technologies
d’analyse directe des gènes permettent d’aborder de manière très systématique,
l’ensemble des maladies héréditaires.
Une chaire de génétique humaine se justifie aujourd’hui par l’extraordinaire
explosion de connaissances dans ce domaine au cours des 20 dernières années,
conduisant au séquençage du génome humain et à l’identification de plus de 1500
gènes dont les mutations sont responsables de maladies héréditaires, permettant
ainsi d’aborder l’étude des mécanismes conduisant de la lésion initiale (mutation) à
l’expression clinique. De nombreux résultats inattendus ont été obtenus, concernant
les mécanismes mutationnels ou la correspondance étonnamment complexe entre
mutation d’un gène et expression clinique (le phénotype). Nous évoquerons les
mutations instables par expansion de répétitions de triplets, qui ont permis
d’expliquer le phénomène d’anticipation dont la réalité biologique fut longtemps
niée par les généticiens. Ces mutations sont responsables de maladies génétiques
importantes, telles que le syndrome de retard mental avec X fragile ou la maladie
de Huntington. La présence dans le génome de répétitions de grands segments
d’ADN est responsable de syndromes dits microdélétionnels.

2
Le phénomène d’empreinte génétique, un marquage différentiel de certaines
régions chromosomiques selon qu’elles proviennent du père ou de la mère, fait
qu’une mutation affectant ces régions peut avoir des conséquences dramatiquement
différentes en fonction de l’origine parentale. Enfin, de manière très surprenante, on
a trouvé que pour certains gènes, les manifestations cliniques pouvaient être
extrêmement différentes selon la nature de la mutation présente dans ce gène. A
l’opposé, des pathologies qui apparaissaient très spécifiques par leur combinaison
unique de symptômes, présentent une hétérogénéité génétique très importante, avec
dans certains cas plus de 10 gènes dont les mutations entraînent des maladies
cliniquement non distinguables. On s’aperçoit fréquemment dans ces cas que ces
différents gènes codent pour des protéines participant à une même fonction
cellulaire. Les maladies génétiques constituent de fait un puissant moyen
d’annotation fonctionnelle du génome, auxquels contribuent les patients et leurs
familles, leurs médecins, et les extraordinaires outils d’investigation disponibles
dans tous les domaines de la pathologie.
Toutefois, la génétique humaine reste essentiellement une science d’observation, où
l’aspect expérimental réside surtout dans la mise au point des outils d’observation
et d’analyse des données, ou dans l’organisation des études de cohortes de patients.
Pour accéder à des approches expérimentales plus interventionnelles, mais aussi
pour l’interprétation fonctionnelle des données issues du séquençage, il faut
recourir à la génétique des organismes modèles, de la levure (et même quelquefois
de la bactérie E. coli) à la souris, en passant par le nématode caenorhabditis
elegans, la mouche drosophile ou le poisson zèbre.
Le séquençage du génome humain n’est qu’un point de départ pour comprendre la
fonction normale de nos gènes, et le rôle de leurs variations dans la modulation de
fonctions physiologiques et dans les pathologies qui affectent l’homme. Parmi les
champs d’investigations que nous explorerons dans notre enseignement on peut
citer : que peut apporter la génétique humaine, et notamment l’exploration des
maladies génétiques responsables de déficits intellectuels, à la compréhension des
mécanismes qui sous-tendent les extraordinaires capacités cognitives de l’homme,
domaine pour lequel la contribution des organismes modèles, bien qu’extrêmement
utile, souffre de limitations évidentes ; l’explosion des études visant à identifier les
variations géniques qui rendent compte des prédispositions géniques aux maladies
communes, qui est d’un intérêt indiscutable pour la compréhension des mécanismes
pathogéniques, pourra t’elle réellement permettre de manière générale une
médecine prédictive et des traitements personnalisés, comme souvent annoncé de
manière peut être insuffisamment critique, et ne va t’on pas vers une génétisation
excessive, ou même une génomania ; quelles sont les perspectives de traitement
pour les maladies monogéniques, de la thérapie génique aux approches
pharmacologiques classiques ou à la thérapie cellulaire ; enfin, il sera capital
d’analyser les problèmes éthiques liés aux progrès rapides des connaissances et des
possibilités techniques d’analyse des variations du génome. Ces interrogations
nécessitent évidemment des approches multidisciplinaires, qui sont l’essence même
du Collège de France.
1
/
2
100%