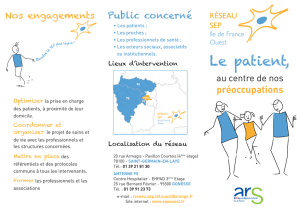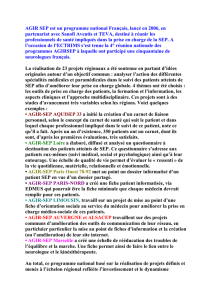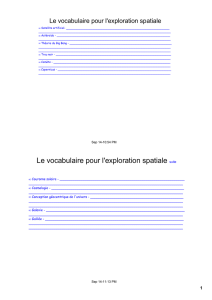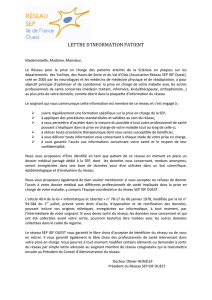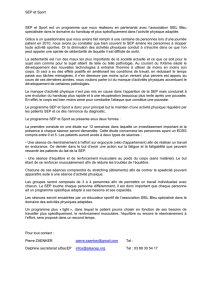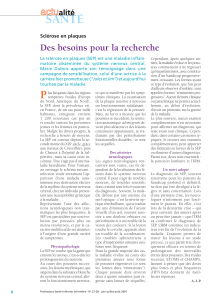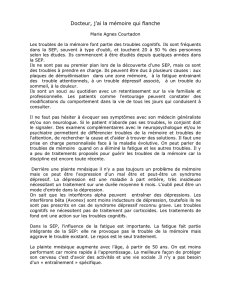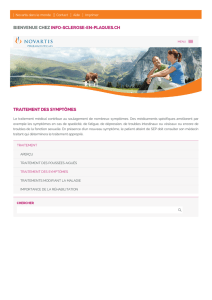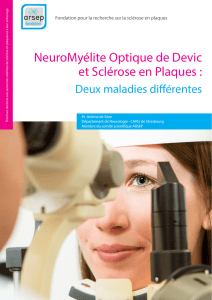Diagnostic différentiel pratique de la sclérose en plaques

La lettre du neurologue - n° 6 - vol. IV - décembre 2000 293
MISE AU POINT
e diagnostic de sclérose en plaques (SEP) repose
principalement sur des critères cliniques : il est
basé sur une atteinte du système nerveux central
(SNC), évoluant par à-coups successifs (dissémination dans le
temps), touchant des territoires nerveux distincts (dissémina-
tion dans l’espace). L’importante hétérogénéité clinique de la
maladie rend souvent le diagnostic positif difficile et requiert
l’usage d’examens complémentaires. Parmi ceux-ci, l’imagerie
par résonance magnétique (IRM) et l’analyse du liquide céphalo-
rachidien (LCR) sont les plus utiles. Cependant, comme la cli-
nique, aucun résultat paraclinique n’est spécifique de la SEP.
Cette absence de critère pathognomonique de la SEP explique
qu’un patient sur vingt suspecté de SEP est en fait porteur
d’une autre maladie, et qu’un retard diagnostique est fréquent.
En fonction des outils diagnostiques utilisés, les diagnostics
différentiels peuvent se classer en trois groupes.
PREMIER GROUPE : CLINIQUE COMPATIBLE MAIS IRM
ET LCR DISCORDANTS (
tableau I
)
La première question à poser est : les symptômes peuvent-ils
être expliqués par une lésion unique ? L’existence d’un syndro-
me médullaire isolé, sous forme de paraparésie progressive
plus ou moins associée à des troubles sensitifs et sphinctériens,
doit faire éliminer en premier lieu une compression médullaire.
La présence de cervicalgies, de signes d’atteinte nerveuse péri-
phérique (douleurs radiculaires, amyotrophie), fréquents dans
les pathologies médullaires compressives, sont rares dans la
SEP ; la disparition des réflexes cutanés abdominaux, les
troubles sexuels et sphinctériens sont précoces dans la SEP, tar-
difs et rares dans la myélopathie cervicarthrosique. Le LCR
peut montrer une discrète hyperprotéinorachie, mais sans
bande oligoclonale. L’IRM médullaire est l’examen discrimi-
nant. La malformation d’Arnold-Chiari peut également poser
des difficultés diagnostiques, en particulier lorsqu’elle prend le
masque trompeur d’une ataxie cérébelleuse, de déficits sensi-
tifs suspendus, de signes bulbaires et médullaires hauts, intri-
qués, et d’évolution parfois rémittente. Le LCR peut montrer
une discrète hyperprotéinorachie, mais sans bande oligo-
clonale. Le diagnostic dépend de l’IRM, qui montre la malfor-
mation de la charnière cranio-cervicale, sans hypersignaux de
Diagnostic différentiel pratique de la sclérose en plaques
l
K. Blanc-Lasserre*, T. Moreau*
* Service de neurologie, hôpital de la Croix-Rousse, Lyon.
nNi la clinique, ni les examens paracliniques ne sont
pathognomoniques de la sclérose en plaques.
nDans la majorité des cas, le diagnostic de sclérose en
plaques est facile, mais la moindre atypie clinique ou para-
clinique doit faire rechercher une maladie simulant la SEP.
nLes diagnostics différentiels les plus difficiles face à une
sclérose en plaques par poussées sont les maladies céré-
brovasculaires avec accidents vasculaires cérébraux répé-
tés et les maladies systémiques inflammatoires à présenta-
tion neurologique initiale.
nEn cas de doute diagnostique, l’analyse du liquide
céphalorachidien doit être systématique car l’absence de
bandes oligoclonales est un argument fort pour évoquer
une maladie simulant la sclérose en plaques.
POINTS FORTS
POINTS FORTS
L
Syndromes compressifs + + + :
- Compression médullaire
- Malformation d’Arnold-Chiari
- Autres : tumeurs, malformations vasculaires
Sclérose combinée de la moelle
Adréno-myéloneuropathie
Maladie de Whipple
Ataxies héréditaires
Tableau I. Groupe 1 mimant la SEP cliniquement mais avec LCR et
IRM discordants.

La lettre du neurologue - n° 6- vol. IV - décembre 2000
294
MISE AU POINT
la substance blanche. Les tumeurs cérébrales et les malforma-
tions artério-veineuses, en particulier du tronc cérébral, égale-
ment compressives, peuvent aussi se manifester de façon fluc-
tuante, mais l’imagerie cérébrale permet de trancher.
Les autres diagnostics à évoquer dans ce premier groupe sont
plus anecdotiques.
Un syndrome médullaire isolé peut être dû à la sclérose combi-
née de la moelle. L’association d’une paraparésie spasmodique,
d’une atteinte bilatérale de la sensibilité profonde, à une anémie
macrocytaire et mégaloblastique et à un hypersignal étendu des
cordons postérieurs à l’IRM médullaire impose le dosage de la
vitamine B12, de la gastrinémie et surtout de l’homocystéiné-
mie, meilleur reflet d’une carence fonctionnelle en vitamine
B12.
L’adréno-myéloneuropathie peut se manifester chez l’adulte
jeune par une atteinte médullaire progressive (1), associée à
une atteinte nerveuse périphérique plus discrète, laquelle en
l’absence d’antécédents familiaux connus, peut simuler une
SEP. Cependant, le LCR est habituellement normal (bien
qu’exceptionnellement des bandes oligoclonales puissent être
retrouvées) ; l’IRM est généralement bien différente de ce que
l’on voit dans la SEP, avec des plages d’hypersignal ou un
aspect en verre dépoli de la substance blanche prédominant
dans les lobes pariéto-occipitaux. Dans cette maladie hérédi-
taire liée à l’X, le diagnostic est orienté chez les homozygotes
et les femmes conductrices par le dosage des acides gras à très
longue chaîne.
La maladie de Whipple peut être de diagnostic délicat devant
une paraparésie d’évolution fluctuante, une NORB ou une
ataxie cérébelleuse ; son mode de présentation est habituelle-
ment bien différent (démence, myoclonies, ophtalmoplégie
supranucléaire, signes d’atteinte hypothalamique faisant suite
à des manifestations digestives ou articulaires). L’IRM encé-
phalique montre au mieux des hypersignaux T2 non spéci-
fiques de l’hypothalamus et des lobes temporaux ; la protéino-
rachie peut être modérément élevée, mais sans bande
oligoclonale. La recherche de macrophages PAS+ dans le LCR
permet rarement le diagnostic qui nécessite habituellement
une biopsie jéjunale ; l’atteinte isolée du SNC (5 % des cas)
impose parfois la biopsie cérébrale, avec réalisation d’une
PCR (Polymerase Chain Reaction) pour rechercher la présen-
ce de Tropheryma whippelii (2).
La SEP peut rarement être confondue avec les ataxies hérédi-
taires. Ces dernières (3) sont généralement repérables par leur
caractère familial, leur installation et leur progression très
lentes. L’absence d’anomalie sphinctérienne, l’association à
des pieds creux, à une cyphoscoliose et à des anomalies car-
diaques sont autant d’éléments orientant le diagnostic vers
une pathologie hérédo-dégénérative. L’IRM cérébrale montre
exceptionnellement des hypersignaux périventriculaires et de
la substance blanche ; dans les formes évoluées, elle objective
parfois une atrophie cérébelleuse, médullaire et du tronc céré-
bral. Dans le LCR peut exister une hyper- ou hypoprotéinora-
chie, mais sans profil oligoclonal et sans hypercytorachie.
DEUXIÈME GROUPE : CLINIQUE ET IRM COMPATIBLES,
MAIS LCR NON INFLAMMATOIRE (
tableau II
)
Le principal diagnostic différentiel dans ce groupe, et peut-
être le plus difficile en pratique, est celui d’une pathologie
cérébro-vasculaire. En effet, l’existence d’une endocardite,
d’une cardiopathie emboligène mineure, d’un état prothrom-
botique par coagulopathie, évoluant à bas bruit, peuvent par-
faitement être à l’origine d’accidents neurologiques répétés
mimant l’évolution rémittente de la SEP. L’IRM cérébrale
montre comme dans la SEP des hypersignaux T2 multiples,
mais certains indices orientent vers une maladie vasculai-
re (4) : les lésions sont plus homogènes, régulières, ne joux-
tent pas les ventricules, épargnent le corps calleux et la
région sous-tentorielle ; elles ne sont pas visibles en T1.
Dans ces cas, c’est l’absence d’inflammation du LCR qui
pousse à réaliser un bilan cardiovasculaire complet (doppler
des TSA, échographie cardiaque parfois transœsophagienne,
dosage des protéines C, S, de l’AT III, recherche d’anticoa-
gulants circulants, dosage de l’homocystéinémie, de la lipo-
protéine a, du facteur V Leyden).
La répétition d’accidents neurologiques “d’allure vasculaire”
peut correspondre à un syndrome de CADASIL (cerebral auto-
somal dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leu-
coencephalopathy) (5). Il s’agit d’une artériopathie cérébrale à
transmission autosomique dominante liée au chromosome
19q12, se manifestant préférentiellement chez l’adulte jeune
par des accidents ischémiques sous-corticaux répétés, plus
rarement par des céphalées pseudo-migraineuses ou des
troubles psychiatriques (manie ou dépression), conduisant le
plus souvent à l’installation d’une démence sous-corticale.
L’IRM encéphalique montre généralement de multiples lésions
de la substance blanche, mais dont le caractère bien limité
contraste avec l’aspect flou et confluent des lésions typiques de
SEP ; il s’y associe par ailleurs des aspects de leucoencéphalo-
pathie et d’atrophie corticale inhabituels dans la SEP. Le LCR
est habituellement normal.
La répétition d’accidents neurologiques “pseudo-vasculaires”
peut également évoquer le MELAS (acronyme de mitochondrial
encephalopathy, acidose lactique et stroke). Sur le plan clinique,
l’existence d’antécédents familiaux similaires, d’une ophtalmo-
plégie externe, d’un ptosis, d’un déficit moteur proximal, d’ins-
tallation progressive, ou enfin de crises convulsives répétées
doivent mettre en doute le diagnostic de SEP. L’IRM peut mon-
trer des lésions évoquant la SEP ; il s’y associe rarement une
Pathologie cérébrovasculaire +++
Syndrome de CADASIL
MELAS
Infection VIH
Tableau II. Groupe 2 présentant clinique et IRM compatibles avec le
diagnostic de SEP, mais avec un LCR non inflammatoire.

La lettre du neurologue - n° 6 - vol. IV - décembre 2000 295
hyperprotéinorachie, mais sans bande oligoclonale. Des dosages
répétés de l’acide pyruvique et lactique dans le sang et le LCR
doivent être réalisés au moindre doute ; la confirmation du dia-
gnostic nécessite une biopsie musculaire à la recherche de red-
ragged fibres avec analyse de l’ADN mitochondrial.
Les manifestations neurologiques de l’infection VIH peuvent
évoquer la SEP. Elles surviennent généralement à la phase tar-
dive de la maladie, mais, dans 10 % des cas, elles en représen-
tent l’entrée (7). L’IRM montre des hypersignaux T2 dans la
substance blanche périventriculaire et des centres semi-ovales
souvent semblables aux plaques de SEP, mais leur extension
progressive, l’absence de prise de contraste, l’association à une
atrophie corticale redressent le diagnostic. Chez les patients
porteurs du sida, la cytorachie et la protéinorachie sont le plus
souvent augmentées, mais les bandes oligoclonales sont inhabi-
tuelles.
TROISIÈME GROUPE CLINIQUE, IRM
ET LCR COMPATIBLES AVEC LA SEP (
tableau III
)
Il correspond avant tout aux maladies inflammatoires systé-
miques à tropisme neurologique, notamment sous forme de vas-
cularites. Bien que son mécanisme physiopathologique soit dis-
cuté, le lupus érythémateux disséminé (LED) est fréquemment
cité comme un des grands diagnostics différentiels de la SEP ; la
situation clinique la plus pourvoyeuse de confusion est la combi-
naison variable de signes médullaires et ophtalmologiques (la
classique bien qu’exceptionnelle uvéo-névraxite) pouvant évo-
luer sous forme rémittente. En pratique, la présentation explosive
et multiviscérale de la maladie, dans un contexte inflammatoire
systémique intense, est rarement trompeuse. La protéinorachie et
la cytorachie sont fréquemment élevées, mais les bandes oligo-
clonales ne sont observées que dans 25 % des cas (8). L’IRM
encéphalique peut montrer deux types de lésions : soit des hyper-
signaux multiples prédominant dans les régions sous-corticales
chez les patients sans symptômes focaux, soit de grandes plages
d’hypersignal centré sur un gros vaisseau. Il est donc difficile
avec l’IRM standard de trancher entre SEP et LED (9). Le dia-
gnostic final de LED peut être obtenu en dosant les anticorps
antinucléaires et associés ; toutefois, leurs taux doivent être inter-
prétés avec prudence, car des anticorps antinucléaires sériques
ont été retrouvés dans 25 % des cas de SEP. La polyarthrite rhu-
matoïde peut également être à l’origine d’une symptomatologie
proche de la SEP, par l’intermédiaire d’une exceptionnelle vas-
cularite créant des micro-infarctus répétés de la substance
blanche. Cependant, l’atteinte neurologique est le plus souvent
tardive et donc à l’arrière-plan des manifestations systémiques de
la maladie ; elle est, par conséquent, rarement confondue avec la
SEP. La maladie de Wegener peut être évoquée dans le même
contexte, mais c’est une pathologie rare, atteignant plutôt les
hommes, dont les manifestations neurologiques (25 à 50 % des
cas) sont plus périphériques que centrales. La recherche d’une
rhinosinusite ulcéronécrotique, d’une atteinte pulmonaire et
rénale oriente le diagnostic ; les anticorps dirigés contre le cyto-
plasme des polynucléaires neutrophiles sont très sensibles et spé-
cifiques, mais le diagnostic doit être confirmé par la mise en évi-
dence de granulomes et de signes de vascularite nécrosante sur
les prélèvements biopsiques.
À l’opposé, il est très difficile (10) de distinguer cliniquement
SEP et syndrome de Gougerot-Sjögren. Si l’atteinte du SNC
n’apparaît que chez 25 % des patients, elle peut être inaugurale
et évoluer de façon rémittente dans plus de la moitié des cas,
les signes étant le plus souvent médullaires et cérébelleux. Pour
compliquer le diagnostic, les bandes oligoclonales sont pré-
sentes dans presque tous les cas, et l’IRM encéphalique montre
des hypersignaux périventriculaires ressemblant à s’y
méprendre à ceux rencontrés dans la SEP. Il faut donc, chez ces
patients, traquer le syndrome sec, les signes d’atteinte nerveuse
périphérique et musculaire. Les anticorps anti-SSA et -SSB ne
sont pas spécifiques et ne sont présents que dans 20 à 50 % des
cas ; ils requièrent de plus l’existence d’une atteinte exocrine
importante, donc ancienne, pour apparaître. C’est pourquoi la
biopsie des glandes salivaires doit être réalisée au moindre
doute clinique et analysée avec rigueur selon les critères de
Chislow pour affirmer le diagnostic.
La sarcoïdose atteint le SNC dans environ 5 % des cas. L’at-
teinte neurologique peut être difficile à distinguer de la SEP
lorsqu’elle constitue le premier signe de la maladie (5 % des
cas). L’atteinte du nerf optique, la paraparésie progressive
représentent les tableaux les plus trompeurs, alors que les para-
lysies récurrentes des nerfs crâniens, en particulier du facial,
sont plus évocatrices. L’association aux signes neurologiques
centraux de signes d’atteinte périphérique, et bien sûr d’atteinte
systémique permet d’évoquer le diagnostic de sarcoïdose. Les
bandes oligoclonales dans le LCR ne sont présentes que dans
50 % des cas (8). L’IRM peut montrer des hypersignaux péri-
ventriculaires comme dans la SEP, mais il s’y associe une
intense prise de contraste au niveau des méninges de la base du
crâne, en particulier dans la région chiasmatique et de l’hypo-
thalamus, qui facilite le diagnostic. Le dosage de l’enzyme de
conversion dans le sang et dans le LCR est parfois utile.
Les atteintes neurologiques de la maladie de Behçet, touchant
avec prédilection le nerf optique et la moelle épinière, peuvent
être inaugurales et faire porter à tort le diagnostic de SEP. Dans
Vascularites du SNC + + + : LED
Polyarthrite rhumatoïde
Maladie de Wegener
Gougerot-Sjögren
Sarcoïdose
Behçet
Maladie de Lyme
Infection à HTLV-1
Tableau III. Groupe 3 présentant clinique, IRM et LCR compatibles
avec la SEP.

MISE AU POINT
La lettre du neurologue - n° 6- vol. IV - décembre 2000
296
la grande majorité des cas cependant, les classiques aphtes buc-
caux et génitaux, les uvéites récurrentes, les atteintes cutanées,
articulaires et les thromboses veineuses dominent le tableau.
L’étude du LCR est capitale, car les bandes oligoclonales ne
sont retrouvées que dans 8 % des cas (8) et peuvent disparaître
en dehors des poussées de la maladie. Enfin, l’IRM peut mon-
trer des hypersignaux semblables à ceux de la SEP, mais ils
prédominent nettement dans la région sous-tentorielle, en parti-
culier dans le tronc cérébral et le diencéphale (10).
La présentation neurologique de la maladie de Lyme peut
mimer la SEP. L’atteinte méningée, les paralysies des nerfs crâ-
niens, les radiculites douloureuses représentent les atteintes les
plus fréquentes ; les atteintes, encéphalitique, médullaire, céré-
belleuse, plus rares, sont les plus trompeuses. Dans la plupart
des cas, l’IRM est normale, mais des hypersignaux bilatéraux
de la substance blanche sont possibles ; leur extension au noyau
lenticulaire, leur taille souvent importante, leur association à
une prise de contraste méningée évoquent cependant le diagnos-
tic de maladie de Lyme. La sérologie de la maladie de Lyme est
utile, mais des anticorps anti-Borrelia burgdorferi se retrouvent
parfois dans d’autres maladies inflammatoires du SNC, incluant
la SEP ; seuls les anticorps synthétisés dans le SNC indiquent
de façon certaine l’existence d’une neuroborréliose.
Le diagnostic différentiel entre SEP et infection à HTLV-1 peut
parfois se poser. La paraparésie spastique qui traduit cette der-
nière débute habituellement vers quarante ans et son évolution
progressive ne peut initialement se distinguer de la forme pro-
gressive primaire de la SEP. Certaines caractéristiques ne se
rencontrent pas dans la SEP : atteinte nerveuse périphérique ou
musculaire, syndrome sec, présence de bandes oligoclonales
dans le sérum, présence dans le sang ou le LCR de lympho-
cytes multilobés, sérologie syphilitique positive, augmentation
des lymphocytes dans le LBA. Ces critères peuvent être utiles
dans les cas (rares) où le LCR contient des bandes oligoclo-
nales et où l’IRM est superposable à celle obtenue dans la SEP.
CONCLUSION
Les nouveaux traitements de la SEP imposent dorénavant un
diagnostic précoce et certain, comportant cinq critères indis-
pensables : atteinte exclusive du SNC, de nature inflammatoire,
sans inflammation systémique, avec dissémination lésionnelle,
dans l’espace, dans le temps.
Les examens paracliniques permettent d’accélérer la mise en
évidence de ces critères, malheureusement aucun d’entre eux
n’est pathognomonique de la maladie. En cas de doute diagnos-
tique, l’analyse du liquide céphalo-rachidien devra être systé-
matique à la recherche de bandes oligoclonales qui sont le plus
souvent absentes dans les autres maladies simulant la SEP. n
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
1. Turpin JC, Gray F, Baumann N. Leucodystrophies. Éditions techniques EMC
Neurologie, 1994, 17-076-D-10, 16 p.
2. Drancourt M. Tropheryma whippelii, pathogène émergent à culture intracel-
lulaire responsable de la maladie de Whipple. Presse-Med 1999 ; 28/8 : 435-9.
3. Lamy C, de Recondo. Hérédodégénérescences spino-cérébelleuses et cérébel-
leuses. Éditions techniques EMC Neurologie, 1992, 17-066-A-10, 16 p.
4. Poser CM, Paty DW, Scheinberg L et al. New diagnosis criteria for multiple
sclerosis : guidelines for research protocols. Ann Neurol 1983 ; 13 : 227-31.
5. Tournier-Lasserve E, Iba-Zizou MT, Romero N, Bousser MG. Autosomal-
dominant syndrome with strike-like episodes and leucoencephalopathy. Stroke
1991 ; 22 : 1297-302.
6. Offenbacher H, Fazekas F, Schmidt R et al. Assessment of brain MRI criteria
for a diagnosis of MS. Neurology 1993 ; 43 : 905-9.
7.Levy RM, Breseden DE. Central nervous system dysfunction in aquired immuno-
deficiency syndrome. J Aquired Immune Defic Syndr Hum Retrovirol 1988 ; 1 :
41-64.
8. MacLean BN, Miller D, Thompson EJ. Oligoclonal banding of Ig G in CSF,
blood-brain barrier function and MRI findings in patients with sarcoidosis, syste-
mic lupus erythematosus and Behçet’s disease involving the central nervous sys-
tem. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1995 ; 58 : 548-54.
9.Triulzi F, Scotti G. Differential diagnosis in multiple sclerosis : contribution of
magnetic resonance imaging techniques. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1998 ;
64 : s6-s14.
10. Alexander E. MS and Sjögren’s syndrome. Neurology 1993 ; 43 : 456.
1.Des bandes oligoclonales sont retrouvées
dans le liquide céphalorachidien :
a. Dans plus de la moitié des cas de maladie de Whipple.
b. Dans moins de 10 % des cas de maladie de Behçet.
c. Régulièrement dans le MELAS.
d.Très fréquemment dans le Gougerot-Sjögren.
e. Dans moins de 50 % des cas de neurosarcoïdose.
2.Parmi les maladies inflammatoires pouvant
simuler une SEP :
a. L’atteinte du système nerveux central dans le syndrome de
Gougerot-Sjögren survient dans un quart des cas.
b. L’existence d’anticorps antinucléaires dans le sang permet
d’éliminer formellement une SEP.
c. Une névrite optique est possible dans la maladie de Whipple.
d. Une sérologie de Lyme positive dans le sang peut être ren-
contrée dans une SEP.
e. Dans la maladie de Wegener, l’atteinte du système nerveux
central est plus fréquente que dans l’atteinte périphérique.
AUTO-ÉVALUATION
AUTO-ÉVALUATION
Résultats : 1. b - d - e 2. a - c- d
1
/
4
100%