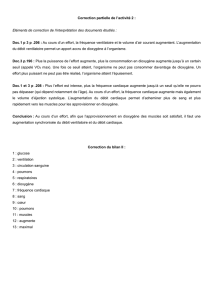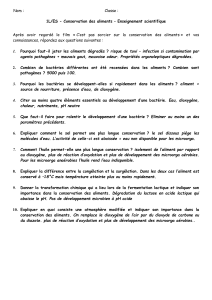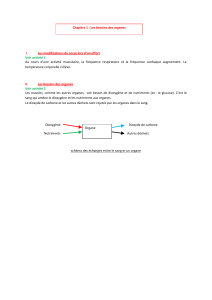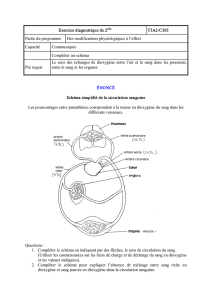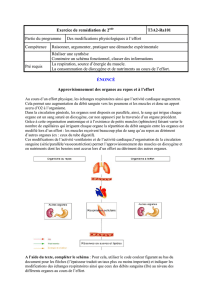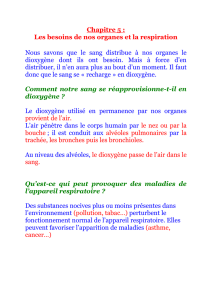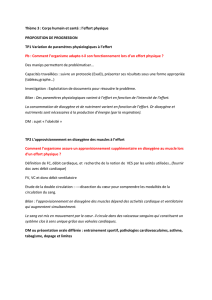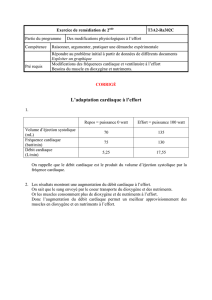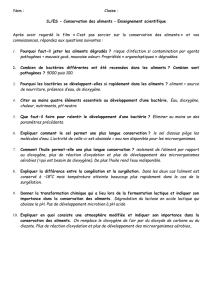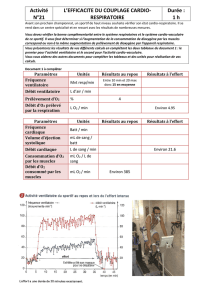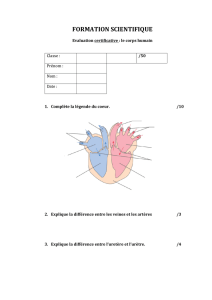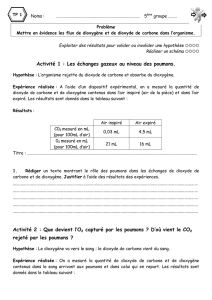Correction barème du partiel de seconde sur les mammifères

Correction barème du partiel de seconde sur l’adaptation des mammifères marins
Q1 : Observation 1 : premier compartiment le sang avec 1125 ml d’O2 justifié par :
- 4,5 L pour 30kg contre 5L pour 70kg un volume de sang beaucoup plus important par rapport à sa
taille
- 250mL d’O2/l contre 200mL d’O2/l Une concentration de dioxygène par unité de volume supérieure.
Observation 2 : second compartiment les muscles avec 270ml d’O2 justifié par :
- 45 ml d’O2 par kg au lieu de 15 ml d’O2 par kg soit trois fois plus par unité de masse.
Conclusion : les réserves d’O2 du phoque sont donc pour l’essentiel (72,5%) situées dans le sang dont le volume
et la concentration en dioxygène sont très élevés mais aussi dans les muscles (17,5%) grâce à une importante
concentration.
Q 2 : Info : la myoglobine est le transporteur principal du dioxygène dans les muscles.
Obs : proportionnalité directe entre la [globine] et le pouvoir oxyphorique (valeurs) .
Conl : le pouvoir oxyphorique supérieur des muscles des mammifères marins a pour cause la plus grande
concentration dans leurs muscles du principal transporteur de dioxygène la myoglobine.
Q3 : Obs :En plongée certains organes comme le cortex conservent pratiquement le même débit, d’autres
comme les poumons présentent une réduction de leur débit de près de 50% et enfin une dernière catégorie
d’organes comme les muscles et le pancréas présentent une réduction de près de 95% de leur débit.
Int. En plongée l’animal en réduisant le débit de certains organes (muscles et appareil digestif) économise le
dioxygène de son réservoir sanguin qui reste disponible pour des organes qui ne peuvent pas s’en passer comme
le système nerveux central.
Q4 : Schéma de la double circulation avec les organes en dérivation et la vasomotricité.
Q5 : Obs. La respiration nécessite la présence du dioxygène et du glucose.
Info : le muscle contient des réserves de glucose sous forme de glycogène
Obs. le muscle est le second réservoir de dioxygène grâce à la myoglobine
Int. La respiration peut être utilisée par le muscle qui contient avec ses réserves de dioxygène et de glucose sous
forme de glycogène tous les réactifs nécessaires à ce métabolisme.
Q6 :Obs. la fermentation lactique ne consomme pas de dioxygène et produit à partir du glucose de l’énergie
chimique et un déchet organique le lactate.
Obs. augmentation de la concentration d’acide lactique dans le sang particulièrement en fin de plongée
Int. L’apparition d’acide lactique dans le sang nous prouve que la fermentation lactique est présente.
L’augmentation brutale de cette concentration de lactate dans le sang en fin de plongée témoigne du fait que cet
acide lactique a été formé et s’est accumulé dans les organes dont la circulation avait été bloquée pendant la
plongée et parmi eux les muscles. Notre hypothèse est vérifiée : le tissu musculaire est aussi le siège d’une
fermentation lactique.
Q7 : Obs : pendant la plongée le taux de dioxyde de carbone augmente et celui du dioxygène diminue.(valeurs)
Int : Sachant que la fermentation lactique ne consomme pas de dioxygène et ne produit pas de dioxyde de
carbone la dette correspond donc aux conséquences du métabolisme respiratoire : manque de dioxygène et
excès de dioxyde de carbone.
Q8 : Définitions du débit cardiaque et du débit ventilatoire
Obs : le débit ventilatoire (nul en plongée) qui reprend à l’issue de la plongée reste supérieur à celui qui précède
la plongée pendant une durée équivalente à la plongée.
Int. Cette augmentation du débit ventilatoire permet d’augmenter le volume de dioxygène disponible au niveau
des poumons et d’éliminer une plus grande quantité de dioxyde de carbone.
Obs : la fréquence cardiaque (divisée par 7 pendant la plongée) à l’issue de la plongée reste supérieure à celle qui
précède la plongée pendant plusieurs minutes
Int : Cette tachycardie (qui s’accompagne probablement d’une augmentation du VES) permet une augmentation
du débit cardiaque. Cette augmentation de débit permet de transporter une plus grande quantité de gaz.
Conclusion : hyperventilation et tachycardie à la sortie de la plongée permettent en augmentant le débit
cardiaque et le débit ventilatoire de rembourser la dette en éliminant le surplus de dioxyde de carbone et en
rechargeant la réserve sanguine et musculaire de dioxygène
Q9 : Définition de mutation génique
Q10 : Obs : Dans cet arbre l’ancêtre commun de la vache et du dauphin est plus récent que ceux qui relient ces
deux espèces à toutes les autres.
Int : Le dauphin est donc plus proche de la vache que des autres espèces présentées.
Discussion : Mais cela ne signifie pas pour autant que la vache peut être l’ancêtre du dauphin. Ce que l’on peut
dire c’est que la vache et le dauphin dérivent d’un même ancêtre probablement tétrapode et terrestre qui a
évolué en deux branches, la première restée sur terre a donné la vache tandis que l’autre est allée mener une vie
aquatique qui a entraîné de profondes modifications anatomiques et physiologiques avant de donner le dauphin
et autres cétacés.
Conclusion : cette vision métaphorique des origines du dauphin n’est donc pas sans fondement scientifique.
TOTAL
1
/
1
100%