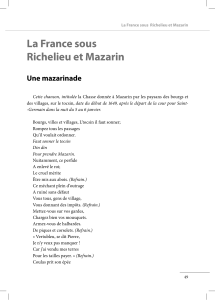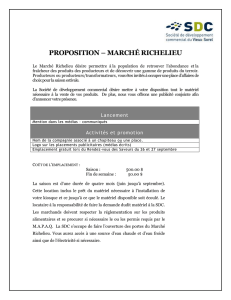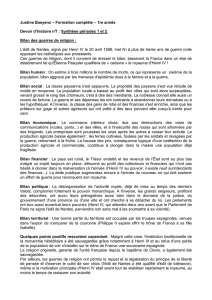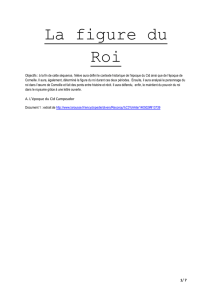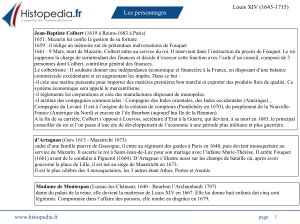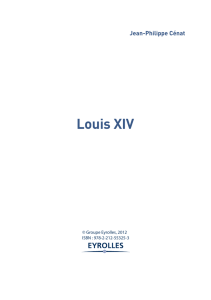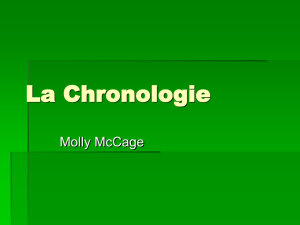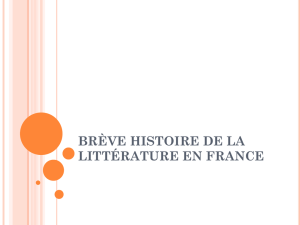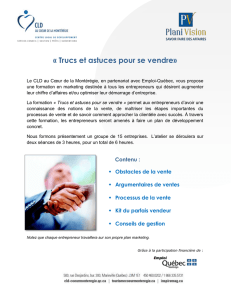Richelieu et Mazarin : Premiers Ministres en France

Richelieu et Mazarin, premiers ministres
1
Au sortir des guerres de religion, une remise en ordre s’impose en France. Le Cardinal
Richelieu, premier ministre de 1624 à 1643, détermine le destin européen de la France du XVIIe
siècle et distingue Mazarin, premier ministre de 1643 à 1661, qui lègue ensuite à Louis XIV ses
meilleurs collaborateurs. Leurs descendants couvrirent tout le « Grand Règne ». Ces deux cardinaux
établirent les fondements de l’ « absolutisme monarchique » et préparèrent l’avènement de la
puissance française en Europe ainsi que le grand règne de Louis XIV.
A. Richelieu premier ministre (1624-1643)
Son ascension politique : Le cardinal duc de Richelieu, Armand Jean du Plessis (39 ans) est remarqué
aux états généraux de 1614 par Marie de Médicis, régente et mère de Louis XIII, qui lui obtient un
poste de secrétaire d’Etat pour l’intérieur et la guerre. En 1617, l’assassinat du favori de la régente, le
marquis d’Ancre, ex-Concini, et la disgrâce de celle-ci, l’obligent à se retirer. En 1922, il réussit à
réconcilier Marie de Médicis avec son fils. Celle-ci, espérant qu’il servira ses intérêts, lui obtient alors
la baguette de cardinal et le droit d’assister aux séances du conseil du roi. Très vite, le talent et le
dévouement de Richelieu sont remarqués par le roi Louis XIII âgé de 23 ans qui lui offre au bout de
quatre mois la direction de son Conseil. Richelieu, travailleur infatigable malgré sa santé délicate, se
dévoue jusqu’à sa mort au service de l’Etat et pour la grandeur du roi en s’attachant à supprimer
toute forme d’opposition. En contrepartie le roi le protège contre de nombreuses attaques et
calomnies.
Ses objectifs politiques : Dans son testament politique, Richelieu résume en trois points la ligne
politique qu’il s’est donné quand il devint ministre : 1)« ruiner le parti huguenot » en tant que
puissance politique et militaire, 2) réduire tous ses sujets en leur devoir en « rabaisser l’orgueil des
Grands » qui prétendaient gouverner la plupart des provinces et jouer dans l’Etat un rôle qui ne leur
appartenaient pas 3) « relever le nom de roi dans les nations étrangères »en s’opposant
principalement à la plus puissante, l’Espagne.
Sa politique intérieure : La liquidation des protestants en tant que parti politique et puissance
militaire fut vite achevée. En 1625, quand le Languedoc réformé se soulève, et que La Rochelle
conclue un accord avec les Anglais, Richelieu fait construire une immense digue qui ferme l’entrée du
port de La Rochelle et permet de repousser l’aide des flottes anglaises. En 1627, les forces royales
mettent le siège devant La Rochelle qui capitule l’année suivante. Louis XIII et Richelieu descendent
ensuite dans le Languedoc où ils prennent Privas et Alès. Le 28 juin 1629, l’édit de grâce d’Alès
supprime les places de sûreté huguenotes, laissant subsister de l’édit de Nantes uniquement les
stipulations garantissant la liberté de conscience et de culte réformé. La foi calviniste est libre, mais
c’est la fin de l’Etat dans l’Etat constitué par le protestantisme. Ces dispositions procurèrent à l’Etat
quarante ans de tranquillité.
La lutte contre les « Grands » qui ne cessaient de désobéir, de comploter et de se révolter en
soulevant des provinces entières fut permanente, brutale et sans résultats décisifs. Quelques uns
furent décapités. La famille royale y avait souvent part. Gaston d’Orléans, héritier du trône jusqu’à la
naissance inattendue du dauphin Louis (1638), Anne d’Autriche peu attachée à son mari et
longtemps plus espagnole que française, Marie de Médicis, tous ont favorisé les intrigues, les
complots et les ingérences espagnoles. Pour renforcer le pouvoir royal, Richelieu interdit aux
Parlements de discuter des affaires d’Etat et il limite leur droit de remontrance, crée une armée
permanente et une administration royale dans les provinces. La multiplication des intendants qui

Richelieu et Mazarin, premiers ministres
2
reçoivent les pouvoirs des gouverneurs nobles et la soumission des parlements contribuent à assurer
l’autorité monarchique. Entre 1935 et 1938, du fait du coût de la guerre, les impôts sont multipliés
par trois. La lourde fiscalité que Richelieu impose s’ajoute à de mauvaises récoltes et à des
épidémies qui répandent la misère dans les campagnes et provoquent des révoltes qui sont
durement brisées. Les complots ne cessent pas après la mort du cardinal et du roi.
Sa politique économique : Richelieu ne prend guère de mesures en faveur de l’agriculture et de
l’industrie. Strictement mercantiliste, sa politique économique se caractérise par la rénovation de la
marine, la fondation de manufactures, et la création de compagnies de commerce extérieur qui
jettent les bases de la colonisation française (Canada, Sénégal, Madagascar). Mais aucune de ces
compagnies ne prospéra. L’objectif de ces compagnies est avant tout d’approvisionner la métropole
en sucre, une denrée de luxe obtenue traditionnellement dans les pays musulmans en échange de
métaux précieux. Cet échange est considéré comme principal facteur d’appauvrissement de l’Etat.
Richelieu s’attache de nombreux hommes de talent qui abondent en France à cette époque. Il crée
l’Académie française et soutient Théophraste Renaudot dans ses initiatives philanthropiques, utilise
pamphlets et journaux pour justifier sa politique et écrit des articles anonymes dans le premier
journal qui paraît en France en 1631, la Gazette.
Sa politique extérieure : Le processus de construction de l’Etat entamé par la monarchie à la fin du
XVe siècle puis interrompu par les guerres de religion et repris sous Henri IV, s’amplifie sous Louis
XIII. Richelieu voulait garantir la tranquillité de la France en libérant le pays de l’encerclement des
deux puissances catholiques Habsbourg qui représentent un risque pour le territoire français et en
rétablissant ses frontières naturelles (Pyrénées et Rhin). Jusqu’en 1635, l’habileté du cardinal a été
de ne pas engager ouvertement la France dans la guerre, mais de lutter discrètement par
l’intermédiaire d’alliés qu’il soutenait par des subsides. Mais alors que sa politique intérieure ruine la
puissance protestante, il s’allie avec les allemands protestants. A cause de cette politique et au nom
du parti dévot de la Cour, le 10 novembre 1630 lors de la « Journée des dupes », Marie de Médicis
adjure le roi de se séparer de Richelieu. Elle lui reproche de ménager les protestants, d’opprimer la
noblesse et de se désintéresser du bien-être du peuple. Richelieu sort vainqueur de cette journée et
obtient du roi l’éloignement de la reine-mère qui n’a de cesse de comploter et qui doit s’exiler aux
Pays-Bas. En 1935, Richelieu doit se résoudre à une participation directe à la guerre de Trente ans. Il
déclare la guerre à l’Espagne, principal soutien de l’Empereur catholique, et conquiert une partie de
l’Alsace (1638), de l’Artois (1640), puis le Roussillon (1642). En 1642, quand Richelieu meurt, peu
avant le roi, la menace d’encerclement que les Habsbourg faisaient peser sur le royaume, est en
partie écartée. Le Cardinal Mazarin à qui Richelieu laisse le gouvernement s’attache à poursuivre son
œuvre. Le choix de cette guerre détermine presque tout le XVIIe siècle français.
Richelieu mourut en 1642, haï de tous sauf du roi. Les nobles ne lui pardonnaient pas ses exécutions,
ni les Parlements sa brutalité ; beaucoup de français lui reprochaient de s’allier à des princes
protestants contre des Habsbourg catholiques ; enfin le pays entier, écrasé d’impôts, maudissait son
nom. Richelieu avait tout sacrifié à sa volonté de faire triompher l’autorité royale et de vaincre les
Habsbourg.

Richelieu et Mazarin, premiers ministres
3
B. Mazarin premier ministre (1643-1661)
Son ascension politique : Issu d’une modeste famille sicilienne, officier puis diplomate au service du
pape, Mazarin passe au service de la France en 1638 et est naturalisé français en 1639. En 1641, il
devient le principal collaborateur de Richelieu qui le fait nommer Cardinal (alors qu’il n’est pas
prêtre, ce qui est très rare) et le recommande à Louis XIII qui, en décembre 1642, le nomme ministre
d’Etat et chef du Conseil. Après la mort de Louis XIII, la régente Anne d’Autriche puis le roi Louis XIV
le maintiennent dans ses fonctions jusqu’à sa mort.
Ses objectifs : Les objectifs de Mazarin sont de gagner la guerre et de laisser à son roi et filleul qui n’a
que 5 ans à la mort de Louis XIII un trône puissant. Les historiens s’accordent pour dire qu’il aime
passionnément la France et l’a servie avec une abnégation sans limite. Il a la même politique que
Richelieu, la même énergie pour aboutir, autant de finesse, mais pour faire face aux difficultés il
préfère l’intrigue et la ruse à la brusquerie de son prédécesseur. Son extrême souplesse, son mauvais
français et son incroyable avidité indisposent beaucoup de ceux qui l’approchent. Il fut humilié,
trahi, diffamé, et régulièrement ridiculisé par ce qu’on appelait les mazarinades.
Sa politique intérieure : A son arrivée au pouvoir, alors qu’il fallait continuer la guerre, Mazarin trouve
le Trésor vide et des soulèvements dans tout le royaume comme à chaque période de régence. La
situation politique et financière est presque désespérée. Pour trouver de l’argent, il recourt aux
ventes d’offices, emprunts forcés et taxes diverses et s’attire ainsi la haine des Parisiens, d’autant
plus qu’une grave crise économique ruine beaucoup de marchands, met leurs ouvriers au chômage
et que les paysans souvent pressurisés et pillés par les soldats doivent faire face à de très mauvaises
récoltes comme celles de 1649 et de 1652. La population n’aurait cependant sans doute pas bougé, si
la noblesse de robe ne l’avait appelée à la révolte.
Pendant quatre ans, entre 1648 et 1652, Mazarin doit faire face à une période de troubles et
de guerre civile appelée « La Fronde », qui connut deux phases. La première (1648-1649), dite
« Fronde parlementaire » refuse sa décision d’imposer aux parlementaires une contribution
financière accrue. Le parlement de Paris qui n’est qu’un tribunal mais qui depuis 1643 multiplie les
remontrances, vote une déclaration qui veut limiter le pouvoir royal en supprimant les intendants et
en exigeant l’assentiment du Parlement pour toute création d’impôt ou d’office ainsi qu’avant toute
arrestation arbitraire. Le 26 août 1648, la régente indignée ayant fait arrêter l’un des parlementaires
les plus intransigeants mais très populaire, Paris se soulève et se couvre de barricades. Anne
d’Autriche et Mazarin doivent céder, remettre Broussel en liberté et supprimer les intendants.
Cependant, quelques mois plus tard, en même temps qu’elle ordonne à Condé de bloquer Paris avec
son armée, Anne d’Autriche s’enfuit discrètement à Saint-Germain avec Louis XIV et Mazarin (janvier
1649). La guerre civile commence. Mais les Parisiens se lassent vite du blocus qui rend le
ravitaillement difficile, et quand le prince de Conti propose d’appeler à l’aide les Espagnols alors en
guerre avec la France, le parlement inquiet de l’agitation populaire préfère traiter avec la régente et
Mazarin et signer la paix en mars 1649. La seconde, dite « Fronde des princes » est déclenchée par
l’arrestation en janvier 1950 de Condé et de Conti, qui convoitent la place de Mazarin. La haute
noblesse soulève la province « condéenne », et soutenue par l’Espagne, engage une véritable
campagne contre les troupes royales. Appuyés par les parlementaires, les princes libérés obtiennent
l’exil temporaire de Mazarin en 1651 et 1652. Pendant deux ans, Mazarin envoie le roi et la Régente
visiter les provinces fidèles où susceptibles de le redevenir afin de récolter des subsides et des

Richelieu et Mazarin, premiers ministres
4
hommages. Le 5 septembre 1651, date où prend fin la régence, le roi âgé de 13 ans lui demande de
poursuivre sa tâche à la tête du gouvernement. De profondes dissensions entre les coalisés que
Mazarin s’attache à brouiller et le ralliement de Turenne à Louis XIV, affaiblissent les rebelles. Condé,
accusé de trahison par Mazarin du fait de son absence injustifiable lors de la proclamation de la
majorité légale du roi, doit abandonner Paris dont il s’était rendu maître. La dernière année fut la
plus dure. L’invasion étrangère jusqu’aux portes de la capitale s’ajoutant à la guerre civile (Turenne
contre Condé, deuxième siège de Paris) et aux calamités naturelles (disettes et pestes), le Parlement
supplie alors le roi de rentrer dans la capitale. Louis XIV puis Mazarin y sont reçus en triomphe (1652-
1653). Pendant un siècle et demi, la noblesse et les parlements de Paris ne se soulèveront plus, sauf
épisodes insignifiants. La population lasse de l’anarchie souhaite un pouvoir fort. La royauté et la
position de Mazarin sortent renforcées de cette période troublée.
A partir de 1653, ayant triomphé de la Fronde, Mazarin restaure l’autorité royale et est plus
puissant qu’il n’a jamais été. Il pardonne à presque tous les ex-frondeurs en leur distribuant de
l’argent selon une vieille tradition, il rétablit les Intendants supprimés en 1648, surveille la noblesse,
limite les droits du parlement et lutte contre le jansénisme. Il s’entoure de ministres de valeur : le
surintendant des Finances Fouquet, le secrétaire d’Etat à la Guerre Le Tellier et le diplomate Hugues
de Lionne. Il ne s’oublie pas, augmente immensément sa fortune, marie aux plus grands héritiers du
royaume les cinq nièces qu’il a fait venir d’Italie et ouvre la première bibliothèque publique de France
qui porte son nom, la bibliothèque Mazarine.
Sa politique extérieure : Au milieu de ces difficultés intérieures, Mazarin a poursuivi guerre et
diplomatie. En octobre 1648, il parvient à conclure la paix avec l’Empire germanique en signant les
traités de Westphalie qui donnent au roi de France la plus grande partie de l’Alsace moins
Strasbourg, consacrent l’extrême division de l’Empire et ruinent définitivement les ambitions de
l’Empereur. Pour la première fois depuis le traité de Verdun, la frontière française atteint le Rhin. En
1858, Mazarin conclue une Ligue du Rhin dont le but est de garantir la neutralité de l’Allemagne
occidentale en cas de nouveau conflit entre Paris et Vienne. Reste l’Espagne, qui vient de reconnaître
l’indépendance hollandaise et concentre ses forces sur la France seule et divisée. La guerre traîne dix
ans. Mazarin doit appeler à l’aide l’anglais Cromwell, chef d’une république anglaise protestante, en
lui offrant Dunkerque comme salaire. Après la victoire de Turenne devant Dunkerque (1658), des
négociations s’engagent, conclues par la paix des Pyrénées (1659) qui marque le déclin de l’Espagne
et les débuts de la prépondérance française en Europe. L’Espagne abandonne à l’Angleterre
Dunkerque et l’île de la Jamaïque. La France conserve L’Artois et le Roussillon. Le mariage de Louis
XIV avec l’infante Marie-Thérèse, fille aînée de Philippe IV, est décidé. Une dot de 500 000 écus qui
ne fut jamais payée garantit la renonciation du jeune couple royal à la couronne d’Espagne. Les
historiens ont coutume de dire que la prépondérance française en Europe date de ces deux traités.
S’ils sont dus au génie de Mazarin, Mazarin a poursuivi l’œuvre de Richelieu. On peut dire qu’il n’y
eut pas un « grand cardinal », mais deux.
1
/
4
100%