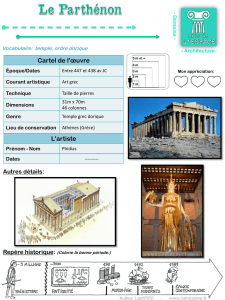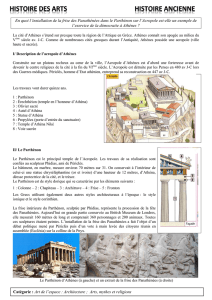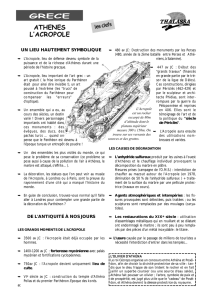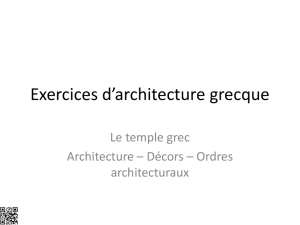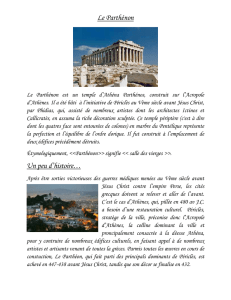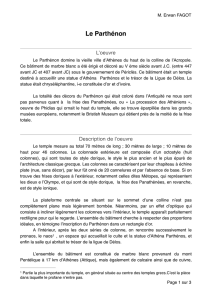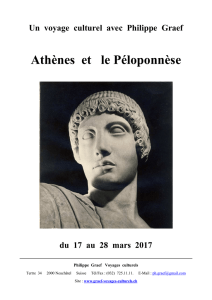l`acropole d`athènes - L`Histoire antique des pays et des hommes de

L'ACROPOLE D'ATHÈNES
PAR CHARLES ERNEST BEULÉ.
PARIS — LIBRAIRIE DE FIRMIN DIDOT FRÈRES, FILS ET Cie — 1862

CHAPITRE I. — L'Acropole avant les guerres médiques.
CHAPITRE II. — L'Acropole au siècle de Périclès.
CHAPITRE III. — L'Acropole jusqu'aux temps modernes.
CHAPITRE IV. — Fortifications de l'Acropole.
CHAPITRE V. — L'escalier des Propylées.
CHAPITRE VI. — Description des Propylées.
CHAPITRE VII. — Du caractère des Propylées.
CHAPITRE VIII. — Pinacothèque. - Piédestal d'Agrippa.
CHAPITRE IX. — Le temple de la Victoire sans ailes.
CHAPITRE X. — Intérieur de l'Acropole ; l'enceinte de Diane
Brauronia.
CHAPITRE XI. — Enceinte de Diane de Brauronia.
CHAPITRE XII. — Enceinte de Minerve Ergané.
CHAPITRE XIII. — Route des Propylées au Parthénon.
CHAPITRE XIV. — Le Parthénon.
CHAPITRE XV. — Les Frontons du Parthénon.
CHAPITRE XVI. — Les métopes du Parthénon.
CHAPITRE XVII. — La frise du Parthénon.
CHAPITRE XVIII. — La statue d'or et d'ivoire.
CHAPITRE XIX. — Extrémité orientale de l'Acropole.
CHAPITRE XX. — Plan de l'Érechthéion.
CHAPITRE XXI. — L'Érechthéion d'après les textes anciens.
CHAPITRE XXII. — Décoration de l'Érechthéion.
CHAPITRE XXIII. — Retour aux Propylées.

CHAPITRE I. — L'ACROPOLE AVANT LES GUERRES MÉDIQUES.
Sur la rive droite de l'Ilissus, à peu de distance du mont Hymette et à quarante
stades de la mer, s'élève le rocher qui fut le berceau d'Athènes et de sa religion.
C'est un plateau de forme ovale irrégulière, qui a neuf cents pieds dans sa plus
grande longueur ; il est large de quatre cents. Escarpé de toutes parts, il
présente à l'occident seulement une pente accessible, entrée naturelle que l'art
des différents âges aplanit et fortifia.
Les anciens disaient qu'avant le déluge de Deucalion un tremblement de terre
avait séparé l'Acropole du Pnyx et. du Lycabette, collines voisines, et
qu'auparavant, grâce à leur réunion, elle était plus près de l'Ilissus.
Vraisemblablement ils ne se trompaient qu'à demi : ces immenses rochers
semblent soulevés au milieu de la plaine par un même effort volcanique. La
tradition voulait que Cécrops, le premier, eût choisi l'Acropole pour demeure. Il
avait donné à la ville naissante non-seulement son nom, mais le nom d'Asty, que
seuls des Grecs les Athéniens adoptèrent, et qui semblait consacrer une parenté
avec l'Égypte. Cécrops, disait-on, était originaire de Saïs, capitale du Delta ; c'est
de là qu'il aurait apporté le culte de Neitha
(par inversion Athen)
, la vierge
victorieuse, qui, comme les femmes libyennes, couvrait sa poitrine d'une peau de
chèvre ornée de franges et teinte en rouge.
Les Athéniens essayèrent d'interpréter à leur honneur cette communauté de
mœurs et de croyances. Cécrops fut proclamé autochtone, et on le représenta
comme les fils de la Terre, moitié homme, moitié serpent. Platon, dans son
Timée, racontait que Solon, pendant son voyage en Égypte, avait fait avouer aux
prêtres mêmes de Saïs qu'Athènes était plus ancienne que leur ville de mille ans.
Callisthène et Apollonius de Tyane répétèrent à leur tour que Saïs était une
colonie grecque, et qu'elle tenait d'Athènes le culte de Minerve et son collège de
prêtres, réminiscence des Étéobutades. Lorsque l'on connaît l'orgueil national des
Grecs et particulièrement du peuple athénien, on ne s'étonne point de ces
flatteries inventées par les philosophes qui avaient adopté Minerve comme le
type le plus idéal parmi les divinités : ils préparaient ainsi un accueil favorable à
leurs théories.
Mais on voit combien le sentiment national chez les anciens mêlait à son ardeur
quelque chose d'étroit. Qu'importait après tout aux Athéniens que le culte de leur
grande divinité fût venu ou non d'Égypte ? N'était-elle pas devenue leur création
? En la parant d'une grâce céleste par leurs poétiques fictions, en lui donnant la
science, la sagesse, la valeur, la chasteté, toutes les vertus de la femme et tout
le génie de l'homme, n'avaient-ils pas effacé les traces de son origine étrangère
? Par leur piété ils avaient surpassé tous les peuples rivaux ; ils avaient quitté
leur nom pour prendre celui de leur protectrice ; le ciseau de leurs grands
artistes lui avait donné la vie et une beauté immortelle sur la terre ; ils l'avaient
fixée à jamais parmi eux en lui élevant les temples les plus magnifiques ; et
même dans l'imagination de la postérité la plus reculée, Minerve ne peut
apparaître que sur le rocher de l'Acropole et parmi les ruines du Parthénon.
Quant à l'interprétation du mythe de Minerve et des légendes qui s'y rattachent,
soit qu'on y veuille voir simplement un voile des faits historiques, ou bien la
personnification allégorique des progrès de l'agriculture et de la civilisation, ou
enfin un système astronomique et philosophique plus élevé encore, ces questions

ne peuvent trouver leur place au début de ce livre. Les arts sont ennemis des
abstractions. Ils vivent d'imagination et de poésie, mais de cette poésie qui leur
présente la forme plutôt que l'idée, la forme revêtue de fictions vivantes, de tous
ses attributs matériels. Dites à Phidias que la dispute de Neptune et de Minerve,
c'est la colonie phénicienne chassée par la colonie égyptienne ; — qu'Érechthée,
c'est le blé confié à la terre, et Pandrose la rosée qui le fait croître ; — que
Minerve, c'est l'esprit de lumière et de vie qui réside dans le soleil et la lune, et
osez lui demander ensuite des chefs-d'œuvre ! Qu'on me permette donc de
reproduire les fables qui entourent le berceau d'un peuple, d'autant plus
charmantes qu'elles sont plus naïves. Qui voudrait les dépouiller de leurs
mensonges, lorsque l'art qu'elles ont si admirablement inspiré les a en retour
consacrées et faites immortelles ?
Cécrops, par les bienfaits d'une civilisation inconnue, attira promptement autour
de lui les habitants de l'Attique, dispersés jusque-là, errants et misérables.
C'était le temps où les dieux parcouraient la terre, prenant possession des villes
où l'on devait leur rendre un culte particulier. Neptune vint le premier, et,
frappant le roc de son trident, fit paraître la mer au milieu de l'Acropole. Minerve
arriva à son tour, et, appelant Cécrops pour qu'il lui servit de témoin, planta un
olivier chargé de ses fruits. Cécrops réunit alors les hommes et les femmes
(car
alors les femmes assistaient aux assemblées)
, et recueillit les voix. Les hommes se
prononcèrent pour Neptune, les femmes pour Minerve, et, comme il s'en trouva
une de plus, la déesse l'emporta.
Neptune appela en vain de ce jugement devant les douze Dieux réunis sur
l'Aréopage. Le témoignage de Cécrops assura à Minerve une nouvelle victoire.
Dès lors elle devint la déesse protectrice de la ville, lui donna son nom et fut
honorée à Athènes plus qu'en aucun lieu de la terre. L'olivier qu'elle avait fait
naitre sur le rocher frappé par Neptune fut entouré d'une enceinte, et, auprès de
l'autel et de la statue consacrés à la déesse, on n'en éleva qu'aux dieux qui lui
étaient chers, à Jupiter Très-Haut, son père, à Vulcain son frère.
Plus tard cependant on commença à redouter le courroux de Neptune. Déjà il
avait voulu inonder l'Attique, et Mercure seul, envoyé par Jupiter, avait pu
l'arrêter. La forme de son trident empreinte sur le roc, et ce trou au fond duquel,
lorsque soufflait le vent d'Afrique, on entendait mugir la mer, semblaient une
continuelle menace. Érechthée, par le conseil de l'oracle, éleva d'abord dans
l'Acropole un autel à l'Oubli, monument de la réconciliation de Neptune et de
Minerve ; puis Neptune fut admis à partager les honneurs de la déesse.
Érechthée était né de l'amour déçu de Vulcain pour Minerve et de la Terre, qui
voulut être mère à sa place. Les Athéniens faisaient de cet événement des récits
différents, qui, s'ils blessaient fort sa pudeur, sauvaient au moins la virginité de
leur protectrice. Minerve, honteuse à la fois et touchée de compassion pour
l'enfant qui gisait à terre, résolut de l'élever en se cachant des autres dieux. Elle
le mit dans une corbeille et l'emporta dans son sanctuaire. Là vivaient les trois
filles de Cécrops, Pandrose, Aglaure et Hersé, qui s'étaient consacrées à son
culte. Un jour la déesse s'aperçut que sa ville était trop accessible du côté du
couchant. Elle alla chercher une montagne à Pellène, et confia la corbeille à
Pandrose en lui défendant de l'ouvrir. Pandrose fut fidèle ; mais ses deux sœurs,
poussées par la curiosité, découvrirent le mystère. Aussitôt une corneille alla
annoncer cette nouvelle à Minerve, qui revenait avec la montagne dans ses bras.
De surprise et de colère elle la laissa tomber : c'est ainsi que fut formé le mont
Lycabette. Hersé et Aglaure, égarées alors par une démence furieuse, se

précipitèrent du haut de l'Acropole. Pandrose, au contraire, devint plus chère
encore à Minerve, qui voulut après sa mort qu'on lui rendit les honneurs divins.
Cependant Érechthée, parvenu à l'âge d'homme, détrôna le roi Pandion. C'est
alors que, plein de reconnaissance pour sa mère adoptive, il lui éleva le temple
où elle aimait à habiter, investit Butés et sa postérité du sacerdoce, établit les
Panathénées et les courses de quadriges en l'honneur de Minerve ; enfin, il
donna à son culte l'éclat et la solennité qui se transmirent d'âge en âge. Aussi
fut-il après sa mort enseveli dans le temple même, auprès de Cécrops.
Pendant que la religion consacrait ainsi l'Acropole, la ville y grandissait peu à
peu, et, s'étendant au midi, commençait à descendre dans la plaine. Les artisans
et les laboureurs étaient établis à l'extérieur sur la pente même qui regarde
l'Ilissus. Seule, la caste des guerriers occupait le sommet, réunie par une
enceinte autour du temple de Minerve et de Vulcain. Ils s'étaient construit, du
côté du nord, des demeures communes, et y vivaient exposés à la violence du
vent, veillant sur les citoyens. Sur le plateau même de l'Acropole, il y avait une
source que plus tard les tremblements de terre firent presque complètement
disparaître, mais qui alors donnait une eau abondante, agréable à boire l'hiver
comme l'été.
C'est ainsi que Platon, dans son Critias, décrit la vie d'une cité primitive dans
toute sa simplicité. Une source, une enceinte fortifiée, les artisans qui travaillent
dans leurs demeures, les laboureurs dans les champs voisins, les guerriers sur la
hauteur qui observent la mer sillonnée par Ires pirates, ou les défilés du Parnès
franchis souvent par les belliqueux habitants d'Éleusis et de Thèbes. L'ennemi
parait-il, tous se réfugient dans l'enceinte avec leurs troupeaux et ce qu'ils ont de
plus précieux. Les fortifications n'étaient autre chose qu'une barrière de bois
entrelacée aux oliviers sauvages qui croissaient naturellement sur l'Acropole
comme sur tous les rochers de la Grèce.
Un temps vint cependant, lorsque Thésée réunit tous les habitants de l'Attique en
une seule cité, où l'Acropole fut abandonnée aux dieux et aux vieux souvenirs.
Mais elle fut toujours pour les Athéniens la Ville par excellence, l'Asty de Cécrops,
la véritable patrie. Les maisons nouvelles se groupèrent en cercle à ses pieds,
sous l'égide de Minerve ce qui faisait dire au rhéteur Aristide que l'Attique était le
centre de la Grèce, Athènes le centre de l'Attique, et l'Acropole le centre
d'Athènes. Au moment du danger, on était toujours prêt à s'y réfugier encore.
C'était une sûre forteresse, surtout depuis que les Pélasges Tyrrhéniens avaient
aplani le rocher et l'avaient entouré de ces murs célèbres dont ils couvrirent la
Grèce et l'Étrurie.
Soixante ans après la guerre de Troie, une colonie de Pélasges chassés de la
Béotie avait trouvé un asile en Attique. Pour payer l'hospitalité qu'ils recevaient,
les Pélasges fortifièrent l'Acropole, et protégèrent le côté accessible par une série
d'ouvrages qui communiquaient entre eux par neuf portes. De là le nom
d'Ennéapyle. Les Athéniens leur donnèrent en récompense des terres au pied de
l'Hymette, terres stériles, mais dont leur industrie sut tirer un excellent parti.
Deux âges d'homme ne s'étaient pas écoulés que les Athéniens, jaloux et déjà
ingrats, les chassèrent. Ils prétendirent plus tard que les Pélasges avaient fait
violence à leurs filles lorsqu'elles allaient chercher de l'eau aux Neuf-Fontaines,
et qu'on les avait surpris délibérant de s'emparer d'Athènes. Mais les dieux eux-
mêmes semblèrent punir leur mauvaise foi en rendant inutiles contre l'ennemi
ces murs, ouvrage de leurs victimes, et en les faisant servir aux projets formés
par les ambitieux contre leur liberté. Cylon, Pisistrate, Isagoras commencèrent
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
1
/
166
100%