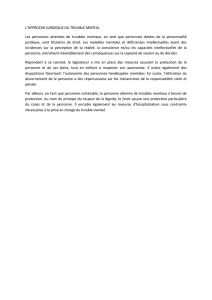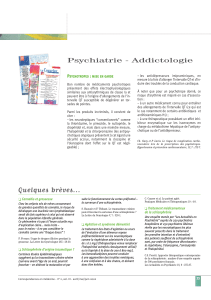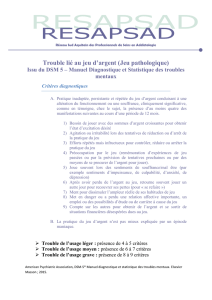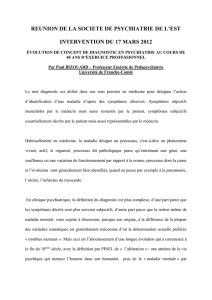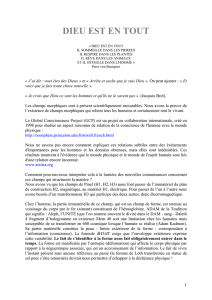La science à la barre L`utilisation de l`imagerie médicale par les

Lascienceàlabarre
L’utilisationdel’imageriemédicaleparlestribunauxmarqueledébutd’unenouvelleèreen
droitcriminel.Pourra‐t‐onmaintenants’appuyersurlesneurosciencespourdéterminerledegré
deresponsabilitéd’unaccusé?Est‐ceunecautionscientifiqueinfaillible?
ParMarineCorniou
Lajeunefemmequientredanslasalled’audiencedel’InstitutPhilippe‐Pinel,àMontréal,ne
portenimenottesniblousededétenue.Pourtant,enmai2009,cettepetitebruneausourire
timideacommisunmeurtred’uneviolenceinouïe.Enpleindélireparanoïaque,elleaassassiné
samère,lafrappantdedizainesdecoupsdecouteau.Lorsdesonprocès,enjanvierdernier,elle
aétédéclaréecoupable,maisnoncriminellementresponsable«pourcausedetroubles
mentaux».Enproieàdeshallucinationsauditivesetàdesdéliresmystiques,lajeunefemme,
quisouffredeschizophrénie,voyaitensamèrel’incarnationdudiable.Lejourducrime,des
«voix»luiontordonnédesedéfendre.
Depuisdeuxans,elleestdétenueetsoignéeentrelesmursdel’InstitutPinel,spécialiséen
psychiatrielégale,commeunecentained’autrespatientsquiontviolentéoutuéunparent,un
enfantouuninconnu.
LaCommissiond’examendestroublesmentaux(CETM),devantlaquellelajeunefemme
comparaîtaujourd’huipoursonévaluationannuelle,alatâchedélicatedemesurersa
«dangerosité».Peut‐onl’autoriseràfairequelquessorties?Àtravaillerdansuncentrede
réinsertion?C’estàcegenredequestionsquedoiventrépondreleprocureurdelaCouronne,
lesquatrepsychiatresetlepsychologueprésents.
Assiseàlatable,faceàeux,lajeunefemmealeregardhésitantetsesmainstremblentunpeu.
Maistoutporteàcroirequ’ellealedessussursamaladie.Sesmédecinsetsonpsychologuelui
ontfaitprendreconsciencedelaréalitédesestroublesetlesmédicamentsantipsychotiques
qu’elleabsorbereligieusementtouslesjoursontréussiàfairetairelesvoix.Épauléeparson
équipesoignante,elleapprendtoutdoucementàsereconstruire.
Laschizophrénien’estqu’undestroublesmentauxquipeuventunjourpousserquelqu’unà
commettrel’irréparable.Lalisteestlongue:dépression,troublesbipolaires,psychose,
psychopa‐thie;ouencore«troubledel’adaptation»avecanxiétéethumeurdépressive,le
diagnosticqu’areçulecardiologueGuyTurcotteaprèsavoirpoignardésesdeuxenfants,en
février2009.Le4novembre,ceserasontourd’êtrereçuparcetteCommission–intégréeau
tribunaladministratifdeQuébec–quidécideras’ildoitdemeureràl’InstitutPinelous’ilpeut
êtrelibéré.

Commentsavoirsiceshommesetcesfemmes,quionteuunjourunaccèsdefoliemeurtrière,
représententencoreunemenacepourlasociétéun,deux,troisoucinqansaprèslesfaits?Pour
lemoment,cesontessentiellementdesmédecinsquienjugent.Ilsévaluentlesréactionsdes
patientsensituationdestress,leursinteractionssociales,lamanièredontilscolla‐bo‐rentavec
lessoignants,l’effetdestraitements,etc.Desquestionnairesneu‐ro‐psy‐chologiqueslesaident
égalementàestimerlerisquedefuturesviolences.Lepluscourammentemployé,letest
HCR 20,prendencomptelagravitéetlanaturedesactesviolentspassés,lessymptômesactuels
dupatientetsoncontextedevie(toxicomanie,soutienfamilial,etc.).Mais,commelesouligne
ledocteurMichelFilion,undespsychiatresdel’InstitutPinelprésentsàl’audiencecejour‐là:
«Aucuneévaluationnenouspermettrajamaisd’êtresûrquelerisqueestnul.»D’ailleurs,il
n’estpasrarequedeuxexpertsarriventàdesconclusionsopposéespourunmêmemalade.
Vouspouvezlirelasuitedureportagedanslenumérodenovembre2011deQuébecScience.
1
/
2
100%