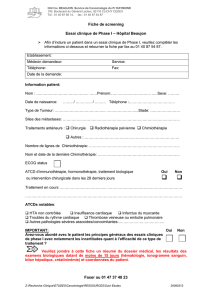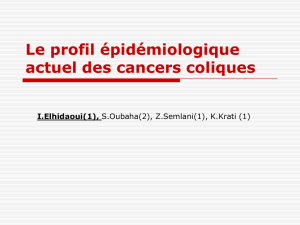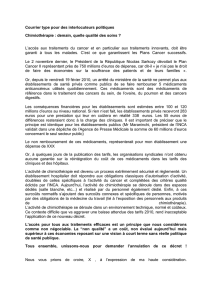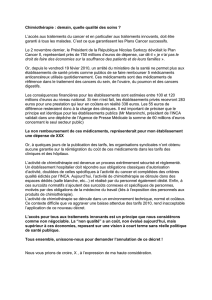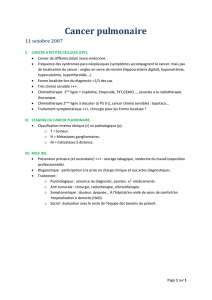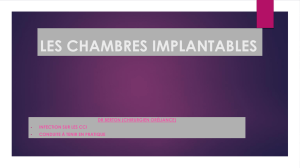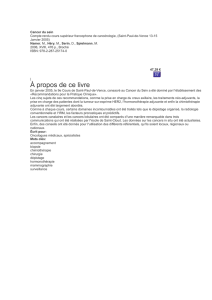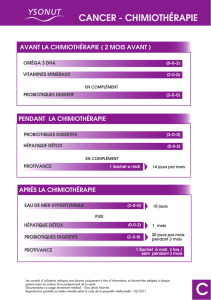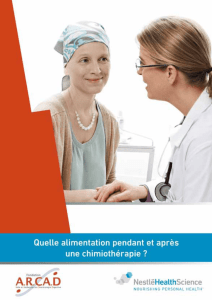Etude de pratique de la chimiothérapie dans le cancer

ARTICLE ORIGINAL Progrès en Urologie (2002), 12, 609-614
609
Etude de pratique de la chimiothérapie dans le cancer de vessie
Christine CLIPPE (1, *), Sébastien CLIPPE (2), Delphine YZEBE (3), Aude FLECHON (1), Jean-Pierre DROZ (1)
(1) Département d’Oncologie Médicale, Centre Léon Bérard, Lyon, France
(2) Département de Radiothérapie, Centre Léon Bérard, Lyon, France,
(3) Service de Pharmacologie Clinique, Faculté RTH Laënnec, Lyon, France,
(*) adresse actuelle : Unité fonctionnelle d’Oncologie Médicale, Centre Hospitalier Lyon Sud, Pierre Bénite, France
La prise en charge des tumeurs infiltrantes de vessie
demeure un problème urologique majeur. En France, plus
de 10000 nouveaux cas ont été diagnostiqués en 1995
(7815 hommes et 2290 femmes) [10]. Le traitement par
cystectomie radicale représente le traitement standard de
cette pathologie. La survie à 5 ans est d'environ 50%, tous
stades confondus, variant en fonction des stades T et N
(65 à 80% pour les T2 et 15 à 40% pour les T3-T4). Les
rechutes sont métastatiques (70 à 80% des cas) ou locoré-
gionales (20 à 30%). Le traitement des tumeurs avancées
repose essentiellement sur la chimiothérapie. La chimio-
thérapie adjuvante n'a pas encore trouvé sa place, la chi-
miothérapie néoadjuvante est l'objet de controverses. Le
développement de nouveaux traitements a amélioré la
qualité de vie des patients atteints, mais les résultats en
terme de survie globale ne sont que peu modifiés, la sur-
vie médiane se situant autour de 12 mois [13].
La majorité des séries publiées porte sur un grand
nombre de patients inclus dans des essais prospectifs.
Nous avons voulu étudier la pratique de la chimiothé-
rapie dans un seul centre. Ainsi, nous avons mené une
étude rétrospective de pratique sur l'ensemble des
patients traités par chimiothérapie soit de façon adju-
vante soit en première ligne de maladie avancée.
PATIENTS ET METHODES
Nous avons réalisé une étude descriptive sur une
cohorte rétrospective de malades enregistrés pour un
cancer de vessie au Centre Léon Bérard entre janvier
1994 et février 2000.
Les cancers de vessie ont été diagnostiqués par résec-
tion transurétrale et examen anatomopathologique. Un
examen clinique, une radiographie pulmonaire, un
scanner thoraco-abdomino-pelvien ont été réalisés
pour l’ensemble des patients. La scintigraphie osseuse
et le scanner cérébral n’étaient pratiqués qu’en cas de
point d’appel clinique. Ces examens ont permis de
déterminer le stade de ces tumeurs selon la classifica-
tion TNM de l’Union Internationale Contre le Cancer
de 1997. L’examen histologique des pièces opératoire a
permis la classification pTNM des tumeurs.
Manuscrit reçu : janvier 2002, accepté : juillet 2002.
Adresse pour correspondance : Dr. C. Clippe, Unité Fonctionnelle d’Oncologie
Médicale, Centre Hospitalier Lyon Sud, 165, Chemin du Grand-Revoyet, 69495
Pierre-Bénite Cedex.
e-mail : [email protected]
Ref : CLIPPE C., CLIPPE S., YZEBE D., FLECHON A., DROZ J.P., Prog.Urol.,
2002, 12, 609-614.
RESUME
But : Etudier la pratique de chimiothérapie dans le cancer infiltrant de vessie au sein
d'un Centre de Lutte contre le Cancer (Centre Léon Bérard).
Matériel et Méthodes : Cette étude rétrospective porte sur un ensemble de patients
traités entre 1994 et 2000 par chimiothérapie, soit adjuvante (38), soit en phase méta-
statique (66).
Résultats : Parmi les 38 patients ayant bénéficié d'une chimiothérapie adjuvante, 24
ont été traités par MVAC, 21% ont eu une neutropénie fébrile et 60% ont rechuté. La
médiane de survie sans rechute est de 12 mois. En phase métastatique, le taux de
réponse objective a été de 36% et la médiane de survie en phase avancée après trai-
tement par chimiothérapie de 10 mois. Ces résultats sont de l’ordre de ceux des
grands essais randomisés. De plus, la toxicité de la chimiothérapie est assez impor-
tante (21% de neutropénies fébriles).
Conclusion : Les études prospectives nous permettent d'optimiser les protocoles de
chimiothérapie, la pratique montre des résultats modestes, une toxicité notable. Le
rapport bénéfice/inconvénients doit être mûrement pesé.
Mots clés : Cancer de vessie, chimiothérapie, étude de pratique.

610
Pour chaque patient, les données ont été recueillies
depuis le début de la prise en charge jusqu’au
01/09/2000 (date de fin de recueil des données).
Les critères de réponse à la chimiothérapie dans les
stades avancés sont les suivants :
- réponse complète : disparition de toute lésion pendant
au moins 4 semaines
- réponse partielle : réduction ≥ 50% de la somme des
produits des diamètres perpendiculaires de toute lésion
mesurable et absence d'apparition de nouvelle tumeur
pendant au moins 4 semaines
- maladie stable : diminution de moins de 50% ou aug-
mentation de moins de 25% de la somme des produits
des diamètres de toute lésion mesurable pour au moins
8 semaines
- maladie progressive : augmentation de 25% ou plus
de la somme des produits des diamètres de toute lésion
mesurable ou apparition de nouvelles lésions.
Chimiothérapie adjuvante
Soixante-sept patients ont eu une cystectomie totale,
qui était soit une cystoprostatectomie totale chez les
hommes, soit une cystectomie seule ou associée à une
hystérectomie chez les femmes, associée à un curage
lymphonodal bilatéral ilio-obturateur pouvant
s’étendre à la bifurcation aorto-iliaque. La dérivation a
été le plus souvent de type Bricker (29 cas), parfois de
type Mayence (7 cas) ou Kock (10 cas). Les 21 autres
patients ont eu d'autres types de dérivations. Une chi-
miothérapie adjuvante a été réalisée chez 38 patients
(Tableau I).
Chimiothérapie en phase avancée
Une chimiothérapie a été administrée à 66 patients en
phase métastatique. L'âge médian au diagnostic de
maladie avancée était de 62 ans (min. 35.8- max. 77.3).
Il s'agissait de 7 femmes et 59 hommes. Soixante
quatre patients ont eu un carcinome de type urothélial,
un patient a présenté un adénocarcinome et un autre
une tumeur de type neuro-endocrine. Pour 22 d'entre
eux, le diagnostic de cancer de vessie a été réalisé à un
stade de tumeur localement évoluée, ne permettant pas
un geste curatif (4 patients pT4N+ et 4 pT4Nx), ou
d'emblée métastatique chez 14 patients. Pour les 44
autres patients il s'agissait d'une rechute de la maladie
qui avait été initialement traitée de façon curative. Les
différentes localisations tumorales sont présentées dans
le Tableau II.
RESULTATS
Chimiothérapie adjuvante
Les protocoles de chimiothérapie adjuvante utilisés ont
été les suivants : MVAC (M:Méthotrexate, V :
Vinblastine, A : Adriamycine, C : Cisplatine) (24
patients), MVACarboplatine (4 patients) , MVC (4
patients), MVCarboplatine (5 patients) et cisplatine
seul (un patient).
Pour ce qui concerne le protocole MVAC, le nombre
médian de cycles administrés a été de 4, 12 patients
(50%) n’ont pas reçu la dose totale en raison d’une
numération sanguine insuffisante provoquant l’annula-
tion des jours intermédiaires. Quatre patients (17%) ont
présenté une neutropénie fébrile, un autre a été traité
pour une infection sévère et un patient a dû interrompre
totalement son traitement en raison d'une toxicité réna-
le de la chimiothérapie.
Avec les autres protocoles, 4 patients ont présenté une
neutropénie fébrile et 5 une annulation de jours intermé-
diaires. La médiane du nombre de cycles reçus a été de 4.
Un patient traité par MVACarboplatine est décédé par
toxicité du traitement (choc septique) après son deuxiè-
me cycle, un autre a été traité pour infection grave.
C. Clippe et coll., Progrès en Urologie (2002), 12, 609-614
Tableau I. Caractéristiques des patients ayant reçu une chi -
miothérapie adjuvante.
Age médian en années 61,7 (min. 35,3-max. 75)
Sexe : Homme/Femme 37/1
Antécédents de tumeur superficielle 13
Histologie :
- Carcinome urothélial 36
- Carcinome indifférencié 2
Présence de carcinome in situ 8
pT2 7
pT3 18
pT4 13
pN0 3
pN1 14
pN2 19
pNx 2
Tableau II.Caractéristiques des patients ayant reçu une chimiothérapie en phase avancée.
Localisation tumorale Ganglions Os Foie Poumon Carcinose Cérébrale
péritonéale
Nombre de patients 37 21 18 13 5 1

Parmi ces 38 patients, 23 ont rechuté parmi lesquels 14
sont décédés d'évolution tumorale. Le délai médian de
rechute de ces patients a été de 12 mois.
CHIMIOTHERAPIE DES STADES AVANCES
Les protocoles administrés aux patients atteints de can-
cer de vessie à un stade avancé ont été les
suivants:MVAC (21 patients; 32%), carboplatine-pacli-
taxel (15; 23%), cisplatine-gemcitabine (6; 9%),
MVACarboplatine (8; 12%), CMV (4 ; 6%). Les autres
patients [12] ont reçu d’autres associations. Au total,
248 cycles de chimiothérapie ont été administrés. Le
nombre médian a été de 4 cycles par patient. Parmi les
66 patients, 19 avaient été traités par une chimiothéra-
pie lors de la prise en charge initiale de la maladie (15
chimiothérapies contenant du cisplatine, 3 contenant du
carboplatine et une inconnue).
Quatorze patients sur 66 (21%) ont présenté une neu-
tropénie fébrile au cours de leur chimiothérapie. Chez 7
patients nous avons observé une annulation des jours
intermédiaires de traitement. Deux patients ont présen-
té une septicémie. Un patient est décédé par toxicité
(insuffisance rénale) d’une chimiothérapie de type cis-
platine-ifosfamide.
La chimiothérapie a permis d’obtenir une réponse objec-
tive chez 24 patients (36%), soit 16 rémissions partielles
(24%) et 8 rémissions complètes (12%). Quatre patients
en rémission partielle et 5 patients en rémission complè-
te ont eu une radiothérapie complémentaire. Dix patients
(15%) ont eu une maladie stabilisée par la chimiothérapie
(dont 3 en association à la radiothérapie), 28 (42%) ont
progressé sous traitement (dont 4 malgré une radiothéra-
pie) et 4 patients (6%) sont non évaluables (dont 3 traités
par chimiothérapie seule).
Parmi les 49 patients traités par chimiothérapie seule,
25% ont présenté une réponse partielle et 6% une
réponse complète. La médiane de survie de ce groupe
de patients en phase avancée a été de 10 mois (Figure
1). Parmi les trois patients qui ont répondu complète-
ment à la chimiothérapie seule, deux avaient une attein-
te lymphonodale métastatique et le troisième avait une
atteinte loco-régionale. Parmi les 12 patients en rémis-
sion partielle avec chimiothérapie seule, trois avaient
une atteinte osseuse et hépatique, et trois l'une ou
l'autre, trois avaient une atteinte ganglionnaire à distan-
ce associée à une atteinte loco-régionale, deux avaient
une atteinte loco-régionale seule et un autre une carci-
nose péritonéale.
Sur l'ensemble des patients ayant rechuté (7) ou n'ayant
pas répondu (13) après cette première ligne de chimio-
thérapie en phase métastatique, 20 ont reçu une nou-
velle chimiothérapie. Pour 7 d'entre eux il s'agissait de
MVAC (la majorité d'entre eux avait été traitée par car-
boplatine-paclitaxel en première ligne), les autres ont
reçu des protocoles de chimiothérapie très divers. Onze
d'entre eux ont progressé sous traitement, 2 ont eu une
maladie stable, deux une réponse partielle, deux une
réponse complète (en association à un traitement par
radiothérapie pour des atteintes loco-régionales), trois
n'étaient pas évaluables.
DISCUSSION
Les caractéristiques des patients inclus de cette étude
correspondent à celles habituellement rencontrées dans
les séries publiées dans la littérature : l'âge médian au
diagnostic est d'environ 60 ans, la population est essen-
tiellement masculine et l'histologie est majoritairement
de type urothélial.
Les protocoles de chimiothérapie adjuvante utilisés
sont semblables à ceux qui ont été administrés à nos
patients : MVAC et CMV le plus souvent. Ces proto-
coles semblent apporter un avantage en survie dans les
tumeurs pT2, pT3, pT4 ou pN+, mais aucun essai ran-
domisé n'a permis d'affirmer un avantage significatif en
survie globale pour ce qui est de la chimiothérapie
adjuvante. La survie sans rechute à 2 ans après cystec-
tomie et chimiothérapie adjuvante est comprise entre
60% à 80% dans les différents essais publiés compre-
nant de 39 à 72 % de patients pN+ [4, 15, 19]. Dans
notre étude, la survie sans rechute à 2 ans des patients
ayant bénéficié d'une chimiothérapie adjuvante est de
23%. Il s'agit donc d'une population atteinte d'une
maladie certainement plus agressive pour laquelle le
clinicien souhaiterait optimiser le traitement afin d'évi-
ter une récidive. En effet, la population qui a été étu-
diée est à fort risque de rechute, 50% des patients étant
pN2.
Dans son étude randomisée SKINNER retrouve que les
patients avec deux ganglions envahis ou plus ont un
bénéfice moins important de la chimiothérapie adju-
vante en terme de survie globale et de survie sans réci-
dive [15]. Cependant, le bénéfice apporté par la chi-
miothérapie adjuvante en terme de survie sans récidive
peut la justifier [15].
611
Figure 1. Survie des 66 patients atteints de formes avancées et
traités par chimiothérapie.
C. Clippe et coll., Progrès en Urologie (2002), 12, 609-614

La toxicité de la chimiothérapie adjuvante ne doit pas
être négligée. Dans la littérature des taux de neutropé-
nies fébriles de 7.6% à 20% sont observés ainsi que 0 à
4% de décès toxiques [4, 15, 18]. Nous avons retrouvé
des taux similaires dans notre étude. Cette toxicité des
protocoles actuels doit nous inciter à bien peser toute
indication de chimiothérapie adjuvante. A ce jour cette
prescription ne devrait se faire que dans le cadre d'es-
sais thérapeutiques. Un essai est d'ailleurs actuellement
en préparation devant inclure 1500 patients randomisés
après cystectomie entre surveillance et 4 cycles de chi-
miothérapie : MVAC ou CDDP-Gemcitabine.
La chimiothérapie néo-adjuvante n'a pas sa place
aujourd'hui bien que deux publications récentes sem-
blent la remettre en question. En effet, les études de
l'EORTC et de SHIPLEY employant du CMV en néo-
adjuvant ou celle du groupe nordique avec une associa-
tion de doxorubicine et cisplatine, n'ont pas trouvé de
bénéfice en terme de survie globale pour les patients
recevant ce traitement [1, 8, 14 ]. Or, l'essai du SWOG
présenté à l'ASCO 2001 a retrouvé un bénéfice sur la
médiane de survie globale de près de 2 ans avec trois
cycles de MVAC en néo-adjuvant pour des patients N0
à l'inclusion, mais dont 35% étaient finalement pN+
[12]. L'essai de MILIKAN n'a pas retrouvé de différence
selon le temps de la chimiothérapie de type MVAC, soit
en adjuvant soit en néo-adjuvant et adjuvant mais a
trouvé un taux de survie sans récidive de 58% avec un
suivi de 6.8 ans pour l'ensemble des patients traités
[11]. Il s'agissait de patients atteints de tumeurs locale-
ment avancées mais résécables. Ce taux, d'après les
auteurs, aurait été de 30% par chirurgie seule.
Divers protocoles de chimiothérapie en phase avancée
sont actuellement utilisés. De nombreux essais randomi-
sés les ont comparés entre eux (Tableau III). Nous avons
observé dans notre étude une durée médiane de survie de
10 mois après le diagnostic de maladie avancée pour les
malades traités par chimiothérapie. Cette durée est infé-
rieure à celle observée dans des séries rétrospectives [3]
(13 mois) ou prospectives (14.8 mois) [20] de patients
traités par MVAC ou de patients traités par cisplatine
–gemcitabine (13.8 mois, résultat observé dans une étude
prospective) [20]. Par contre, elle est équivalente aux
résultats obtenus pour des patients traités par des proto-
coles autres que le MVAC : cisplatine en monothérapie
8.2 mois [6], CISCA 9 mois [7], CMV 7 mois [9], M-
C AVI 9 mois [2]. Ces résultats prennent en compte l’hé-
térogénéité des protocoles de chimiothérapie utilisés dans
notre étude ; près de deux tiers des patients ont été traités
par des protocoles autres que le MVAC.
Le taux de réponses objectives de 36% que nous avons
obtenu par chimiothérapie est voisin de celui observé
dans les études publiées. L
OEHRER
a trouvé un taux de
612
Tableau III. Résultats des essais de phase III menés avec les protocoles M-VAC et MCV.
Bras de traitement Nombre de patients Taux de réponses objectives Médiane de survie (mois)
MVAC contre CDDP [6] 120 39% 12,5
p<0,0001 p=0,0002
126 12% 8,2
MVAC contre CISCA [7] 54 65% 12,1
p<0,05 p=0,0003
48 46% 9
MCV contre MV [9] 108 46% 7
p<0,05 p=0,0065
19% 4,5
MVAC contre MVAC modifié 129 58% 14,1
[17] p=0,006 NS
134 73% 14,5
MVAC contre M-CAVI [2] 24 52% 16
NS 9p=0,03
23 39%
MVAC contre CG [19] 202 46% 14,8
NS NS
203 49%
MVAC : méthotrexate, vinblastine, doxorubicine, cisplatine.
CDDP : cisplatine.
CISCA : cisplatine, cyclophosphamide, doxorubicine.
CG : cislatine, gemcitabine.
NS : différence non significative.
C. Clippe et coll., Progrès en Urologie (2002), 12, 609-614

38% avec le MVAC dont 25% de réponses partielles et
13% de réponses complètes [6]. M
EAD
a obtenu un
taux de 46% de réponses objectives avec le CMV
contre 19% avec le MV [9] et B
ELLMUNT
un taux de 39
% avec le M-CAVI [2]. Notre taux reste cependant
inférieur à celui observé dans les grands essais rando-
misés et à celui d’études rétrospectives de patients
traités par le MVAC, où il varie de 46 à 65% [3,16,20].
Cette différence est certainement due à la diversité des
protocoles administrés aux patients de notre étude. En
effet, seuls 32% des patients ont bénéficié du MVAC
et 9% de l’association cisplatine-gemcitabine. Les
sites pour lesquels une réponse a été obtenue sont ceux
habituellement observés dans la littérature : adénopa-
thies, foie, poumon, os et localisations loco-régio-
nales.
La principale limite à l’administration de la chimiothé-
rapie dans le cancer de vessie avancé est sa toxicité. En
effet, le traitement optimal qui était préconisé jusqu’à
ces derniers mois était le MVAC. Or, de nombreuses
études en ont montré les effets secondaires importants
: neutropénies fébriles dans 10 à 18% des cas et décès
toxiques de 0 à 4% [2, 6, 7, 20]. Parmi les 66 patients
traités, nous avons observé des taux de neutropénies
fébriles de 21% (10% pour le MVAC à lui seul), et de
décès toxiques de 1,5%. Les éléments pouvant influen-
cer la myélosuppression sont le sexe féminin, un index
de performance (PS) bas et un traitement antérieur par
radiothérapie [5]. Parmi les patients ayant présenté une
neutropénie fébrile, nous avons compté 2 femmes, 6
personnes présentant un PS inférieur ou égal à 80% et
un patient antérieurement irradié sur le pelvis. Ces fac-
teurs de risque n’expliquent qu’en partie la toxicité du
traitement observée. Ainsi, jusqu'à la publication
récente des résultats concernant l'association cisplati-
ne-gemcitabine, une modification du protocole MVAC
était réalisée pour chaque patient pour lequel l’un des
produits était contre-indiqué. En cas d'insuffisance car-
diaque le protocole CMV était administré, en cas d'in-
s u ffisance rénale il s'agissait du protocole
MVACarboplatine et devant une certaine altération de
l'état générale il s'agissait du protocole
MVCarboplatine. Toutes ces alternatives thérapeu-
tiques étant toutes moins efficaces que le MVAC. Le
protocole cisplatine-gemcitabine a permis d’augmen-
ter le nombre de patients pouvant recevoir une chimio-
thérapie optimale. Il existe donc à présent deux proto-
coles de chimiothérapie dits standards, le MVAC et le
cisplatine-gemcitabine. Un protocole prospectif va
comparer la nouvelle référence cisplatine-gemcitabine
avec le triplet gemcitabine, paclitaxel et cisplatine.
CONCLUSION
Cette étude rétrospective permet d'analyser la pratique
courante des prescriptions de chimiothérapie d'un ser-
vice d'Oncologie Médicale et permet d'observer une
population non sélectionnée.
L'indication de chimiothérapie adjuvante doit être réa-
lisée de façon optimale dans le cadre d'un essai rando-
misé dans l'attente de résultats concluant à un avantage
en terme de survie globale. Pour les patients présentant
une atteinte lymphonodale (pN+), la décision d'un trai-
tement par chimiothérapie adjuvante devra être prise au
cas par cas.
Après analyse des résultats obtenus pour les patients en
phase avancée, ceux-ci ne sont finalement pas différents
de ceux observés dans la littérature en tenant compte de
l'hétérogénéité des traitements. Cette diversité des pro-
tocoles administrés tient compte de l'adaptation des
prescriptions du clinicien en fonction de chaque patient
et des toxicités éventuelles de chaque traitement. Les
études prospectives nous permettent d'optimiser les
protocoles de chimiothérapie, mais la réalité ne repro-
duit pas toujours les progrès observés. Cependant, la
nouvelle association cisplatine-gemcitabine permet
peut-être, grâce à sa toxicité moins importante, et à son
efficacité qui n'est pas différente de celle du MVAC
(traitement de référence) d'améliorer la qualité de vie
des patients dont l’objectif de traitement reste palliatif.
REFERENCES
1. Neoadjuvant cisplatin, methotrexate, and vinblastine chemotherapy
for muscle-invasive bladder cancer: a randomised controlled trial.
International collaboration of trialists. Lancet, 1999, 354, 533-40.
2. BELLMUNT J., RIBAS A., ERES N., ALBANELL J., ALMANZA
C., BERMEJO B., SOLE L.A., BASELGA J. Carboplatin-based
versus cisplatin-based chemotherapy in the treatment of surgically
incurable advanced bladder carcinoma. Cancer, 1997, 80, 1966-72.
3. BOUTAN-LAROZE A., MAHJOUBI M., DROZ J.P., CHARROT P.,
FARGEOT P., KERBRAT P., CATY A., VOISIN P. M . ,
SPIELMANN M., REY A., et al. M-VAC (methotrexate, vinblasti-
ne, doxorubicin and cisplatin) for advanced carcinoma of the blad-
der. The French Federation of Cancer Centers experience. Eur. J.
Cancer, 1991, 27, 1690-1694.
4. FREIHA F., REESE J., TORTI F.M. A randomized trial of radical
cystectomy versus radical cystectomy plus cisplatin, vinblastine and
methotrexate chemotherapy for muscle invasive bladder cancer. J.
Urol., 1996, 155, 495-499, discussion 499-500.
5. IGAWA M., KADENA H., UEDA M., USUI T. Association between
patient characteristics and treatment history, and toxicity associated
with methotrexate, vinblastine, adriamycin and cisplatin (M-VAC)
for advanced urothelial cancer. Br. J. Urol., 1994, 73, 263-267.
6. LOEHRER P.J., EINHORN L.H., ELSON P.J., CRAWFORD E.D.,
KUEBLER P., TANNOCK I., RAGHAVAN D., STUART-HARRIS
R., SAROSDY M.F., LOWE B.A., et al. A randomized comparison
of cisplatin alone or in combination with methotrexate, vinblastine,
and doxorubicin in patients with metastatic urothelial carcinoma: a
cooperative group study. J. Clin. Oncol., 1992, 10, 1066-1073.
7. LOGOTHETIS C.J., DEXEUS F.H., FINN L., SELLA A., AMATO
R.J., AYALA A.G., KILBOURN R.G. A prospective randomized
trial comparing MVAC and CISCA chemotherapy for patients with
metastatic urothelial tumors. J. Clin. Oncol., 1990, 8, 1050-1055.
613
C. Clippe et coll., Progrès en Urologie (2002), 12, 609-614
 6
6
1
/
6
100%