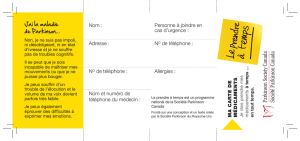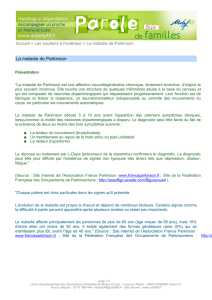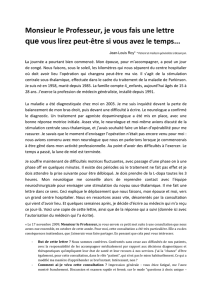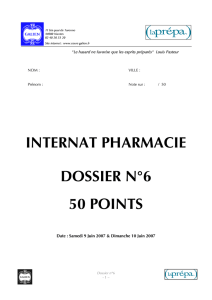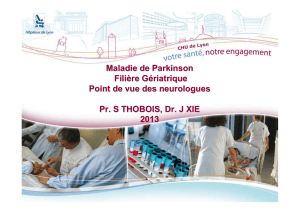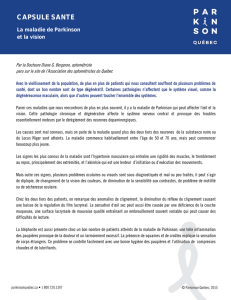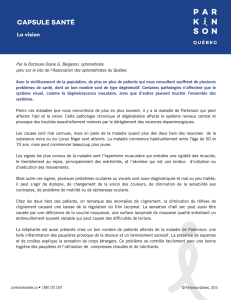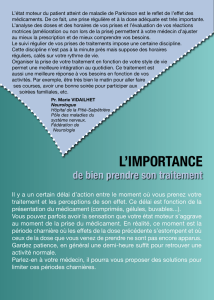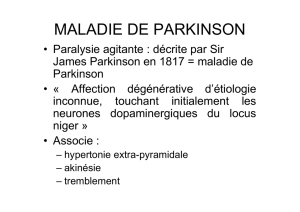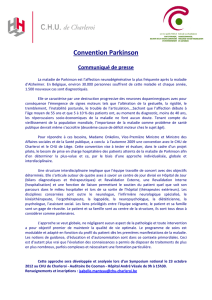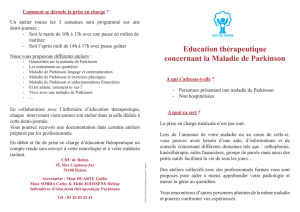La maladie de Parkinson évoluée

Synthèse
La maladie de Parkinson évoluée
Advanced Parkinson’s disease
MARC ZIÉGLER
Unité James Parkinson,
Hôpital Léopold Bellan, Paris
Résumé. Le stade de maladie de Parkinson évoluée est atteint en moyenne après 10 ans
d’évolution mais parfois après 30 ans. À ce stade, le handicap est important. Sur le plan
moteur, les signes axiaux sont prédominants : troubles de la marche, troubles de la posture
avec inclinaison du rachis, chutes, troubles de la parole et plus tardivement troubles de la
déglutition. Des fluctuations d’efficacité de la L-Dopa et des dyskinésies parfois très invali-
dantes peuvent être observées chez certains patients, posant de difficiles problèmes théra-
peutiques. Elles peuvent nécessiter l’emploi de pompe à apomorphine ou de perfusion
intra-duodénale de L-Dopa. Les troubles cognitifs sont inconstants, ils peuvent être absents
lorsque la maladie a débuté tôt. Lorsqu’ils existent, ils se manifestent par des hallucina-
tions, des périodes de confusion, des idées délirantes ou un état démentiel. À ce stade de
l’évolution, les troubles dysautonomiques sont habituels : hypersalivation, troubles diges-
tifs, urinaires, amaigrissement. Le traitement de la maladie de Parkinson évoluée oblige
parfois à l’utilisation de contradictions pharmacologiques, par exemple : pompe à apomor-
phine et clozapine.
Mots clés : maladie de Parkinson, stade de Hoehn et Yahr, L-Dopa, démence, chutes
Abstract. The stage of advanced Parkinson’s disease usually occurs 10 years after the
diagnosis but sometimes after 30 years. It is characterized by a severe handicap with gait
disorders, posture changes, speech abnormalities and deglutition perturbations. Cognitive
disorders (hallucinations, delirium, delusions, dementia) did not occur in all patients.
Dysautonomic disorders are usual. Treatment is difficult and may include paradoxical
prescriptions such as both apomorphine pump and clozapine.
Key words:Parkinson’s disease, Hoehn and Yahr stages, L-Dopa, dementia, falls
Progression de la maladie
et définition d’une maladie
de Parkinson évoluée
Pour tenter de définir ce que l’on entend par mala-
die de Parkinson évoluée, il convient de revenir sur la
progression de la maladie de Parkinson, son histoire
naturelle [1], afin de mesurer la diversité des situations
cliniques.
Schématiquement on reconnaît à cette affection
trois stades évolutifs :
1) la maladie débutante : période des premiers signes,
du diagnostic, du traitement initial et de la « lune de
miel » ;
2) la maladie installée : la « lune de miel » est termi-
née. Pour la majorité des patients, c’est la période des
fluctuations d’efficacité et des dyskinésies qui peut
s’étaler sur plusieurs années ;
3) la maladie évoluée : le handicap est important, cor-
respondant aux stades 4 et 5 de Hoehn et Yahr.
Il existe bien d’autres propositions de classification
des différents stades de la maladie de Parkinson. L’une
d’entre elles, résultant d’une étude ayant porté sur 73
patients suivis pendant une durée moyenne de la mala-
die de 14,6 ans [2] définit 4 phases et leur durée respec-
tive : 1) diagnostique, 1,5 ans ; 2) entretien, 6 ans ; 3)
difficultés, 5 ans ; 4) soins palliatifs, 2,2 ans. Cette clas-
sification a le mérite d’introduire la notion de soins
palliatifs, notion qui suggère la nécessaire modification
de la prise en charge de tels patients.
Il est admis que l’évolution de la maladie est paral-
lèle à la dégénérescence de la voie dopaminergique
nigro-striée. En progressant, les lésions diffusent et
touchent d’autres structures, en particulier le tronc
cérébral, les structures limbiques et le cortex, ce qui
explique la présence des signes tardifs.
On sait également qu’il existe une grande variabilité
évolutive d’un patient à l’autre. En revanche, chez un
patient donné, la progression de la maladie semble
linéaire [3].
Psychol NeuroPsychiatr Vieil 2006;4(n
o
spécial 1) : S5-S10
doi: 10.1684/pnv.2006.0030
Psychol NeuroPsychiatr Vieil, vol. 4, n° spécial 1, décembre 2006 S5
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 23/05/2017.

Hoehn et Yahr, en 1967, peu de temps avant l’arri-
vée de la L-Dopa, ont étudié 204 patients suivis de 1950
à 1964 et précisé le temps mis pour parvenir à chaque
stade de handicap [4] :
– le stade 1 est atteint en 3 ans,
– le stade 2 est atteint en 6 ans,
– le stade 3 est atteint en 7 ans (± 6 ans),
– le stade 4 est atteint en 9 ans (± 7 ans),
– le stade 5 est atteint en 14 ans en moyenne (± 3 ans),
en6à10anspour 61 % des patients et en 10 à 15 ans
pour 83 % des patients.
Ils précisaient que 28 % étaient déjà au stade 5 en
moins de 5 ans (ce qui pose la question du diagnostic
et de l’inclusion d’éventuels syndromes parkinsoniens)
et 34 % étaient encore au stade1à2après 10 ans
d’évolution (maladie peu évolutive).
Ces différentes données ne permettent pas de
donner une définition précise de la maladie évoluée,
mais incitent à prendre en compte en premier lieu le
handicap : par exemple le stade 4 et 5 de Hoehn et
Yahr. Il faut aussi tenir compte de la durée de l’évo-
lution (plus de 10 ans d’évolution) ou bien choisir le
début des chutes qui annonce la période de déclin
moteur.
Description type d’une maladie
de Parkinson évoluée
Le diagnostic remonte à une quinzaine d’années, la
lune de miel a duré environ 8 ans, puis des blocages
moteurs sont apparus en même temps que des dyski-
nésies.
Les troubles moteurs ont progressé. Ceci est visible
sur le score moteur de l’UPDRS et les échelles de han-
dicap (tableau 1). Ce tableau illustre les propos qui pré-
cédent. Il s’agit d’une courte étude faite dans un service
de neurologie, non publiée, portant sur 40 patients pris
au hasard dans notre population de 800 patients suivis
en consultation. Elle avait pour but d’identifier les para-
mètres de base par durée d’évolution, 10 patients ont
été évalués par groupe. On constate l’augmentation
régulière des paramètres. Certains sont particulière-
ment importants : le score moteur de l’UPDRS, le nom-
bre de chutes, le temps de marche sans s’asseoir, le
nombre de prises de L-Dopa. En ce qui concerne le
score moteur de l’UPDRS, 25/108 n’est pas un score
important, contrastant avec le stade 4 de Hoehn et
Yahr. Ceci s’explique par le fait que les signes axiaux
participent faiblement au score total de l’échelle mais
entraînent une importante réduction de l’autonomie. Le
score moteur de l’UPDRS doit donc être complété par
une évaluation de la gêne fonctionnelle comme le
stade de Hoehn et Yahr ou l’échelle Handipark [5]. Il
reste néanmoins un acteur important de la prise en
charge des patients, aidant souvent à la prise de déci-
sion thérapeutique.
La progression de la maladie de Parkinson ne se
limite pas à une simple accentuation des signes de
début, elle s’enrichit de nouveaux symptômes, en par-
ticulier des signes axiaux : piétinement au démarrage,
inclinaison du tronc, instabilité posturale, dysarthrie et
chutes [6].
Les troubles cognitifs sont inconstants. Si la mala-
die a débuté tôt, ils peuvent être absents. Sinon, il
s’agit d’hallucinations, de confusion fluctuante et de
démence.
Les troubles neurovégétatifs touchent surtout la
digestion (reflux gastro-œsophagien, constipation,
fécalome), la miction, la salivation et la tension arté-
rielle [7].
Le traitement par la L-Dopa est moins efficace, les
fluctuations d’efficacité (effets on-off) et les dyskinésies
ont tendance à diminuer d’intensité au fil des ans, lais-
sant place à une diminution de l’efficacité de la L-Dopa
[8].
La tolérance au traitement est moins bonne, compli-
quée par des troubles cognitifs et une hypotension
orthostatique.
À ces symptômes s’ajoute l’effet de l’âge et des
pathologies associées.
Ainsi de telles situations peuvent se rencontrer
après 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans d’évolution. Plus la
durée est longue moins la maladie est évolutive.
Tableau 1.Progression de la maladie de Parkinson chez
40 patients. Données personnelles non publiées.
Table 1. Longitudinal study of 40 patients with Parkinson’s
disease. Non published personal data: 1, 5, 10, 15 years of
follow-up.
1 an 5 ans 10 ans 15 ans
A
ˆge 68 76 70 77
UPDRS moteur 8,4 18 16 23
St H/Y 1,2 2,9 3,2 4
Handipark 1,8 5,6 6 7
Marche (min) 144 88 74 34
Chutes/mois 0 0,06 2,5 16
L-Dopa (mg/j) 77 350 780 880
Nombre de prises/j 0,9 3,5 5,2 5,7
M. Ziégler
Psychol NeuroPsychiatr Vieil, vol. 4, n° spécial 1, décembre 2006S6
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 23/05/2017.

Particularités cliniques
des maladies de Parkinson
évoluées
Les fluctuations d’efficacité et les dyskinésies
Elles sont traitées dans ce même numéro par Phi-
lippe Damier. Ces complications ont cependant quel-
ques particularités lorsque la maladie est très évoluée.
Les fluctuations d’efficacité ne sont plus aussi réguliè-
res qu’auparavant avec des prises de L-Dopa parfois
inefficaces, alors que d’autres prises déclenchent des
dyskinésies souvent intenses. Tout cela est provoqué
par la même quantité de L-Dopa par prise, qui peut
parfois être très faible (25 à 50 mg). Il en résulte des
journées pendant lesquelles la motricité est imprévisi-
ble, ce qui est d’autant plus difficile à supporter. Ceci
est probablement en rapport avec, d’une part, une
motricité digestive perturbée par la longue maladie et,
d’autre part, par d’importants désordres de la libération
de la dopamine au niveau synaptique et enfin, par des
variations de sensibilité des récepteurs dopaminergi-
ques pré et post synaptiques. Adapter la répartition de
la L-Dopa devient alors acrobatique, avec parfois 10 à
15 prises par jour, ce qui peut justifier l’utilisation de
l’apomorphine en perfusion continue (par pompe) [9]
ou de perfusion continue intra-duodénale de L-Dopa
[10].
Les troubles de la marche
La marche est toujours très perturbée soit par des
petits pas, soit par les pieds qui traînent, auxquels
s’ajoute le piétinement. Celui-ci semble inexorable : il
apparaît tôt ou tard. Ce signe est particulièrement
gênant car il peut entraîner des chutes, réduit l’autono-
mie et est peu sensible au traitement. Un surdosage en
L-Dopa peut le majorer.
L’instabilité posturale est présente à ce stade de la
maladie avec parfois une tendance à la rétropulsion.
Elle peut entraîner des chutes, habituellement vers
l’arrière lorsque le patient est immobile.
Les chutes
Elles annoncent la réduction de l’autonomie [11].
Elles ont plusieurs mécanismes : soit l’instabilité (chute
vers l’arrière), soit le piétinement au démarrage et le
freezing (chute vers l’avant), soit le piétinement au
demi-tour (chute sur le côté). Plus rarement, elles sont
dues à une hypotension orthostatique.
Les difficultés axiales provoquent une gêne pour se
lever d’un siège, sortir d’une voiture, se retourner dans
le lit. À ce stade, tous ces mouvements sont souvent
impossibles à réaliser seuls.
Les troubles de la posture
Ils sont également constants à ce stade : attitude
penchée vers l’avant, genoux à demi fléchis.
Certains patients, peu nombreux, présentent une
inclinaison du tronc très particulière. Cette inclinaison
se fait vers l’avant ou sur le côté (pas forcément vers le
côté le plus atteint). Elle s’installe assez rapidement, en
quelques mois, sans aucun signe annonciateur, après
plusieurs années d’évolution. Ensuite, elle peut se sta-
biliser mais gêne considérablement la marche car cette
inclinaison peut atteindre 90°. Par la volonté, le patient
peut se redresser quelques instants. Ce trouble de la
posture est majoré lorsque le patient est occupé à exé-
cuter une tâche (par exemple pendant le repas).
Allongé, il est totalement réductible. Les douleurs sont
variables, parfois absentes, ce qui est un peu curieux
compte tenu de l’ampleur de la déformation. Certains
patients sont améliorés par la pose d’un corset. Dans
un tiers des cas, on retrouve une scoliose ancienne.
Les déformations des extrémités
Elles sont fréquentes, voire constantes. Elles prédo-
minent du côté le plus atteint et ne touchent pas les
formes les plus hypertoniques, les formes tremblantes
en sont généralement épargnées. Au niveau de la main
elles réalisent une main pseudo-rhumatismale, une
main d’écrivain, une main de fakir. Au niveau des pieds,
la déformation la plus fréquente est le pied en équin.
Ces déformations, si elles ajoutent à la gêne motrice et
à l’inconfort, sont rarement douloureuses. Comme les
patients sont actuellement bien pris en charge en réé-
ducation, ces déformations sont moindres.
Les troubles de la parole
Ils représentent une part importante du handicap
global. Il s’agit d’une dysarthrie avec articulation serrée
et hypophonie, majorées par la gêne respiratoire.
L’hypersialorrhée majore la dysarthrie et réduit encore
les possibilités de communication du patient, lui don-
nant un aspect peu engageant. Elle paraît, elle aussi,
constante et peut être majeure. Peu de moyens phar-
macologiques l’atténuent car les anticholinergiques
sont contre-indiqués à ce stade en raison de leur
impact sur les processus cognitifs. Il reste, dans cer-
tains cas, la possibilité d’injection de toxine botulique
dans les glandes salivaires, mais l’efficacité en
demeure controversée.
La dysphagie s’accompagne rapidement de
fausses-routes qui sont à l’origine de syndromes infec-
Maladie de Parkinson évoluée
Psychol NeuroPsychiatr Vieil, vol. 4, n° spécial 1, décembre 2006 S7
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 23/05/2017.

tieux par broncho-pneumonie de déglutition. Les trou-
bles de déglutition sont souvent associés à une grande
lenteur pour s’alimenter et l’ensemble peut être res-
ponsable d’une dénutrition et, dans certains cas, de
déshydratation.
L’anxiété
Elle est souvent présente chez ces patients dont
l’autonomie est réduite et dont la gêne motrice, parfois
considérable, varie d’un instant à l’autre. Cette variabi-
lité empêche le patient et l’entourage de s’adapter au
handicap. Les benzodiazépines sont parfois utiles pour
leur effet anxiolytique et myorelaxant (crampes, dysto-
nies douloureuses), mais renforcent souvent la somno-
lence. Le meilleur traitement semble l’adaptation opti-
male de la L-Dopa car il s’agit souvent de fluctuations
psychiques.
Les fluctuations psychiques
Les fluctuations psychiques (anxiété, parfois
majeure, et sentiments dépressifs en période off) ne
sont jamais présentes au début de la maladie et s’ins-
tallent au fil du temps chez certains patients. Elles font
partie de la longue liste des signes non moteurs, long-
temps méconnus. Elles sont pénibles à supporter, tant
pour le patient que pour l’entourage. Leur traitement
consiste à équilibrer au mieux la L-Dopa et à s’aider
d’un antidépresseur de la famille des inhibiteurs de
recapture de la sérotonine.
La somnolence diurne
Elle est pratiquement constante chez ces patients
avec de longues périodes de sommeil, parfois en rap-
port avec les prises de L-Dopa, parfois sans rapport.
Chez ces patients fatigués, nous avons l’habitude de
respecter cette somnolence d’autant qu’elle semble
peu influer sur le sommeil nocturne (hypersomnie).
Les douleurs
Elles ont généralement plusieurs origines : des dou-
leurs neurologiques liées à la maladie de Parkinson
elle-même, à type de brûlures, d’engourdissement et
de striction. Elles ont la particularité de se promener
sur le côté le plus atteint initialement et d’être exclusi-
vement présentes en période off. Les autres douleurs
peuvent être musculaires du fait de l’hypertonie ou des
dystonies, ou bien articulaires en rapport avec les
déformations dont nous avons parlé. Si la situation
l’autorise (absence de troubles cognitifs, de constipa-
tion) une faible dose de morphiniques est bien tolérée :
ces produits n’accentuent pas les signes parkinsoniens
et parfois diminuent les dyskinésies.
Les troubles neurovégétatifs
Ils sont constants. L’hypersalivation peut être une
gêne majeure, permanente, socialement mal acceptée,
responsable de fausses-routes.
L’hypotension orthostatique, dont le risque d’appa-
rition augmente avec la durée d’évolution, peut être
responsable de chutes, souvent traumatisantes.
Les troubles digestifs gastro-œsophagiens ont sou-
vent une symptomatologie de reflux-gastro-œso-
phagien, source d’inconfort, d’amaigrissement par res-
triction alimentaire, de troubles de la parole et de la
déglutition par irritation des cordes vocales et du
larynx. Ces troubles du péristaltisme modifient la phar-
macocinétique de la L-Dopa, ajoutant un facteur de
variabilité supplémentaire à l’effet des prises. La cons-
tipation, qui peut aboutir à un fécalome, à un syndrome
sub-occlusif ou à des fausses diarrhées, accentue sou-
vent les troubles urinaires.
Les troubles urinaires se limitent au début à des
envies pressantes, puis s’installe une pollakiurie,
d’abord nocturne puis diurne, puis des fuites, puis une
incontinence. La dysurie est rare, plutôt médicamen-
teuse ou due à un obstacle.
Les troubles respiratoires peuvent se manifester par
un simple « manque d’air » en période off, mais peu-
vent évoluer vers des épisodes de dyspnée asthmati-
forme avec hypersécrétion salivaire, laryngée et bron-
chique qui sont d’un traitement difficile (apomorphine).
Les perturbations de la statique rachidienne majorent
la diminution de l’ampliation thoracique due à l’akiésie
et à l’hypertonie.
L’amaigrissement est constant, entraînant une
fonte musculaire. C’est un indice de surveillance qui est
pris en compte pour décider d’une gastrostomie.
Les troubles de la déglutition sont, par définition,
tardifs car sont la cause de décès la plus fréquente dans
cette affection.
Les troubles cognitifs
À suivre les patients atteints de maladie de Parkin-
son, l’impression est qu’il existe une progression dans
l’installation et la gravité des troubles cognitifs : som-
meil agité, hallucinations visuelles de personnes
aimées, hallucinations plus riches, épisodes confusion-
nels et état démentiel.
Certains patients, même après plus de 25 ans de
maladie de Parkinson, peuvent ne présenter aucun
trouble cognitif cliniquement apparent, ce d’autant que
la maladie a débuté tôt.
M. Ziégler
Psychol NeuroPsychiatr Vieil, vol. 4, n° spécial 1, décembre 2006S8
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 23/05/2017.

Pour les autres patients, les premiers troubles
cognitifs sont annoncés par un sommeil agité, des
parasomnies, qui gênent plus le conjoint que le patient.
Ensuite, s’installent des hallucinations visuelles,
bien décrites et bien connues : le patient croit voir un
personnage assis dans un fauteuil dans la même pièce
que lui. Il s’agit souvent de quelqu’un de cher : un frère,
un enfant ou un parent. Tout ceci est silencieux et la
tonalité est parfaitement bienveillante. Parfois il s’agit
d’un animal, le patient revoit son chat ou son chien
disparu depuis longtemps. Ce type d’hallucinations
n’est pas bien gênant et ne signifie pas forcément un
mode d’entrée vers la démence, tout au moins dans
l’immédiat.
Plus préoccupantes sont les hallucinations visuelles
ou auditives, plus riches et moins critiquées. Le patient
voit en surimpression des dessins qu’il plaque sur les
surfaces unies (un mur blanc) ; il s’agit de dessins géo-
métriques, de dentelles, de vieux plans de ville. Parfois
ces dessins entourent les visages des interlocuteurs. Il
peut aussi s’agir d’insectes qui grouillent par terre ou
bien de l’eau qui inonde la pièce. Il peut s’agir égale-
ment de groupes d’individus (inconnus) qui vont et
viennent chez lui, parfois dans des tenues inhabituelles
(militaires, moines avec des capuches, personnages de
théâtre richement habillés). Parfois une foule envahit le
jardin. Ce type d’hallucinations est souvent de moins
bon pronostic cognitif.
Ces hallucinations sont souvent iatrogènes mais, à
ce stade de la maladie, malgré l’élimination de tous les
traitements suspects, les hallucinations persistent et il
faut admettre qu’elles font partie de la maladie.
La confusion mentale survient, soit d’emblée, soit à
l’occasion d’un événement intercurrent (par exemple
une intervention chirurgicale), soit après une période
d’hallucinations visuelles de moins en moins criti-
quées.
Il s’agit d’une confusion fluctuante, avec alternance
dans la journée de moments de confusion mentale
complète, portant surtout sur la chronologie des événe-
ments qui sont mélangés, et de périodes de parfaite
lucidité pendant lesquelles le patient peut avoir une
discussion comme auparavant. Il peut s’introduire
quelques idées délirantes, à thème de jalousie ou de
préjudice. Ces variations de l’état cognitif sont sans
relation ni avec les prises de L-Dopa, ni avec l’état
moteur (périodes on ou off). Les périodes de lucidité
deviennent de moins en moins longues et un état
démentiel s’installe, mais tardivement.
L’état démentiel
Il n’est pas très fréquent et pose le problème d’une
pathologie surajoutée de type maladie d’Alzheimer.
Le diagnostic et la physiopathologie de la survenue
tardive de troubles cognitifs sont en cours de démem-
brement. S’agit-il d’une démence secondaire à la mala-
die de Parkinson, d’une maladie à corps de Lewy déce-
lée tardivement, d’une pathologie surajoutée ? Le plus
simple pour l’instant semble être d’utiliser le terme
général de démence secondaire.
Les idées délirantes
Elles peuvent apparaître, généralement dans le
cadre d’un trouble cognitif plus global, alimentées par
des phénomènes hallucinatoires. Elles sont parfois
tournées vers l’entourage proche (famille ou soignant),
suspecté de vouloir empoisonner, enfermer ou dépos-
séder le patient. Elles compliquent la prise en charge et
peuvent déclencher des phénomènes de rejet. La cloza-
pine est particulièrement efficace sur ce type de trou-
bles, comme sur les hallucinations [12]. En revanche,
elle a peu d’effet sur les épisodes confusionnels. Ses
inconvénients sont : l’un majeur, le risque d’agranulocy-
tose, les autres mineurs, somnolence et hypersalivation.
Conclusion
Au total, chez les patients ayant débuté leur maladie
avant l’âge de 70 ans, les complications vont habituel-
lement survenir après 10 ans d’évolution, en moyenne.
Points clés
•Le stade de maladie de Parkinson évoluée est
atteint en moyenne 10 ans après le début de la mala-
die mais ce délai peut être étendu jusqu’à 30 ans.
•Il est défini par un handicap important dominé par
les troubles de la marche, les chutes, les déforma-
tions articulaires et les troubles cognitifs. Certains
patients gardent des fluctuations d’efficacité et des
dyskinésies difficiles à contrôler.
•Les troubles psychiques (hallucinations, idées
délirantes, troubles cognitifs, démence) sont incons-
tants.
•Le traitement de base est la L-Dopa mais peut faire
appel à une perfusion continue d’apomorphine, un
anticholinestérasique, de la clozapine, une gastro-
stomie.
Maladie de Parkinson évoluée
Psychol NeuroPsychiatr Vieil, vol. 4, n° spécial 1, décembre 2006 S9
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 23/05/2017.
 6
6
1
/
6
100%