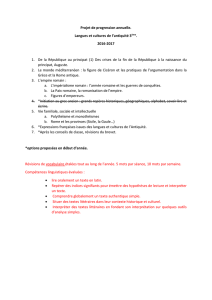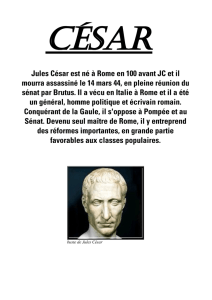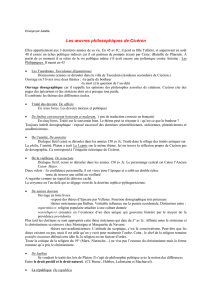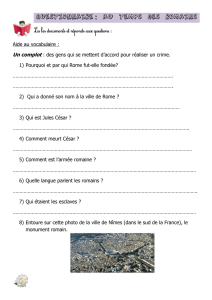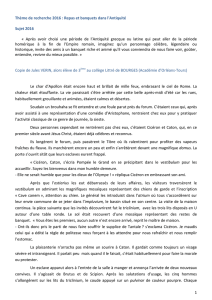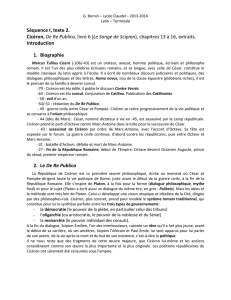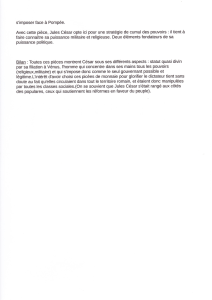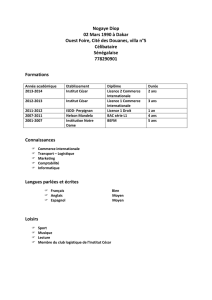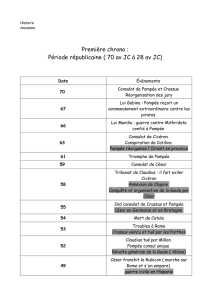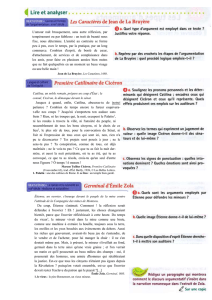cicéron et ses amis - L`Histoire antique des pays et des hommes de

CICÉRON ET SES AMIS
ÉTUDE SUR LA SOCIÉTÉ ROMAINE DU TEMPS DE
CÉSAR
PAR GASTON BOISSIER
DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE - 1905

INTRODUCTION — Les lettres de Cicéron
CICÉRON DANS LA VIE PUBLIQUE ET PRIVÉE
La vie publique de Cicéron
La vie privée de Cicéron
ATTICUS
CÆLIUS - La jeunesse romaine au temps de César
CÉSAR ET CICÉRON
Cicéron et le camp de César dans les Gaules
Le vainqueur et les vaincus après Pharsale
BRUTUS - Ses relations avec Cicéron
OCTAVE - Le testament politique d'Auguste

INTRODUCTION — LES LETTRES DE CICÉRON
Il n’y a pas d’histoire qu’on étudie plus volontier, aujourd’hui que celle des
dernières années de la république romaine. De savants ouvrages ont été publiés
récemment sur ce sujet en France, en Angleterre, en Allemagne1, et le public les
a lus avec avidité. L’importance des questions qui se débattaient alors, la vivacité
dramatique des événements, la grandeur des personnages justifient cet intérêt ;
mais ce qui explique encore mieux l’attrait que nous éprouvons pour cette
curieuse époque, c’est qu’elle nous a été racontée par les lettres de Cicéron. Un
contemporain disait de ces lettres que celui qui les lirait ne serait pas tenté de
chercher ailleurs l’histoire de ce temps2, et en effet, nous la retrouvons là bien
plus vivante et,bien plus vraie que dans des ouvrages suivis et composés tout
exprès pour nous l’enseigner. Que nous apprendraient de plus Asinius Pollion,
Tite-Live ou Cremutius Cordus, si nous les avions conservés ? Ils nous
donneraient leur opinion personnelle ; mais cette opinion est, la plupart du
temps, suspecte : elle vient de gens qui n’ont pas pu dire toute la vérité, qui
écrivaient à la cour des empereurs, comme Tite-Live, ou qui, comme Pollion,
espéraient se faire pardonner leur trahison en disant le plus de mal qu’ils
pouvaient de ceux qu’ils avaient trahis. Il vaut donc mieux, au lieu de recevoir
une opinion toute .faite, se la faire soi-même, et c’est ce que nous rend possible
la lecture des lettres de Cicéron. Elle nous jette au milieu des événements et
nous les fait suivre jour par jour. Malgré les dix-huit siècles qui nous en
séparent, il nous semble que nous les voyons se passer sous nos yeux, et nous
nous trouvons placés dans cette position unique d’être assez près des faits pour
en voir la couleur véritable, et assez éloignés d’eux pour les juger sans passion.
L’importance de ces lettres s’explique facilement. Les hommes politiques de ce
temps avaient bien plus besoin de s’écrire que ceux d’aujourd’hui. Le proconsul
qui partait de Rome pour aller gouverner quelque province lointaine sentait bien
qu’il s’éloignait tout à fait de la vie politique. Pour des gens accoutumés aux
mouvements des affaires, aux agitations des partis, ou, comme ils disaient, au
grand jour du forum, c’était un grand ennui d’aller passer plusieurs années dans
ces contrées perdues, où les bruits de la place publique de Rome ne parvenaient
pas. A la vérité ils recevaient une sorte de gazette officielle, acta diurna,
vénérable ancêtre de notre Moniteur. Mais il semble que tout journal officiel soit
condamné par sa nature à être quelque peu insignifiant. Celui de Rome contenait
un procès-verbal assez terne des assemblées du peuple, le résumé succinct des
causes célèbres plaidées au forum, et aussi le récit des cérémonies publiques
avec la mention exacte des phénomènes atmosphériques ou des prodiges
survenus dans la ville et ses environs. Ce n’étaient pas tout à fait des nouvelles
de ce genre qu’un préteur ou un proconsul désirait savoir. Aussi, pour combler
les lacunes du journal officiel, avait-il recours à des correspondants payés qui
faisaient des gazettes à la main à l’usage des curieux de la province, comme
c’était la mode chez nous au siècle dernier ; mais tandis qu’au dix-huitième
siècle on chargeait de ce soin des hommes de lettres en renom, familiers des
grands seigneurs et bien reçus des ministres, les correspondants romains
n’étaient que des compilateurs obscurs, des manœuvres, comme les appelle
1 La suite de ce travail montrera que je me suis beaucoup servi des ouvrages publiés en Allemagne, et surtout
de la belle Histoire romaine de M. Mommsen, si savante et si vivante à la fois. Je ne partage pas toujours les
opinions de M. Mommsen, mais on reconnaîtra, même dans les endroits où je me sépare de lui, l’influence de
ses idées. C’est le maître aujourd’hui de tous ceux qui étudient Rome et son Histoire.
2 Corn. Nepos, Att., 16.

quelque part Cælius, choisis d’ordinaire parmi ces Grecs affamés que la misère
rendait bons à tous les métiers. Ils n’avaient pas accès dans les grandes maisons
; ils n’approchaient pas des politiques. Leur rôle consistait uniquement à courir la
ville et à recueillir par lés rues ce qu’ils entendaient dire ou ce qu’ils voyaient. Ils
enregistraient soigneusement les histoires de théâtres, s’informaient des acteurs
sifflés, des gladiateurs vaincus, décrivaient le détail des beaux enterrements,
notaient les bruits et les malins propos, et surtout les récits scandaleux qu’ils
pouvaient attraper1. Tout ce babil amusait un moment, mais ne satisfaisait pas
ces personnages politiques, qui voulaient, avant tout, être tenus au courant des
affaires. Pour les bien connaître, ils s’adressaient naturellement à quelqu’un qui
pût les savoir. Ils faisaient choix de quelques amis sûrs, importants, bien
informés ; par eux, ils connaissaient la raison et le caractère véritable des faits
que les journaux rapportaient sèchement et sans commentaire ; et, tandis que
leurs correspondants payés les laissaient d’ordinaire dans la rue, les autres les
introduisaient dans les cabinets des grands politiques, et leur faisaient écouter
leurs entretiens les plus secrets.
Ce besoin d’être régulièrement informé de tout, et, pour ainsi dire, de vivre
encore au milieu de Rome après qu’on l’avait quittée, personne -ne l’éprouva
plus que Cicéron ; personne n’aima davantage ces agitations de la vie publique,
dont les hommes d’État se plaignent quand ils en jouissent, et qu’ils ne cessent
de regretter lorsqu’ils les ont perdues. Il ne faut pas trop le croire quand il vient
nous dire qu’il est fatigué des discussions orageuses du sénat ; qu’il cherche un
pays où l’on n’ait pas entendu parler de Vatinius ni de César, et où l’on ne
s’occupe pas des lois agraires ; qu’il meurt d’envie d’aller oublier Rome sous les
beaux ombrages d’Arpinum, ou au milieu du site enchanté de Formies. Aussitôt
qu’il est installé à Formies, à Arpinum, ou dans quelque autre de ces belles villas
qu’il appelait avec fierté les ornements de l’Italie, ocellos Italiœ, sa pensée
retourne naturellement à Rome, et des courriers parient à chaque moment, pour
aller savoir ce qu’on y pense et ce qu’on y fait. Jamais, quoi qu’il dise, il ne put
détacher les yeux du forum. De près ou de loin, il lui fallait ce que Saint-Simon
appelle ce petit fumet d’affaires dont les politiques ne se peuvent passer. A toute
force, il voulait connaître la situation des partis, leurs accords secrets, leurs
discordes intimes, enfin tous ces manèges cachés qui préparent les événements
et les expliquent. C’est là ce qu’il réclamait sans relâche d’Atticus, de Curion, de
Cœlius et de tant d’autres grands esprits, mêlés à toutes ces intrigues comme
acteurs ou comme curieux ; c’est ce qu’il racontait lui-même de la façon la plus
piquante à ses amis absents ; et voilà comment les lettres qu’il a reçues ou
envoyées contiennent, sans qu’il l’ait voulu faire, toute l’histoire de son temps2.
Les correspondances des hommes politiques de nos jours, quand on les publie,
sont loin d’avoir la même importance. C’est que l’échange des sentiments et des
pensées ne se fait plus autant qu’alors au moyen des lettres. Nous avons inventé
des procédés nouveaux. L’immense publicité de la presse a remplacé avec
avantage ces communications discrètes qui ne pouvaient pas s’étendre au delà
de quelques personnes. Aujourd’hui, en quelque lieu désert qu’un homme soit
retiré, les journaux viennent le tenir au courant de tout ce qui se fait dans le
monde. Comme il apprend les événements presque en même temps qu’ils se
1 Voir Cicéron, Epist. ad fam., II, 8, et VIII, 1. Je citerai, dans le cours de cet ouvrage, les œuvres de Cicéron
d’après l’édition d’Orelli.
2 J’ai essayé d’éclaircir quelques-unes des questions auxquelles donne lieu la publication des lettres de Cicéron
dans un mémoire intitulé : Recherches sur la manière dont furent recueillies et publiées les lettres de Cicéron,
Paris, Durand, 1863.

pansent, il en reçoit non seulement la nouvelle, mais aussi l’émotion. Il croit les
voir et y assister, et il n’a aucun besoin qu’un ami bien informé se donne la peine
de l’instruire. Ce serait une étude curieuse que de chercher tout ce que les
journaux ont détruit et remplacé chez nous. Du temps de Cicéron, les lettres en
tenaient souvent lieu et rendaient les mêmes services. On se les passait de main
en main quand elles contenaient quelque nouvelle qu’on avait intérêt à savoir.
On lisait, on commentait, on copiait celles des grands personnages qui faisaient
connaître leurs sentiments. C’est par elles qu’un homme politique qu’on attaquait
se défendait auprès des gens dont il tenait à conserver l’estime ; c’est par elles,
quand le forum était muet, comme au temps de César, qu’on essayait de former
une sorte d’opinion commune dans un publie restreint. Aujourd’hui les journaux
se sont emparés de ce rôle, la vie politique leur appartient ; et, comme ils sont
incomparablement plus commodes, plus rapides, plus répandus, ils ont fait
perdre aux correspondances un de leurs principaux aliments.
Il est vrai qu’il leur reste les affaires privées ; et l’on est tenté de croire d’abord
que cette matière est inépuisable et qu’avec les sentiments et les affections de
mille natures qui remplissent notre vie intérieure, elles seront toujours assez
riches. Je crois cependant que même ces correspondances intimes, où il n’est
question que de nos affections et de nos sentiments, deviennent tous les jours
plus courtes et moins intéressantes. Ces commerces agréables et assidus, qui
tenaient tant de place dans la vie d’autrefois, tendent presque à disparaître de la
nôtre On dirait que, par un hasard étrange, la facilité même et la rapidité des
relations, qui auraient dû leur donner plus d’animation, leur aient nui. Autrefois,
quand la poste n’existait pas, ou qu’elle était réservée, comme chez les
Romains,.à porter, les ordres de l’empereur, or, était forcé de profiter des
occasions ou d’envoyer les lettres par un esclave. C’était alors une affaire
d’écrire. On ne voulait pas que le messager fit un voyage inutile ; on faisait les
lettres plus longues, plus complètes, pour n’être pas forcé de les recommencer
trop souvent ; sans y songer, on les soignait davantage, par cette importance
naturelle qu’on met aux choses qui coûtent plus et qui sont moins faciles. Même
au temps de Mme de Sévigné, quand les ordinaires ne partaient qu’une ou deux
fois par semaine, écrire était encore une chose grave, à laquelle on donnait tous
ses soins. La mère, éloignée de sa fille, n’avait pas plus tôt fait partir sa lettre
qu’elle songeait à celle qu elle enverrait quelques jours plus tard. Les pensées,
les souvenirs, les regrets s’amassaient dans son esprit pendant cet intervalle, et
quand elle prenait la plume, elle ne pouvait plus gouverner ce torrent.
Aujourd’hui qu’on sait qu’on peut écrire quand on veut, on n’assemble plus des
matériaux, comme faisait Mme de Sévigné, on n’écrit plus par provisions, « on
ne cherche plus à vider son sac, n. on ne se travaille plus à ne rien oublier, de
peur qu’un oubli ne rejette trop loin le récit d’une nouvelle qui perdra sa
fraîcheur pour venir trop tard. Tandis que le retour périodique de l’ordinaire
amenait autrefois plus de suite et de régularité dans les relations, la facilité qu’on
a maintenant de s’écrire quand on veut fait qu’on s’écrit moins souvent. On
attend d’avoir quelque chose à se dire, ce qui est moins fréquent qu’on ne le
pense. On ne s’écrit plus que le nécessaire ; c’est peu de chose pour un
commerce dont le principal agrément consiste dans le superflu ; et ce peu de
chose, on nous menace encore de le réduire. Bientôt sans doute le télégraphe
aura remplacé la poste, nous ne communiquerons plus que par cet instrument
haletant, image d’une société positive et pressée, et qui, dans le style qu’il
emploie, cherche à mettre un peu moins que le nécessaire. Avec ce nouveau
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
 174
174
 175
175
 176
176
 177
177
 178
178
 179
179
 180
180
 181
181
 182
182
 183
183
 184
184
 185
185
 186
186
 187
187
 188
188
 189
189
 190
190
 191
191
 192
192
 193
193
 194
194
 195
195
 196
196
 197
197
 198
198
 199
199
1
/
199
100%