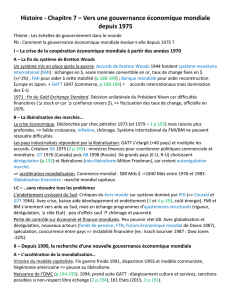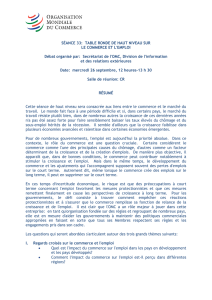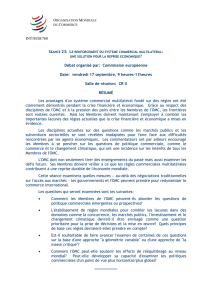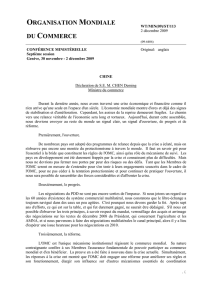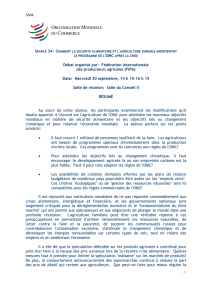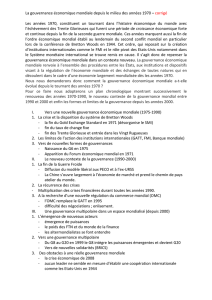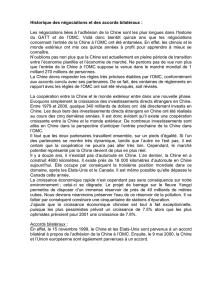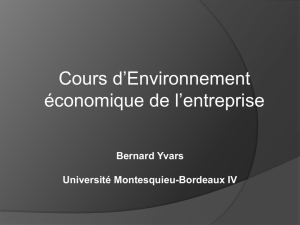Section 1 - Website of Bernard Yvars, Jean Monnet Chair in

Cours d’Environnement
économique international
Bernard Yvars
Université Montesquieu-Bordeaux IV

Introduction
Section 1 - L’ouverture contemporaine à l’échange international par les négociations commerciales
multilatérales et les zones d’intégration régionale
Section 2 - Mondialisation et OMC : une nouvelle hiérarchie des Etats dans le commerce international
Chapitre 1 - Les relations commerciales internationales
Section 1 - Les déterminants des échanges internationaux : un faisceau explicatif complexe
Section 2 - Les politiques commerciales : l’affirmation d’une aversion pour le protectionnisme
visible
Chapitre 2 - L’évolution du système monétaire international (SMI)
Section 1 - L'instabilité du SMI contemporain : l’émergence de pays à déficits jumeaux
Section 2 - Les difficultés de la coopération monétaire internationale : une guerre incessante
des monnaies
Chapitre 3- Les expériences d’intégration économique et monétaire : le cas de l’Union
européenne
Section 1 - Les effets de l’intégration commerciale: gains actuels et potentiels
Section 2 - Une logique cumulative de l’intégration :l’unification monétaire européenne imparfaite
Conclusion
Les perspectives de la coopération internationale : l’aggravation des inégalités dans le partage
des activités et des revenus ?

BIBLIOGRAPHIE :
.L. Abdelmalki et R. Sandretto, Politiques commerciales des grandes
puissances, De Boeck, 2011.
•J.-L. Amelon et J.- M. Cardebat, Les nouveaux défis de l'internationalisation
- Quel développement international pour les entreprises après la crise ?, De
Boeck, 2010.
•M. Chossudovsky, Mondialisation de la pauvreté et nouvel ordre mondial,
Éditions Écosociété, Montréal, 2010
•M. Lemoine et alii, Les grandes questions d’économie et finances
internationales, De Boeck, 2007.
•M. Massabie-François, Commerce international - Marketing, Etudes et veille
commerciales, Vendre et négocier à l’export, Ed. Bréal, 2009.
•T. Mayer et J.-L. Mucchielli, Economie internationale Dalloz, 2010.
•J.-L. Mucchielli, La mondialisation - Chocs et mesure, Hachette Sup, Les
Fondamentaux, 2008.
•M. Rainelli, Le commerce international, Coll. Repères, Ed.La découverte,
2010.
SITES INTERNET :
Le site de la Chaire Jean Monnet en Intégration régionale comparée
héberge toutes les ressources à utiliser et à maîtriser par les étudiants :
http://Integeco.u-bordeaux4.fr/ .Il comporte un certain nombre de liens vers
des sites extérieurs utiles : OMC, FMI, OCDE, Commission européenne,
DREE, etc.

INTRODUCTION
La crise économique et financière dans les derniers mois de 2008 a
provoqué en 2009 une récession mondiale contraction du commerce sans
précédent en plus de 70 ans.La croissance du commerce avait déjà marqué
le pas entre 2007 et 2008, passant de 6,4% à 2,1 %, mais, en 2009, le volume
des échanges a chuté de 12,2% (plus forte baisse de l’histoire récente).
L’OMC a prévu une modeste reprise en 2010 devant inverser l’effet de
la contraction du commerce. Un fait positif en 2009 :absence de renforcement
des obstacles au commerce imposés par les membres de l’OMC en réponse a
la crise, malgré un fort taux de chômage dans de nombreux pays.
La contraction des échanges mondiaux en 2009 (figure ci-après) a été
encore plus prononcée en valeur en dollars EU (-22,6 %), qu’en volume (-
12,2%), du fait notamment de la chute des prix du pétrole et d’autres produits
primaires. La production mondiale mesurée par le PIB a également diminué en
2009 (-2,3 %), ce qui représente la plus forte baisse depuis la fin de la
Deuxième Guerre mondiale. Tous ces éléments récession économique
mondiale la plus grave depuis la Grande Dépression.

 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
1
/
52
100%