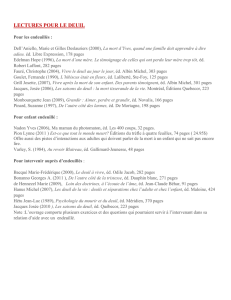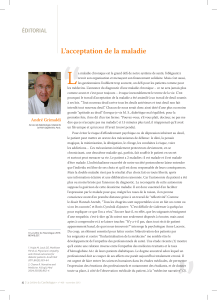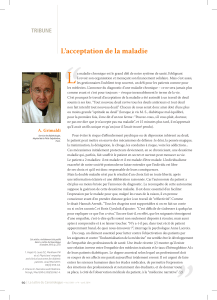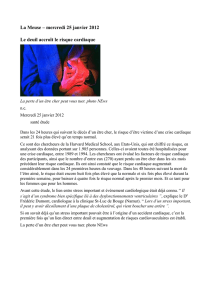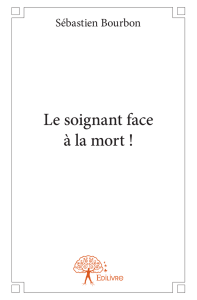Les conséquences sanitaires et socio-économiques du

Synthèse documentaire «Les conséquences sanitaires et socio-économiques du deuil, dans la littérature
internationale : constats pour la recherche»
Page 1 sur 18
Pour citer ce document :
Tête, C.
Les conséquences sanitaires et socio-économiques du deuil, dans la littérature internationale : constats
pour la recherche
CNSP FV, Paris : 2016, 18 p.
Les conséquences sanitaires et socio-économiques du deuil, dans
la littérature internationale :
constats pour la recherche
-----------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © Centre National des Soins Palliatifs et de la Fin de Vie
Tous droits réservés
------------------------------------------------------------------------------------------

Synthèse documentaire «Les conséquences sanitaires et socio-économiques du deuil, dans la littérature
internationale : constats pour la recherche»
Page 2 sur 18
En 2013, il s’est produit, en France, 556 218 décès (CépiDC, centre d’épidémiologie sur
les causes médicales de décès, 2016 – données en ligne). Des chercheurs américains
(Prigerson et al., 2008) ont déterminé qu’il y avait en moyenne, dans la population,
quatre personnes touchées par décès soit, par extrapolation pour la France,
2 224 872 individus qui, potentiellement, étaient susceptibles d’éprouver un deuil... et
ce, pour une année ! Pour Bowlby (1978a, 1978b et 1984), la période de deuil la plus
sensible varie entre 6 mois et 5 ans après un décès, ce qui laisse à penser que le nombre
de personnes en deuil en France chaque année est bien supérieur.
Le deuil, sous toutes ses formes, a de multiples conséquences sanitaires, sociales et
économiques. Les publications scientifiques sont presque toutes d’origine anglo-saxonne
et évoquent les coûts qu’il est supposé générer, rassemblés dans la littérature sous
différents termes comme « social cost » ou « social economic impact ». Les études sur
les conséquences du deuil peuvent alors donner une indication du poids que représente
un tel phénomène pour la collectivité.
De manière générale, les références identifiées portent sur les effets sanitaires, sociaux
et économiques du deuil. Par exemple, dans les conséquences immédiates d’un décès,
les individus prennent des congés suite au décès d’un enfant (Corden et al., 2001 ; van
den Berg et al., 2012) ou de leur conjoint(e) (Corden et al., 2008 ; Corden et Hirst,
2013 ; Fox et al., 2014). Même après leur retour au travail, ils peuvent rencontrer des
difficultés dans leur capacité à effectuer leurs tâches quotidiennes (Cacciatore et al.,
2014 ; Shalev, 2000). L’absentéisme et le présentéisme ont des implications pour les
familles des endeuillés, les employeurs, ainsi que pour les organisations qui soutiennent
les endeuillés : les associations de soutien, les services de santé et la sécurité sociale,
etc. Tous ces secteurs, ces facteurs socio-économiques sont à prendre en compte si l’on
veut évaluer, de manière large, les conséquences du deuil pour une société. Ces résultats
peuvent être utiles afin de hiérarchiser entre eux les problèmes et contribuent à éclairer
d’éventuels choix publics.
Aucune étude
1
, depuis le passage à l’euro en 1999, n’a été effectuée sur le territoire
français. Le présent travail de synthèse documentaire examine certaines conséquences
sanitaires et socio-économiques du deuil au travers de la littérature internationale, c'est-
à-dire étrangère et essentiellement anglo-saxonne. La première partie de ce document
s’attache aux éléments de définition de la notion de deuil. La seconde partie consiste en
une revue de la littérature par tranche d’âge (à chaque groupe ses enjeux sanitaires et
socio-économiques), ce qui permettra de conclure autour de différents aspects des
conséquences du deuil qui peuvent être explorées par la recherche.
Le deuil, quelques éléments de définition
Définition française
Le mot « deuil » vient du mot latin « dol » qui tire son origine du mot « dolere », c’est-à-
dire « souffrir ». Le deuil est donc une douleur (avec laquelle il partage sa racine), une
affliction que l’on éprouve à la mort de quelqu’un. C’est aussi un processus psychologique
par lequel une personne parvient à se détacher de la personne disparue, à donner un
sens à cette perte (Le Petit Robert, 2008).
En français, un seul mot, plusieurs sens
La polysémie de « deuil » est progressivement entrée dans le langage courant. La notion
originelle de douleur regroupe différentes dimensions (Romano, 2015). La dimension
psycho-affective correspond à l’expression et aux réactions physiologiques suite au
décès d’un proche (les troubles du sommeil, la fatigue, les larmes, etc.). Elle s’associe à
1
Une étude de la Chambre syndicale nationale de l’art funéraire (CSNAF), en partenariat avec le CREDOC, est
en cours dont les résultats devraient être communiqués en octobre 2016 lors des Assises du funéraire.

Synthèse documentaire «Les conséquences sanitaires et socio-économiques du deuil, dans la littérature
internationale : constats pour la recherche»
Page 3 sur 18
la notion de « travail du deuil » proposée par Freud en 1915 correspondant à « la
réaction à la perte d’une personne aimée ou d’une abstraction mise à sa place » (Freud,
2011). Cette notion traduit le processus psychique aboutissant à surmonter la perte –pas
seulement dans le sens physique– et à parvenir à supporter cette disparition.
Les dimensions culturelle, religieuse, sociale et familiale du deuil se distinguent de la
dimension psycho-affective de par leur caractère interrelationnel et collectif. La
dimension culturelle est liée non seulement aux référentiels culturels des endeuillés mais
aussi à celui de la personne décédée. Dans la société contemporaine, la diversité
culturelle est multiple et spécifique à chaque culture (les représentations de la mort, les
rites funéraires, par exemple). De même, la dimension religieuse renvoie aux croyances,
en particulier au sens donné à la mort et au devenir de « l’âme » à travers des
références religieuses.
La dimension sociale traduit les conséquences sociales suite à la perte d’un être cher et
les représentations sociales du deuil. Ce qui est communément appelé « porter le deuil »
évolue à travers les époques (mode vestimentaire, par exemple). Enfin, la dimension
familiale est liée au rapport que chaque famille entretient avec la mort du fait de ses
références culturelles, éducatives et religieuses.
Une dernière dimension, la dimension psychiatrique du deuil concerne des réactions
pouvant conduire à des troubles psychopathologiques et à des symptômes spécifiques
décrits dans différentes classifications au niveau de la communauté scientifique comme
celle du DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) publié par
l’Association américaine de psychiatrie (American Psychiatric Association) et celle de la
CIM (Classification Internationale des Troubles Mentaux) publiée par l’Organisation
mondiale de la santé (OMS). Ces perspectives descriptives classent les manifestations
pathologiques en fonction de critères précis et évaluent les troubles éventuels à partir
d’échelles quantitatives et de critères opérationnalisés. Le deuil, dans ces classifications,
n’est pas défini de manière exhaustive mais il y est plutôt abordé en comparaison avec
d’autres troubles mentaux. La psychopathologie s’y trouve réduite à une énumération de
symptômes.
Les nuances de la langue anglaise
La langue anglaise désigne la notion de deuil par trois mots différents, donnant à ce
terme un sens plus complet (Bacqué et Hanus, 2014).
Le substantif « bereavement » désigne une situation objective de deuil. Elle fait
référence au décès en tant que tel sans faire part pour autant de la douleur affective. Le
terme « grief » est beaucoup plus fort en anglais que la traduction que la langue
française lui attribue, à savoir le chagrin. « Grief » s’emploie dans le cas d’une tristesse
éprouvante et douloureuse que rien ne peut consoler. Enfin, le nom commun
« mourning » décrit une notion plus sociale qui se rapporte au fait de « porter le deuil »
ou de participer aux funérailles. Cette notion permet de distinguer la part sociale de la
part affective du deuil.
Le DSM-V décrit le deuil par le substantif « bereavement » tout en prenant soin d’inclure
les termes « grief » et « mourning » dans sa définition : « The state of having lost
through death someone with whom one has had a close relationship. This state includes
a range of grief and mourning responses ». C’est donc l’état de perte suite au décès d’un
proche, état incluant une gamme de réponses affectives et sociales (DSM-5, 2013, p.
818). Le deuil n’est pas pathologique en tant que tel. Le DSM-5 introduit la notion de
« deuil non compliqué » (uncomplicated bereavement – DSM-5, 2013, p. 716-717) et la
notion de « trouble du deuil complexe persistant » (persistent complex bereavement
disorder – DSM-5, 2013, p. 789-792). Par ailleurs, le deuil est associé à la définition du
trouble dépressif majeur, aux critères diagnostiques du trouble de l’adaptation, au
diagnostic différentiel des troubles de l’anxiété et du sommeil, et aux conditions
associées au diagnostic de l’état de stress post-traumatique et des dysfonctionnements
sexuels (masculins et féminins).

Synthèse documentaire «Les conséquences sanitaires et socio-économiques du deuil, dans la littérature
internationale : constats pour la recherche»
Page 4 sur 18
Deuils conduisant à des complications
Si le deuil n’est pas en tant que telle une maladie, il peut, dans certaines circonstances,
conduire à des complications. Plusieurs auteurs ont différencié les différents deuils « mal
adaptés » à partir du DSM-5 et de la CIM-10, bien qu’aucune de ces classifications ne
propose de définition précise du deuil (voir ci-dessus).
Le deuil difficile désigne des deuils où s’expriment de grandes difficultés à surmonter la
perte, sans être pour autant pathologiques. Ce type de deuil est plus long et se traduit
par une plus grande manifestation de souffrance et de dépression ; ce qui peut
occasionnellement engendrer des conséquences sanitaires et socio-économiques.
Le deuil compliqué se traduit par un développement chronologique inhabituel. Selon les
auteurs, il résulte de « distorsion de la réalité » (Bonanno, 2001) ; il peut associer une
détresse de séparation spécifique accompagnée d’une profonde nostalgie, une perte
d’intérêt, une langueur pour le défunt, la sensation d’une perte de soi et des
questionnements pessimistes sur le sens de sa propre vie (Prigerson et al., 1995).
Prigerson et ses collègues (2008) ont proposé les critères d’un deuil compliqué dans le
but d’introduire cette notion dans le DSM-5 :
A. Des signes se rapportant au désarroi provoqué par l’absence du défunt, ressentis
de manière intense, quotidiennement.
B. Des symptômes de détresse traumatique avec la présence d’au moins quatre de
ces critères qui invalident le quotidien : difficulté à accepter le décès ; difficulté à
faire confiance ; colère et amertume contre le décédé ; difficulté à s’investir dans
de nouvelles relations, désadaptation et évitement ; indifférence affective par
rapport aux autres ; sentiment de vide ; incapacité d’envisager de nouveaux
projets sans le disparu ; se sentir agité, déstabilisé depuis le décès.
C. Les symptômes ci-dessus créent une perturbation du fonctionnement
socioprofessionnel ou d’autres domaines importants de la vie.
D. Les symptômes ci-dessus doivent persister depuis au moins six mois.
Le deuil traumatique (Prigerson, 1999), ou deuil traumatogène comme l’a traduit Marie-
Frédérique Bacqué, est souvent décrit par un attachement particulièrement fort au défunt
et des sentiments d’extrême souffrance suite à la perte. Ce deuil ne doit pas être
confondu avec le deuil post-traumatique qui survient suite à un événement
traumatique : il s’agit de l’état psychologique dans lequel se trouve une personne qui a
échappé à une situation dramatique, brutale, imprévue de mort collective ou de menace
de mort à plusieurs (Bacqué, 2003). Ainsi, à la perte d’un proche s’ajoutent une
exposition à la mort et l’effroi face à cette situation d’horreur, vécue avec un sentiment
d’impuissance. Le deuil post-traumatique comme le deuil traumatique peuvent conduire à
la manifestation de pathologies psychiques ou somatiques latentes comme celles
trouvées dans les deuils psychiatriques.
Pour la majorité des auteurs, le deuil psychiatrique, ou deuil pathologique, est lié à la
personnalité préalable de l’endeuillé. La perte de l’être cher ne provoque pas les troubles
psychiques mais les révèlent ou les soulignent. Il peut s’agir d’endeuillés qui présentaient
des antécédents psychiatriques ou d’endeuillés qui n’avaient aucun antécédent connu. La
pathologie est alors réactionnelle à la perte. Dans le domaine des deuils pathologiques, la
littérature est assez riche. Sont ainsi décrits le deuil avec troubles de l’humeur et de la
dépression (Zisook et al., 1987 ; Hensley, 2006), le deuil avec troubles anxieux (Kaltman
et Bonanno, 2003), le deuil hystérique, le deuil maniaque, le deuil obsessionnel, le deuil
mélancolique, le deuil avec complications somatiques majeures (Romano, 2015) et le
deuil psychotique délirant (Girault et Fossati, 2008).
Certains auteurs ont tenté de déterminer les conséquences du deuil en se concentrant
sur un type de population que nous regrouperons par classes d’âge. Revues ensemble,
ces données mobilisent des indicateurs qu’il serait possible d’étudier en France.

Synthèse documentaire «Les conséquences sanitaires et socio-économiques du deuil, dans la littérature
internationale : constats pour la recherche»
Page 5 sur 18
Les multiples conséquences sanitaires, sociales et économiques du deuil selon
les âges
Enfants et adolescents
La revue de la littérature de Ribbens McCarthy et Jessop (2005) souligne comment le
deuil peut affecter la qualité de vie des jeunes. Les relations sociales, l’isolement
social, couplés à un manque de parole sont les thèmes majeurs que les jeunes ont
exprimés. Environ 17 % des jeunes endeuillés montreront des problèmes significatifs de
comportement au-delà de quatre mois après le décès (Silverman et Worden, 1992).
Les garçons semblent plus affectés à court et long termes que les filles (Kalter et al.,
2003) bien que leurs réactions puissent être influencées par la réaction du parent restant
ou des parents dans le cas d’une perte dans la fratrie. Ce résultat est également rapporté
par Sandler et ses collègues (2003) soulignant que les garçons diffèrent des filles selon
les types et les durées de soutien de deuil. Le type de décès ne semble pas significatif,
bien que ceux qui aient perdu leur père semblent aller mieux (Black, 1998). Ceci pourrait
s’expliquer par le fait que les mères sont plus à l’aise dans l’expression émotionnelle du
deuil. De plus, les circonstances et le contexte social peuvent accroître les difficultés, en
particulier lorsqu’elles sont liées aux ressources personnelles, sociales et matérielles et
au manque de soutien familial.
Les questions de deuil non résolues dans l’enfance peuvent avoir un impact sur la
vie adulte (Charles-Edwards, 2005). Le travail de Ribbens McCarthy et Jessop (2005)
indique aussi qu’un deuil dans l’enfance, en particulier lors de la perte d’un parent, peut
affecter les réussites scolaires et l’emploi : cela pourrait être lié au fait d’avoir quitté le
domicile familial plus tôt, d’avoir vécu des expériences sexuelles et conjugales plus tôt,
de présenter des comportements criminels, de souffrir d’une dépression à court et long
termes et d’avoir une estime de soi diminuée. De même, Balk (2001) note que les
étudiants endeuillés sont à risque accru de ne pas finir leur cursus universitaire.
Deux études françaises ont également montré l’impact d’un deuil dans l’enfance à l’âge
adulte. Le travail de Blanpain (2008) s’est attaché à montrer les effets d’un deuil dans
l’enfance sur le parcours scolaire, professionnel, familial et sur la santé à l’âge adulte.
L’étude établit qu’être orphelin de père ou de mère avant l’âge de 20 ans concerne, en
2006, 11 % des adultes de 20 à 75 ans, la plupart d’entre eux étant devenus orphelins
de père. Perdre un parent pendant l’enfance concerne davantage les enfants d’origine
sociale modeste (7 % d’orphelins de père parmi les enfants d’ouvriers contre 3 % parmi
les enfants de cadres) et issus d’une fratrie nombreuse. Ces données viennent corroborer
les résultats de l’étude de Monnier et Pennec (2003). Ils fixaient à 3,1 % le pourcentage
d’orphelins de père (0,8 % chez les enfants de « cadres et professions intellectuelles
supérieures », contre 7,4 % chez les enfants d’ouvriers).
Des données plus récentes de Fauth et ses collègues (2009) examinent les
caractéristiques d’un échantillon représentatif de 7 997 enfants endeuillés anglais, âgés
de 5 à 16 ans. Les données sont extraites de l’étude Mental Health of Children and Young
People in Great Britain de 2004. Les enfants proviennent de 3 groupes : ayant perdu un
parent ou un membre de la fratrie ; ayant perdu un ami ; n’ayant pas vécu de perte pour
groupe témoin.
Ainsi les enfants ayant perdu un parent ou un membre de la fratrie sont plus susceptibles
d’appartenir à un foyer économiquement désavantagé, ou économiquement inactif ou à
revenus bas, où le niveau d’éducation est faible. Ils ont plus de contact avec les services
de santé mentale et sont plus susceptibles de présenter des problèmes d’anxiété et une
consommation excessive d’alcool.
Les enfants ayant perdu un ami sont plus souvent des filles, sont plus susceptibles
d’avoir des parents divorcés ou séparés et d’avoir des parents avec des problèmes de
santé mentale. Ils sont plus susceptibles d’être en désaccord avec leurs parents quant au
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
1
/
18
100%