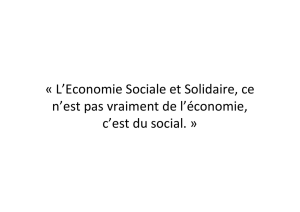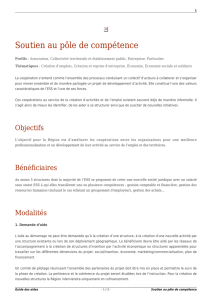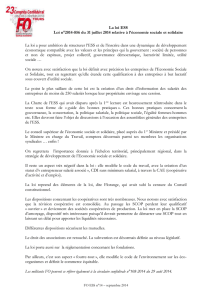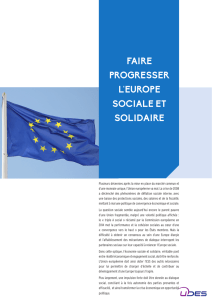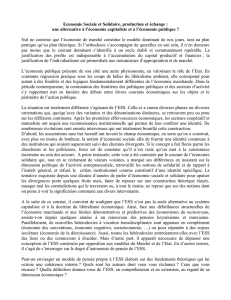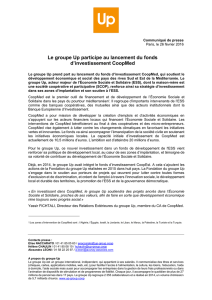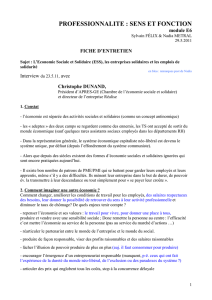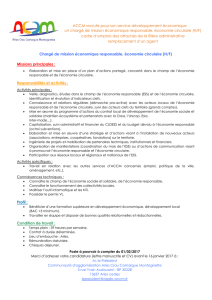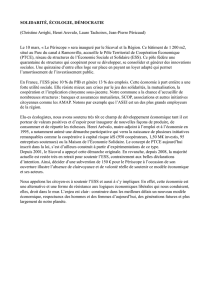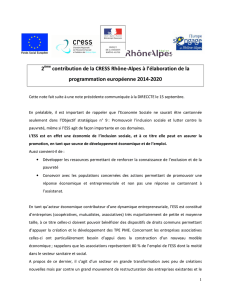Le développement durable et l`économie sociale et

C
OLLOQUE INTERNATIONAL FRANCOPHONE
,
« L
E DEVELOPPEMENT DURABLE
:
DEBATS ET CONTROVERSES
»,
15
ET
16
DECEMBRE
2011,
U
NIVERSITE
B
LAISE
P
ASCAL
,
C
LERMONT
-F
ERRAND
.
1
L’Economie du Développement Durable et l’Economie
Sociale et Solidaire
Amanar AKHABBAR
1
, Sophie SWATON
Centre Walras – Pareto, Université de Lausanne
(Version provisoire)
Résumé : L’économie du développement durable (EDD) et l’économie sociale et solidaire (ESS) sont
deux domaines qui se réfèrent parfois l’un à l’autre sans pour autant s’appuyer sur une analyse
systématique des liens entre leurs objectifs, outils, approches et concepts. Il n’est pas rare que les
objectifs ou moyens d’y parvenir de l’un contredisent ceux de l’autre ou, inversement, qu’ils se
renforcent mutuellement. En particulier, les deux approches appellent à une réorganisation de
l’économie de marché et du capitalisme qui passe à la fois par une modification profonde de la
structure des incitations qui guide les agents ainsi que des valeurs mêmes qui guident ces individus.
De plus, les deux approches créent et expérimentent de nouveaux modes de comptabilité et de
nouveaux indicateurs. Par ailleurs, d’un point de vue méthodologique, le cadre macroéconomique de
l’EDD pourrait être particulièrement utile pour l’ESS, et les approches de cette dernière, comme celle
d’innovation sociale, permettraient de donner corps à certaines propositions de l’EDD. Une réflexion
systématique est nécessaire. De nature théorique, notre communication participe à l’établissement
d’un chaînon manquant entre deux domaines : l’économie du développement durable et l’économie
sociale et solidaire.
Mots clés : Développement durable, soutenabilité forte, soutenabilité faible, économie sociale et
solidaire, utilité sociale, entreprises sociales, croissance durable, indicateurs
Key words: Sustainable development, strong sustainability, weak sustainability, social economy,
social utility, social enterprises, growth, index
1
amanar.akhabbar@unil.ch, sophie.s[email protected]

C
OLLOQUE INTERNATIONAL FRANCOPHONE
,
« L
E DEVELOPPEMENT DURABLE
:
DEBATS ET CONTROVERSES
»,
15
ET
16
DECEMBRE
2011,
U
NIVERSITE
B
LAISE
P
ASCAL
,
C
LERMONT
-F
ERRAND
.
2
« Physical infrastructure and social architecture conspire against
us here. Lured by our evolutionary roots, bombarded with
persuasion, and seduced by novelty: we are like children in the
sweet shop, knowing that sugar is bad for us; unable to resist the
temptation », Tim Jackson, 2010, Governance for Prosperity, p.23.
Il existe deux principales manières de concevoir le développement durable. La première, que
nous appelons la méthode traditionnelle, ou encore approche de soutenabilité faible, considère
que, pour survivre aux enjeux énergétiques et climatiques de la croissance, il nous faut
investir massivement dans la recherche et mettre en œuvre de nouvelles technologies et
énergies ainsi que modifier la fiscalité avec l'introduction de droits à polluer et de taxes
carbone notamment. Dans cette perspective, les modèles standards prévoient un taux de
progrès technique confortable et la possibilité de contourner le peak oil. Selon ce scénario, des
énergies renouvelables seront découvertes et l’on pourra continuer à vivre « comme avant » et
rouler dans des voitures hybrides pour aller au supermarché acheter des produits « bio »
2
.
La seconde approche est celle de la vision alternative du développement durable,
encore appelée soutenabilité forte. Selon cette approche, notre croissance actuelle repose sur
la consommation et l'investissement productif pour une société consumériste. Cette société
produit non seulement des externalités négatives sur l’environnement mais aussi des
déséquilibres sociaux et humains: les inégalités nationales et internationales, les diverses
souffrances au travail, un développement humain médiocre, par exemple. Chercher de
nouvelles technologies et de nouvelles énergies ne suffit pas à créer un développement
durable: il faut développer de nouveaux modes de vie, styles de vie, de nouvelles manières
d'entreprendre et de travailler. Par exemple, le développement technique et les institutions
financières ont une lourde tendance à économiser sur le facteur travail, créant ainsi de fortes
pressions sur les salaires, les travailleurs, et générant du chômage structurel et des inégalités.
Dès lors, se fixer comme seul objectif un changement technique et la découverte de nouvelles
énergies ne peut pas régler nos problèmes. Il faut plutôt axer le développement sur la qualité
de la croissance, sur le développement humain et le capital social... Or quel domaine est
mieux placé pour en parler que l'économie sociale?
En effet, l’économie sociale, qui s’appréhende le plus souvent comme un ensemble
d’entreprises coopératives, mutualistes et associatives résultant de personnes, physiques ou
morales, dont elles vont combler les attentes et les besoins, désigne également un mouvement
issu d’expériences et de pratiques se voulant différentes de « l’autre économie ». En ce sens,
l’économie sociale qualifie des formes d’entreprises, distinctes des entreprises privées et des
sociétés de capitaux, notamment par les principes de fonctionnement à l’œuvre et les missions
envisagées. Parmi ces missions, il y a celle de créer du lien social à partir de réalisations
communes non axées sur la croissance à tout prix mais sur une qualité de vie donnant le
primat à la personne plutôt qu’au capital. On parle d’ailleurs de « lucrativité limitée ». Si les
théoriciens ne s’accordent pas toujours sur les contours et les évolutions des organisations de
l’économie sociale, tous reconnaissent néanmoins un ensemble de valeurs et de règles
inhérentes à sa pratique. Parmi les valeurs dites « cardinales » de l’ESS (Draperi 2007), il y a
la responsabilité, l’égalité, l’autonomie et la solidarité. Clairement, en matière d’enjeux, la
fonction essentielle et spécifique de l’ESS, qui la démarque de la logique économique
dominante, est d’innover socialement.
2
Cette approche a été formée dans une large mesure dans le cadre des travaux de la Cowles Foundation et la
Yale University à New-Haven (Connecticut). Voir, pour un exposé des fondements théoriques de cette approche,
Gordon et al. (1987), ainsi que Nordhaus (2008). Pour une approche réflexive, voir Dahan Dalmedico (ed.)
(2007).

C
OLLOQUE INTERNATIONAL FRANCOPHONE
,
« L
E DEVELOPPEMENT DURABLE
:
DEBATS ET CONTROVERSES
»,
15
ET
16
DECEMBRE
2011,
U
NIVERSITE
B
LAISE
P
ASCAL
,
C
LERMONT
-F
ERRAND
.
3
Notre communication analyse la manière dont s'articule l'économie sociale et solidaire
avec les deux principales approches du développement durable. Le développement durable
traditionnel (soutenabilité faible) génère des inégalités, il participe de manière équivoque au
développement humain et au capital social, et il ne privilégie pas la mise en avant de
processus de coopération et des modes d'organisation et de production alternatifs: il serait
donc conflictuel avec l'économie sociale, à la différence du second type de développement
durable, de soutenabilité forte. Ce dernier considère comme prioritaire les multiples inégalités
et imagine de nouvelles manières de vivre et d'entreprendre. Ce développement durable là est
centré sur la qualité de la croissance et redéfinit la prospérité : il serait complémentaire avec
l’économie sociale. Néanmoins, ces deux domaines s’inspirent l’un de l’autre sans pour autant
créer de liens systématiques entre leurs outils, approches et concepts. ESS et DD intègrent
l’une et l’autre des préoccupations empruntées à l’autre domaine. Parfois, comme dans les
travaux de l’ONU on juxtapose les objectifs sans définir les liens précis entre eux.
Finalement, la relation entre ESS et EDD donne l’impression que l’ESS est sur une rive du
progrès économique, celle du monde social et de la culture, et l’EDD sur une autre rive du
progrès économique, celle du monde naturel, et que chacune construit un pont pour rejoindre
l’autre rive. Notre préoccupation est de savoir si ces deux ponts peuvent se rejoindre au milieu
du gué, ou s’ils n’ont aucune chance de se rencontrer ou d’arriver à destination.
Nous montrons, en particulier, que l’ESS et la forme faible du développement durable
n’ont qu’un faible degré de compatibilité et d’affinité. En revanche, la forme forte du
développement durable offre de fortes potentialités d’association avec l’ESS. Néanmoins,
dans ce dernier cas, la relation entre économie sociale et solidaire et développement durable
n’est pas symétrique : l’ESS peut se passer, logiquement, d’une réflexion sur le
développement durable, comme elle l’a fait dans une large mesure jusque là. La relation de
l’ESS vers le DD relève d’une possible alliance fructueuse ; en revanche, la forme forte de
développement durable amène nécessairement à s’interroger sur de nouvelles formes
d’entreprenariat et, à cet égard, trouve dans l’ESS de nombreuses réponses. Partant de là, nous
montrons comment certains éléments de l’une et l’autre approche peuvent générer ensemble
des synergies positives.
L’article est structuré en trois parties. Nous préciserons la manière dont l’ESS est prise
en compte dans la littérature standard du développement durable (section 1), avant de revenir
sur la spécificité des organisations de l’économie sociale et l’absence de lien systématique
avec l’EDD (section 2). Nous montrerons alors comment peut être établie une relation
systématique entre ESS et la forme forte de l’EDD (section 3).
I. L’ESS dans la littérature sur l’EDD
A. Le développement durable entre enjeux économiques, sociaux et naturels
Dans les travaux publiés par les organisations internationales leader en
développement, comme l’ONU, l’OCDE, l’OIT, la FAO et la Banque Mondiale, les enjeux
d’environnement et d’énergie sont venus s’ajouter aux objectifs de développement global, de
justice économique et sociale, et de réduction des inégalités. Ainsi, à la problématique du
développement, au cœur des préoccupations de l’ONU dans les deux décennies 1950 et 1960,
est venue s’ajouter celle de l’environnement et des énergies sans que soit néanmoins pensée
de manière systématique l’articulation entre ces deux préoccupations. Aussi, dans les années
1970 et 1980, les travaux commandés par l’ONU formulaient des objectifs en termes de
développement économique, de réduction des inégalités et de satisfaction des besoins de
bases, ainsi que des objectifs environnementaux et énergétiques.

C
OLLOQUE INTERNATIONAL FRANCOPHONE
,
« L
E DEVELOPPEMENT DURABLE
:
DEBATS ET CONTROVERSES
»,
15
ET
16
DECEMBRE
2011,
U
NIVERSITE
B
LAISE
P
ASCAL
,
C
LERMONT
-F
ERRAND
.
4
A cet égard, l’étude réalisée en 1977 par Wassily Leontief, Anne P. Carter et Peter Petri, The
Future of the World Economy, est typique de cette manière d’aborder objectifs économiques,
sociaux, environnementaux et énergétiques. Dans ce rapport remis à l’ONU, les auteurs
examinent l’alerte de chercheurs comme ceux du Club de Rome sur l’impossibilité d’un
développement économique général semblable à celui des pays de l’OCDE en raison des
limites des ressources naturelles et des conséquences en termes de dégradation de
l’environnement. La conclusion du rapport de Leontief et al., souligne que : (1) Il est
absolument invraisemblable que les inégalités entre pays riches et pays pauvres se réduisent
de manière significatives sur la période 1970-2000, et que, au mieux, elles pouvaient être
stabilisées ; (2) Un développement économique général permettant de satisfaire les besoins de
base de tous est possible car les techniques disponibles le permettent et qu’il n’y a pas de
contrainte énergétique et environnementale forte sur la période considérée ; (3) Que les
limites les plus fortes au développement général sont, d’une part, les problèmes d’endettement
des pays en voie de développement (et de balance des paiements) et, d’autre part, les
problèmes institutionnels et politiques. Ainsi, sans une aide étrangère massive et sans un
changement politique et institutionnel dans les PVD, aucune technologie ne permettra un
décollage économique. Au delà de la pertinence des conclusions du rapport, pourtant très
critiqué lors de sa parution, ce type d’analyse reflète l’absence de réflexion systématique sur
les liens entre enjeux sociaux et enjeux environnementaux et énergétiques : il s’agit de
juxtaposition d’indices et non d’une étude des interdépendances entre enjeux écologiques et
enjeux sociaux.
A partir de la fin des années 1980, avec le rapport Brundtland (1987), cette approche s’est
poursuivie avec l’association de manière systématique d’objectifs sociaux, économiques et
« durables » (environnement, ressources et énergie). Ainsi, en 1992, le Sommet de la Terre à
Rio de Janeiro a conduit à définir trois piliers du développement durable : le progrès
économique, la justice sociale, et la préservation de l’environnement. Néanmoins, là encore la
démarche consiste à empiler les objectifs économiques/sociaux/durabilité.
Toujours est-il que cette approche par trois piliers sert de base pour les nouveaux modes de
gouvernance économique. Dans le cas de la Suisse, la gouvernance de la Confédération
Helvétique repose ainsi sur une définition du développement durable à trois dimensions : « la
solidarité sociale », « l’efficacité économique », et « la responsabilité écologique » :
- La solidarité sociale est définie selon deux postulats principaux : « (1a) Garantie des
droits de la personne humaine : Chaque individu a le droit de vivre dans la dignité et le droit à
l’épanouissement de sa personnalité. La démocratie, le droit et la diversité culturelle sont
garantis ; (1b) Limites de la liberté individuelle : L’épanouissement de la personnalité ne doit
pas se faire aux dépens de la dignité d’autres personnes appartenant aux générations présentes
et à venir. »
- Par ailleurs, l’efficacité économique se définit comme l’ « Ordre économique au
service du bien commun » : « Le système économique doit satisfaire véritablement et
efficacement les besoins de l’individu et de la société. L’ordre économique doit être aménagé
de manière à encourager l’initiative individuelle, mais aussi à mettre l’intérêt personnel au
service du bien commun, de telle sorte que le bien-être des générations présentes et futures
soit assuré ».
- Enfin, la responsabilité écologique repose sur deux principaux postulats : « (15a)
Sauvegarde des ressources naturelles : Les ressources naturelles doivent être sauvegardées
durablement et les dommages existants réparés ; (15b) Sauvegarde de la biodiversité : La
nature doit être sauvegardée dans sa diversité dynamique. »

C
OLLOQUE INTERNATIONAL FRANCOPHONE
,
« L
E DEVELOPPEMENT DURABLE
:
DEBATS ET CONTROVERSES
»,
15
ET
16
DECEMBRE
2011,
U
NIVERSITE
B
LAISE
P
ASCAL
,
C
LERMONT
-F
ERRAND
.
5
Aussi, en Suisse, la définition du développement durable est globale et, à partir des 3
principaux postulats, elle se déploie en 45 postulats.
B. L’économie du développement durable standard : le zoom sur les
ressources naturelles
En l’absence de réflexion systématique sur les liens entre les trois piliers du développement
durable, on constate que, in fine, celle-ci reste largement axée sur les questions
d’environnement, de climat, de ressources naturelles et d’énergie. Ainsi, en dehors des
travaux de grandes organisations comme l’ONU, l’économie du développement durable se
concentre le plus souvent sur deux piliers : progrès et efficacité économique d’une part, et
préservation de l’environnement et gestion des ressources rares d’autre part (voir, par
exemple, Beat Bürgenmeier 2005). De plus, l’articulation entre ces deux piliers est claire : il
s’agit d’intégrer les « contraintes » écologique dans le calcul économique visant à garantir des
performances et l’efficacité économique. Dans cette perspective, la fonction de bien-être
social standard est la somme actualisée des consommations (voir par exemple, Nordhaus
1991). Cette manière « standard » de concevoir le développement durable, qui externalise vers
l’économie sociale les enjeux sociaux et d’équité, correspond dans une large mesure au
courant dit de « durabilité faible ».
Selon cette approche, que nous appelons la méthode traditionnelle, il est considéré que pour
survivre aux enjeux énergétiques et climatiques de la croissance il faut investir massivement
dans la recherche et développement et mettre en œuvre de nouvelles technologies et énergies
ainsi que modifier la fiscalité avec l'introduction de droits à polluer et de taxes carbone
notamment. Dans cette perspective, les modèles prévoient un taux de progrès technique
confortable et la possibilité de contourner le peak oil. Ce type d’analyse s’appuie souvent sur
des modèles macroéconomiques où un agent représentatif effectue un choix intertemporel
avec horizon infini en employant des techniques à facteurs de production substituables et
bénéficiant de larges progrès techniques. On peut se référer ici utilement aux travaux, entre
autres, d’Harold Hotelling (1931), Robert Solow (1974), Nicholas Stern (2006), Roger
Guesnerie (2008), ou encore William Nordhaus (2008).
Dans ce cadre d’analyse, les principaux enjeux éthiques concernent les préférences
intertemporelles des agents. Le problème du caractère éthique des préférences
intertemporelles avait déjà été en partie soulevé par Frank Ramsey (1928), puis, par la suite,
dans le cadre des modèles à générations imbriquées. On retrouve ce problème dans les
questions de justice sociale, d’une part, et de développement durable, d’autre part. A titre
d’exemple, Rawls y consacre des pages dans Théorie de la justice (1971). Ce point peut
prendre une importance cruciale pour les débats sur les retraites par répartition ainsi que pour
l’évaluation de l’effort que chaque génération doit consentir pour préserver les ressources
naturelles et l’environnement. Le choix, en France, comme en Allemagne ou en Suisse, de
poursuivre ou non le développement de l’énergie nucléaire est directement lié aux préférences
intertemporelles dans la mesure où l’essentiel des coûts liés à cette énergie sont reportés sur
les générations suivantes. Toujours est-il que dans cette approche macroéconomique standard,
les questions de développement durable sont d’abord des questions liées aux ressources
naturelles et seulement indirectement aux problèmes de justice sociale. En somme, cette
économie du développement durable ci est plus à rapprocher de l’économie des ressources
naturelles, de l’énergie et de l’environnement que de la conception plus générale du
développement durable de l’ONU.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
1
/
22
100%