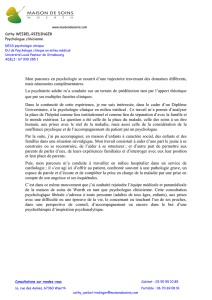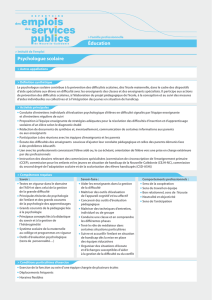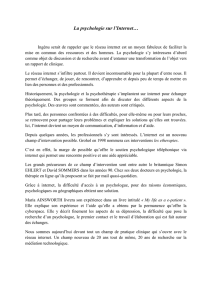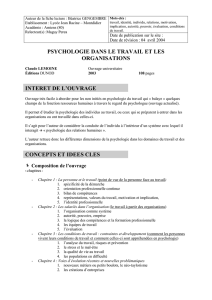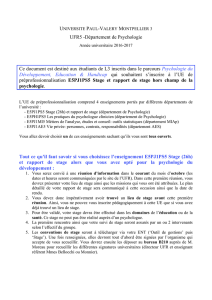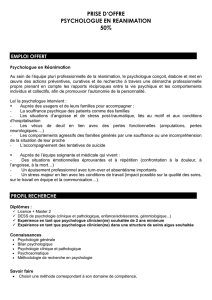La psychologie de la santé : une alliée

16 – L’ACTUALITÉ MÉDICALE – 26 MARS 2014 – WWW.PROFESSIONSANTE.CA
MedActuel DPC
VOTRE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU – VOL. 14 NO 4 26 MARS 2014
RECOMMANDÉ PAR :
SOIGNER EN ÉQUIPE
La psychologie de la santé : une alliée
essentielle pour l’équipe médicale
par Séverine Hervouet, Ph. D.*, et Evelyne Trahan, D. Psy.*, psychologues de la santé
Avec le vieillissement de la population, l’incidence des maladies chroniques augmente et la prise en charge médicale
se complexifie et s’alourdit. En parallèle, le message envoyé par la société est que la santé nous appartient et que nous
avons le pouvoir d’influer sur elle en modifiant nos habitudes de vie. Lorsqu’une visite médicale se conclut par la remise
d’une ordonnance de bêtabloquants et la recommandation d’augmenter le niveau d’activité physique, il y a de fortes
chances que seule la médication soit prise en considération par le patient, étant donné les efforts requis pour suivre
la recommandation. C’est ici que la psychologie entre en jeu.
En 2002, l’Organisation mon-
diale de la santé a fait savoir
que parmi les 10 maladies
répertoriées comme étant les
plus dommageables, au moins six
pouvaient être prévenues ou trai-
tées en partie grâce à des interven-
tions psychologiques1. Pensons
simplement aux maladies cardio-
vasculaires, à l’hypertension, au
diabète et à l’obésité. C’est dans ce
contexte que s’inscrit la pertinence
des interventions offertes par des
psychologues de la santé, d’une ma-
nière de traiter qui dépasse la santé
mentale et intègre la santé phy-
sique.
La psychologie de la santé est un
secteur qui s’inscrit dans une pers-
pective biopsychosociale, c’est-à-
dire qu’elle considère l’humain
comme un tout : ses émotions, ses
pensées et ses attitudes, son envi-
ronnement et ses habitudes de vie
qui peuvent affecter sa santé phy-
sique, et inversement. Elle s’inté-
resse à la prévention, à la promotion
et au maintien de la santé globale2.
L’Association américaine de psy-
chologie la reconnaît, en lui consa-
crant une division à part entière
(Health Psychology - Division 38
de l’American Psychological Asso-
ciation).
Des publications récentes ont ré-
vélé l’importance des interventions
psychologiques non seulement
dans la prévention des maladies
mais également dans la réduction
des taux de mortalité3-5, des temps
d’hospitalisation, de l’observance
du traitement, des délais dans le
retour au travail à la suite d’une
convalescence, et du bien-être
émotionnel.
Le champ d’exercice du psycho-
logue de la santé est vaste et se dis-
tingue de la psychologie générale
par son lien étroit avec la santé phy-
sique (tableau I). Lui est adressée
toute demande qui concerne l’indi-
vidu souffrant d’un problème de
santé, susceptible de présenter des
facteurs psychologiques pouvant
influer soit sur la gestion des symp-
tômes physiques ou des effets
Objectifs pédagogiques
◾ Reconnaître les apports
significatifs du psychologue de
la santé dans le contexte médical
actuel.
◾ Distinguer la psychologie de
la santé de la psychologie
générale.
◾ Connaître les champs
d'intervention spécifiques du
psychologue de la santé pour
mieux référer.
Affiliations
* Clinique Psychologie Santé,
à Québec et CSSS-Alphonse-
Desjardins, site Hôtel-Dieu de
Lévis.
Les auteures ne déclarent aucun
conflit d'intérêts lié à la rédaction
de cet article.
Président du conseil
Dr François Croteau
Directeur médical du
Groupe Santé, Québec,
Rogers Média.
Médecin de famille à la
retraite, anciennement
à l'Hôpi tal Santa-Cabrini,
Montréal;
Ancien président du
comité de DPC du Collège
des médecins du Québec
Dre Johanne Blais
Membre du Conseil de
FMC de la faculté de
médecine
de l’Université Laval;
Responsable du Comité
de FMC du dépt. de
médecine familiale de
l’Université Laval;
Professeur titulaire de
clinique, CHUQ, Hôpital
Saint-François-d’Assise.
Dr Roger Ladouceur
Responsable du Plan
d’autogestion de DPC,
Collège des médecins
du Québec;
Professeur agrégé de
clinique du dépt. de
médecine familiale
de l’Université de
Montréal;
Médecin de famille,
Hôpital de Verdun du
CSSS du Sud-Ouest-
Verdun.
Dre Francine Léger
Médecin de famille;
Professeur adjoint de
clinique au département
de médecine familiale de
l’Université de Montréal;
Service de périnatalité
du CHUM.
Dre Diane Poirier
Médecin, M.Sc.;
Chef du service des
soins intensifs au CSSS
Richelieu-Yamaska;
Professeur
d’enseignement clinique
au CHUS;
Membre du comité de
formation continue de
Médecins francophones
du Canada
Conseil de rédac tion
et révi sion scien ti fi que
TABLEAU I
DISTINCTIONS ENTRE LA PSYCHOLOGIE DE LA SANTÉ ET LA PSYCHOLOGIE GÉNÉRALE
Psychologie de la santé Psychologie générale
Clientèle cible Population qui présente une problématique de santé Population générale
physique ou à risque d’en présenter une
Composante de la santé Physique et mentale Mentale
Modèle théorique Biopsychosocial Psychiatrique
Cible thérapeutique > Amélioration des facteurs psychologiques liés à > Réduction de la détresse
générale l’état de santé psychologique
> Acquisition de saines habitudes de vie > Augmentation du fonctionnement
général
Particularité Collaboration étroite avec l’équipe traitante
TABLEAU II
CHAMPS D’INTERVENTION DU PSYCHOLOGUE DE LA SANTÉ
Champs d’intervention Exemples
Problème psychologique secondaire à un trouble physique > Dépression post-infarctus
> Anxiété face à la récidive d’un cancer
Symptômes somatiques d’un trouble psychologique > Douleur thoracique lors d’une attaque de panique
> Trouble de somatisation
Symptômes physiques répondant à une intervention psychologique > Douleur chronique
> Nausée anticipative
Complications somatiques associées à des facteurs comportementaux > Problème d’observance du traitement
> Ostéoporose associée à la sédentarité
Trouble psychophysiologique > Migraine
> Insomnie
Préparation à une intervention médicale > Chirurgie
> Prélèvement sanguin/injection
Facteurs de risque comportementaux > Tabagisme
> Obésité

WWW.PROFESSIONSANTE.CA – 26 MARS 2014 – L’ACTUALITÉ MÉDICALE – 17
secondaires associés à la maladie
ou aux traitements, l’évolution de
la maladie, l’observance et la
réponse aux traitements, soit sur
l’adaptation psychologique à pro-
prement parler. Par ailleurs, le psy-
chologue de la santé intervient
aussi en réadaptation, dans des
programmes de cessation taba-
gique, ou en prévention des mala-
dies cardiovasculaires, entre autres
domaines.
Les médecins référents peuvent
être issus de la première ligne
(médecine familiale), des milieux
hospitaliers et des différentes spé-
cialités médicales (cardiologie,
hémato-oncologie, médecine
interne, physiatrie, etc.). Tout chan-
gement associé aux grandes étapes
de vie, depuis la naissance (p. ex.,
périnatalité) jusqu’à la fin de vie
(p. ex., soins palliatifs) peut faire
l’objet d’interventions spécifiques
de la part du psychologue de la san-
té. Il importe de souligner que son
rôle va au-delà du patient, c’est-à-
dire qu’il peut être appelé à interve-
nir non seulement auprès des
membres de la famille et des
proches, mais aussi auprès des in-
tervenants de l’équipe traitante à
titre de consultant et de personne-
ressource. De fait, le travail du psy-
chologue de la santé est étroite-
ment lié au plan de traitement
médical, et des communications
fréquentes sont à privilégier afin
d’arrimer les objectifs thérapeu-
tiques poursuivis aux besoins de
chaque patient.
Concrètement, la prise en charge
par le psychologue de la santé né-
cessite au préalable une évaluation
biopsychosociale rigoureuse afin
de mettre en perspective les fac-
teurs psychologiques prédisposants
et précipitants relatifs au problème
de santé d’une part; toutefois, le cli-
nicien s’attardera particulièrement
aux facteurs qui tendent à mainte-
nir les difficultés de la personne.
D’autre part, les facteurs biopsy-
chosociaux de protection, à savoir
les forces, les capacités de résilience
et les qualités personnelles de cette
dernière, seront mis de l’avant
puisque c’est sur eux que le clinicien
s’appuiera en psychothérapie pour
favoriser une meilleure adaptation
psychologique (tableau III). Telles
que mentionnées ci-haut, les inter-
ventions psychologiques sont va-
riées, spécifiques, et reposent sur
des approches basées sur des don-
nées probantes.
Historiquement, l’émergence de
la psychologie de la santé a été in-
fluencée par des courants forts du
20e siècle, comme la médecine psy-
chosomatique, la médecine com-
portementale et l’approche psycho-
dynamique. Actuellement, les
recherches dans le domaine font
consensus et viennent appuyer les
interventions cognitives-compor-
tementales traditionnelles et celles
dites « de troisième vague », qui in-
cluent la méditation favorisant la
pleine conscience et l’acceptation.
D’autres moyens ciblés tels que l’en-
trevue motivationnelle peuvent
également faire partie de l’éventail
des interventions psychologiques
surtout dans un contexte de résis-
tance du patient devant un traite-
ment médical proposé ou un chan-
gement d’habitude de vie à adopter.
Le domaine de la psychologie de
la santé a émergé aux États-Unis et
tend à se développer au Canada
ces dernières années. En termes de
formation universitaire, une nou-
velle concentration en psychologie
clinique de la santé vient de voir le
jour cet automne au Québec, plus
spécifiquement à Québec (Pro-
gramme doctoral de l’École de
psychologie de l’Université Laval).
La place de la psychologie de la
santé ainsi soutenue par le milieu
universitaire représente un atout
important pour sa reconnaissance
aux yeux de tous, pour son inté-
gration dans nos établissements
de soins de santé et pour faciliter le
développement de cliniques spé-
cialisées. Cette discipline n’en est
plus à ses balbutiements, la collabo-
ration du psychologue de la santé
avec les équipes médicales trai-
tantes s’avérant désormais néces-
saire pour assurer à la fois le bien-
être du patient et une meilleure
planification du plan de traitement
par le médecin. <
Références
1. World Health Organization (2002). The
World Health Report 2002: Reducing
Risks, promoting Healthy Lifestyles.
Geneva. World Health Organization.
2. Matarazzo, JD. (1982). Behavioural
Health’s Challenge to Academic, Scientific
and Professional Psychology. American
Psychology, 37, 1-14.
3. Arnett JL (2001). Clinical and Health
Psychology: Future Directions. Canadian
Psychology, 42, 38-48.
4. Arnett, JL, Nicholson IR, Breault, L.
(2004). Psychology’s Role in Health in
Canada: Reaction to Romanow and
Marchildon. Canadian Psychology, 45,
228-32.
5. Kaplan, R. (2009). Health Psychology:
Where we are and where do we go from
here. Mens Sana Monograph, 7, 3-9.
TABLEAU III
MATRICE D’ANALYSE BIOPSYCHOSOCIALE
Composantes Facteurs
prédisposants précipitants de maintien protecteurs
Biologique × × × ×
Émotionnelle × × × ×
Cognitive × × × ×
Comportementale × × × ×
Environnementale × × × ×
Téléphone : 450-973-2228 www.cqmf.qc.ca
Développer, valoriser et promouvoir
l’excellence en médecine de famille
Dominique Deschênes,
M.D., CCMF
Présidente du CQMF
Anne-Patricia Prévost,
M.D., CCMF
Vice-présidente
au développement
professionnel continu
Lésions musculo-squelettiques et gestion de l’invalidité
L’INTERprofessionalisme au premier plan !
Une formation adaptée à la pratique
Les 29 et 30 mai prochain, le Collège québécois des
médecins de famille (CQMF) en collaboration avec
le Groupe Santé Caméléo vous propose une activité
inédite de développement INTERprofessionnel
continu :
Lésions musculo-squelettiques et gestion
de l’invalidité
.
La collaboration INTERprofessionnelle est en
effet omniprésente dans notre pratique courante
en GMF, en UMF et en centre hospitalier. Le travail
d’équipe devient essentiel pour favoriser l’atteinte
d’objectifs reliés à l’efficacité de la prise en charge
des patients, et par le fait même, à l’amélioration
de leur qualité de vie, particulièrement chez les
patients atteints de maladies chroniques.
Développée par une équipe d’experts, composée de
médecins de famille, de médecins spécialistes en
musculo-squelettique et en douleur chronique,
d’un physiothérapeute et d’une ergothérapeute,
cette activité vise à améliorer la collaboration entre
les professionnels de la santé et la qualité des soins
prodigués aux patients.
Une formation centrée sur le patient
Tout au long de cette formation, vous suivrez le
parcours complet d’un patient avec une douleur
musculo-squelettique. Ce même patient :
• que vous rencontrez en douleur aiguë à votre
bureau ou au sans rendez-vous ;
• chez qui vous dépistez des facteurs de risque de
chronicité;
• que vous examinez et qui vous rapporte des
formulaires à remplir;
• que vous revoyez dans votre bureau pour
définir un plan de traitement;
• que vous référez aux autres professionnels de
la santé;
• celui qui vous expose ses craintes, ses inquié-
tudes et dont les douleurs se chronicisent.
Dans le cadre de ce congrès vous apprendrez, sous
forme d’ateliers pratiques et de tables rondes,
à répondre aux questions de votre patient, à le
rassurer, à le motiver et à l’aider à surmonter
ses déficiences et ses incapacités afin de réduire
son handicap.
Collaboration, communication et
travail d’équipe sont au rendez-vous!
Une activité accréditée qui répond à vos besoins.
Inscrivez-vous !
LE TRAVAIL DU PSYCHOLOGUE
DE LA SANTÉ EST ÉTROITEMENT LIÉ
AU PLAN DE TRAITEMENT MÉDICAL.
1
/
2
100%