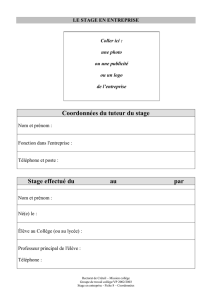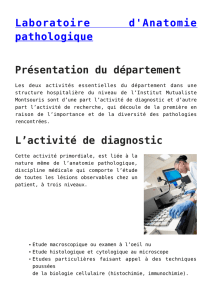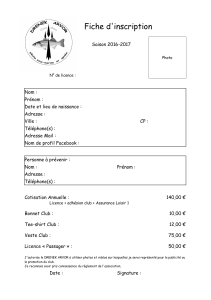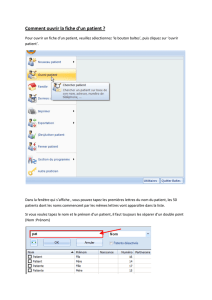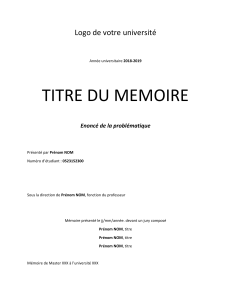france dimanche 050914 - Institut Mutualiste Montsouris


SPA
Thierry Beaudet, président du groupe MGEN, la mutuelle générale de l'éducation nationale
4 septembre 2014
© Le Monde, 2014. Tous droits réservés.
Instituteur de métier, Thierry Beaudet préside l'Union mutualiste qui gère les établissements sanitaires et
médico-sociaux des mutuelles de la fonction publique, notamment l'Institut Mutualiste Montsouris, à Paris.

Lundi 1er Septembre 2014
AVIS D'EXPERT
Quantification du rétrécissement aortique : reste-t-il une place
pour le cathétérisme cardiaque en 2014 ?
Le rétrécissement aortique (RAo), maladie dégénérative de la valve ou évolution sténosante
d'une bicuspidie, touche environ 1 % des patients de plus de 65 ans. Le remplacement valvulaire
aortique est discuté lorsque le RAo est sévère et que le patient présente des symptômes en
rapport avec la sténose aortique ou lorsque le RAo est très sévère, même sans symptôme.
L'essor récent de l'implantation des valves aortiques percutanées (TAVI) tend à
s'accompagner d'une augmentation de l'évaluation diagnostique par cathétérisme cardiaque
alors que la valeur diagnostique et pronostique de l'écho-Doppler cardiaque est largement
démontrée.
Définir la sévérité d'un RAo peut
apparaître simple de prime abord
lorsqu'on se réfère aux
recommandations (vélocité maximale
transvalvulaire > 4 m/s, gradient
moyen > 40 mmHg, surface
fonctionnelle (SF) < 1 cmou 0,6
cm/m, indice de perméabilité ITV
sous-aortique/ITV aortique < 0,25).
Cependant en pratique clinique, dans
au moins 30 % des cas on observe une
discordance entre ces différents
paramètres. Le diagnostic de RAo
serré repose historiquement sur des
mesures réalisées en cathétérisme
cardiaque nécessitant le
franchissement de la valve aor-tique.
Cependant une série prospective
randomisée com-parant
coronarographie diagnostique avec (n
= 101) ou sans (n = 51)
franchissement de la sténose
valvulaire, démontrait que le taux
d'AVC ischémiques détectés par IRM
cérébrale (avant et après le
cathétérisme cardiaque) était de 22 %,
dont 3 % avec déficits neurologiques
cliniques dans le groupe
franchissement alors qu'il était de 0 %
dans le groupe coronarographie
simple. La quantification du RAo
devrait en pratique clinique reposer en
première ligne uniquement sur des
méthodes non invasives : écho-
Doppler cardiaque systématique, et
parfois d'autres examens
complémentaires comme le score
calcique valvulaire par scanner ou
l'échographie transœsophagienne. La
coronarographie doit être réalisée
lorsqu'un remplacement valvulaire
aortique est envisagé chez un patient
à risque de coronaropathie. Le
franchissement de la valve doit rester
exceptionnel, et ne devrait être
effectué à titre diagnostique que
lorsqu'il y a discordance entre la
présence de symptômes et des
données non invasives
rassurantes(3,4) . Si l'on obtient alors
des différences entre les données
échographiques et les données
invasives, celles-ci ne doivent pas être
interprétées comme des erreurs de
mesure.
Figure 1. L'utilisation de la sonde
Pedoff par voie parasternale droite
a permis d'enregistrer une vélocité
maximale de 6 m/s (à droite) alors
qu'elle était de 4 m/s par voie
apicale (à gauche).
I Les discordances KT-Doppler
proviennent donc du fait que nous
ne mesurons pas la même chose
Évaluation du RAo par écho-
Doppler
L'évaluation d'un RAo par écho-
Doppler cardiaque (comme pour
toutes les valvulopathies en général)
repose sur des mesures systématiques
entre des mains expertes. L'estimation
des gradients de pression P par
Doppler se fonde sur des mesures de
vitesses (Vvao ) transvalvulaires des
hématies (HE) par effet Doppler et
l'alignement du faisceau Doppler sur
le flux doit être optimal Vvao =V HE
xcos . Ainsi, un angle de 30° revient à
minorer les vitesses de 14 %. Pour
cette raison l'utilisation de plusieurs
voies(voies parasternale droite avec
l'indispensable sonde Pedoff, sous-
costale, suprasternale, etc.) doit être
systématique pour obtenir un
alignement optimal avec le flux
transvalvulaire (figure 1). Un travail
de l'équipe de David Messika-Zeitoun
démontre que dans 21 % des cas la
sévérité du RAo est sous-estimée en
l'absence d'enregistrement des
vitesses par sonde Pedoff. Les
vitesses Doppler sont ensuite dérivées
en gradient de pression P par
l'équation de Bernoulli P = 4x(Vvao V
2 ccvg) ; les vitesses sous-aortiques
(CCVG) sont négligées si elles sont <
1,5 m/s et le calcul devient P = 4xV2
vao. Les vitesses maximales et les

gradients dérivés en Doppler sont
mesurés au niveau de la vena
contracta située quelques millimètres
en aval de la surface anatomique
réelle, du fait d'une accélération
maximale post-sténotique du flux
sanguin (figure 1) .
Le gradient moyen transvalvulaire est
la différence moyenne de pression
divisée par le temps d'éjection. On
comprend d'emblée que lorsque la
durée de la systole se raccourcit et que
le débit transvalvulaire augmente
(exercice, dobutamine, etc.) le
gradient moyen augmente, excepté en
cas de diminution importante du
volume trans-valvulaire (dysfonction
VG, élévation excessive de la pres-
sion artérielle systémique). L'autre
mesure échographique cruciale est
celle du diamètre (D) de la jonction
aorto-ventriculaire à l'insertion des
sigmoïdes (ou communément anneau
aortique) ; chaque millimètre d'erreur
est porté au carré ( S ccvg = p x S D/4)
et donc produit une variation de 0,1
cmde surface effective. Ainsi la
surface valvulaire effective ou
fonctionnelle du RAo (SF) est dérivée
de l'équation de continuité : SF =
(ITVccvg xS ccvg )/ ITV vao. Le
produit ITV ccvgxS ccvg est une
mesure du flux transvalvulaire que
l'on indexe à la surface corporelle
(ml/m), il définit si la sténose a été
évaluée dans des conditions de bas
débit (< 35 ml/m) ou de débit
transvalvulaire normal ou élevé (= 35
ml/m).
Comme il existe une accélération du
flux sanguin dont la vitesse maximale
est quelques millimètres au-delà de la
sténose, c'est donc la surface de la
vena contracta (endroit le plus étroit
où la vélocité Doppler des hématies
est maximale = Vmax) qui est estimée
par écho-Doppler et non pas une
surface anatomique (figure 2) . Le
développement du scanner et aussi de
l'échocardiographie tridimensionnelle
a permis de mieux étudier la jonction
aortoventriculaire (anneau aortique
basal, qui est très souvent non
circulaire) en particulier en cas de
bicuspidie pouvant expliquer
certaines discordances surface-
gradient. Le flux sous-aortique doit
être laminaire en prenant la valeur
maximale à proximité de la jonction
ven-triculo-aortique en coupe apicale
5 cavités. En cas de bourrelet sous-
aortique associé à une accélération du
flux sous-aortique, il est recommandé
de se placer (aussi bien pour le mode
Doppler pulsé que pour la mesure de
la CCVG) en amont de la jonction
aorto-ventriculaire dans la chambre
de chasse du VG à un endroit où le
flux est laminaire afin de ne pas
surestimer le débit transvalvulaire et
par conséquent la surface
fonctionnelle du RAo.
Figure 2. Les mesures Doppler
évaluent la surface valvulaire
effective ou fonctionnelle qui n'est
autre que la surface de la vena
contracta ; la vélocité y est
maximale (Vmax) et la pression
minimale. Lorsque l'aorte
ascendante est de petite taille,
l'énergie cinétique est partiellement
reconvertie en énergie potentielle.
Cette restitution de pression est à
l'origine de discordances entre les
mesures Doppler et les mesures de
gradient par cathétérisme
cardiaque.
Évaluation du RAo par
cathétérisme cardiaque
L'évaluation du RAo par cathétérisme
cardiaque nécessite tout d'abord la
réalisation d'un cathétérisme gauche
pour étudier les gradients de pression
transvalvulaire. Le cathétériseur
mesure ainsi directement un gradient
(une différence) de pression entre le
ventricule gauche et l'aorte sus-
tubulaire. Le gradient moyen de
pression et le gradient maximal
obtenus en hémodynamique sont
représentés dans la figure 3 . Le
fameux gradient pic-à-pic ne doit pas
être utilisé en pratique clinique car il
n'a pas de réalité physiologique : les
pics de pression VG et aortique ne
sont pas simultanés et sont d'autant
plus décalés dans le temps que le RAo
est serré. L'examen doit être complété
par un cathétérisme cardiaque droit
pour évaluer le débit cardiaque ; la
surface aortique pouvant alors être
évaluée à partir de la formule de
Gorlin (validée sur l'orifice mitral) :
surface aortique = Qc/(temps
d'éjection systolique) xv GM x
constante(Gorlin et Gorlin).
La formule de Gorlin est souvent
considérée comme « référence »,
surtout pour des raisons historiques
car elle a précédé l'évaluation
échocardiographique. En fait, la
valeur de la constante a été
déterminée dans des conditions
normales de débit et par conséquent sa
validité en cas de bas débit est
discutable.
La pression aortique invasive est
mesurée non pas au niveau de la vena
contracta mais quelques centimètres
plus haut dans l'aorte où une partie de
l'énergie cinétique a pu être
reconvertie en énergie potentielle,
restitution (ou recouvrement) de
pression d'autant plus importante que
l'aorte ascendante est de petite taille
(figure 2) (7) . Pour réconcilier les
mesures dérivées du Doppler et celles
du cathétérisme, H. Baumgartner et
coll. ont proposé une formule pour
estimer la restitution de pression («
pressure recovery ») : G rest = P3-P2
= 4Vx 2 x SF/SAorte x (1-SF/SAorte
) ; SAorte étant la surface de section
aortique mesurée environ 1 cm en
aval de la jonction sino-tubulaire. L'
Energy Loss Index (indice de perte
d'énergie) est une surface
fonctionnelle « corrigée » qui tient
compte du phénomène de restitution
de pression en cas de petite aorte et
qui finalement correspond à la surface
hémodynamique par la méthode de
Gorlin : ELI = SF x SAorte /(S Aorte
- SF) ; SAorte étant la surface de
l'aorte 1 cm au-delà de la jonction
sino-tubulaire. Une sous-étude de
SEAS montre que le calcul de l'ELI
reclasse 47 % des patients ayant un
RAo serré par équation de continuité
dans le groupe des patients avec un
RAo non serré. La même équipe
démontre la valeur pronostique
additionnelle de l'ELI pour prédire les
événements combinant remplacement
valvulaire aortique, insuffisance
cardiaque valvulaire et décès
cardiovasculaire.
Ainsi pour un patient donné avec une
sténose aortique associée à un
gradient moyen de 30 mmHg,
maximal de 50 mmHg, une surface
fonctionnelle de 0,85 cmet un
diamètre aortique de 2,4 cm on peut, à
partir des équations citées ci-dessus,
calculer la discordance KT-Doppler
(restitution de pression : 30 mmHg) et
l'ELI (1,05 cm).
Il est important de souligner que la
qualité des courbes de pression doit
être vérifiée et qu'elle est souvent
inférieure avec l'utilisation courante
des sondes 4 F par rapport à celle
obtenue avec des sondes 6 ou 7 F. Les
tubulures de raccordement doivent

être les plus courtes possibles. Les
tracés de pression sur-ou sous-
amortis, les artéfacts liés aux
oscillations de cathéter, la formation
de petits thrombi, le blocage du
cathéter doivent être détectés et
corrigés.
Les autres causes de discordance entre
le cathétérisme et l'échocardiographie
peuvent résulter de différences entre
le niveau de pression artérielle entre
mesures invasives et non invasives.
En effet, la pression artérielle
systémique est un déterminant majeur
des gradients transvalvulaires et de la
surface valvulaire. L'augmentation de
la charge tensionnelle réduit les
gradients transvalvulaires ; la surface
fonctionnelle augmente ou diminue
en fonction de l'importance de la
baisse du débit transvalvulaire
(augmentation du stress pariétal
ventriculaire gauche). En pratique
clinique, la réévaluation du RAo est
conseillée après normalisation de la
pression artérielle.
I Place du cathétérisme cardiaque
en 2014
Lorsque le diagnostic de RAo serré
avec FEVG normale est basé sur des
données concordantes (G moyen > 40
mmHg, Vmax > 4 m/s), les mesures
hémodynamiques invasives sont
inutiles (voire dangereuses) ; la seule
question qui se pose est de savoir si le
patient est symptomatique ; le test
d'effort a ici toute sa place (3,4). En
cas de RAo serré avec dysfonction
VG et gradients transval-vulaires
élevés, l'indication opératoire est
posée.
En cas de RAo serré (SF < 1 cm) avec
fraction d'éjection basse avec bas
débit transvalvulaire et bas gradient
(gradient moyen < 30-35 mmHg) la
problématique sera de s'assurer de la
sévérité du rétrécissement aortique et
d'évaluer le pronostic après
remplacement valvulaire par l'étude
de la réserve contractile (échographie
sous perfusion de dobutamine). La
coronarographie permet de
diagnostiquer une maladie coronaire
associée. Le score calcique valvulaire
aortique peut aussi dans cette situation
permettre d'affirmer la sévérité de la
sténose.
Figure 3. Enregistrement par sonde
Millar (permettant d'éviter les
artéfacts liés aux sondes de
cathéter) de courbes ventriculaire
gauche et aortique. Notez que le
gradient pic-à-pic n'a pas de réalité
physiologique.
La description du RAo serré à bas
débit/bas gradient paradoxal malgré
une FEVG conservée associe SF < 1
cmou 0,6 cm/m, gradient moyen < 40
mmHg, bas débit transvalvulaire (<
35 ml/m) est plus récente. Ces patients
(environ 10 % des patients porteurs
d'un RAo serré) sont le plus souvent
des femmes âgées hypertendues avec
un remodelage concentrique du VG
(volume télédiastolique diminué et
donc volume d'éjection systolique
réduit). Une méthode de validation
interne des données échographiques
est de s'assurer que le volume éjecté
estimé à partir de la méthode Simpson
et/ou 3D est proche de celui estimé à
partir du Doppler sous-aortique. Cette
entité est apparue dans les dernières
recommandations de l'ESC et de
l'ACC-AHA. Bien que toujours
controversée, une prise en charge
chirurgicale ou percutanée peut être
envisagée chez ces patients s'ils sont
symptomatiques et seulement si la
réalité et la sévérité de la sténose ont
pu être vérifiées. L'évaluation du
score calcique valvulaire aortique est
particulièrement intéressante dans ces
cas discordants. Le cathétérisme
cardiaque peut être également indiqué
chez ces patients afin de valider les
mesures échocardiographiques de
gradient, de débit transvalvulaire et de
surface. Le test d'effort parfois
complété par une échographie
concomitante permet d'aider à la
décision pour ces patients
d'évaluation complexe et de façon
générale pour les patients chez qui les
symptômes semblent discordants par
rapport aux données Doppler.
Le cathétérisme cardiaque est
également indiqué pour réaliser une
coronarographie préopératoire
(excepté chez le jeune patient âgé de
moins de 40 ans sans facteur de risque
cardiovasculaire ni symptôme
d'angine de poitrine ni de signes
d'ischémie myocardique ni
dysfonction ventriculaire gauche),
éventuellement associée à un
cathétérisme cardiaque droit pour
évaluer une hypertension pulmonaire
disproportionnée. Le franchissement
de la valve ne devrait être réalisé que
pour réaliser une valvuloplastie au
ballon et/ou implanter une valve
percutanée.
Le cathétérisme cardiaque pour des
mesures hémodynamiques n'est pas
recommandé lorsque les données
cliniques sont concordantes avec les
tests non invasifs (classe III
ACC/AHA). Ni le cathétérisme
cardiaque pour des mesures
hémodynamiques ni la
coronarographie ne sont
recommandés chez les patients
asymptomatiques (classe III
ACC/AHA)(3,4) .
EN PRATIQUE
Le compte rendu échographique
d'un rétrécissement aortique doit
donc comporter au minimum (en
plus de l'évaluation de la fonction
diastolique, de la fonction
ventriculaire droite etc.) :
- fraction d'éjection du VG,
dimensions du VG ;
- degré de calcification valvulaire ;
- diamètre de la jonction aorto-
ventriculaire (ou anneau aortique) ;
- volume d'éjection systolique
indexé (ml/m) calculé à partir de
l'ITV sous-aortique ;
- sur le flux aortique (Doppler
continu, plusieurs fenêtres) :
gradient moyen, gradient maximal
ou vélocité maximale
transvalvulaire (Vmax), ITV ;
- surface aortique (indexée sauf
chez le patient obèse) ;
- diamètre de l'aorte à la jonction
sino-tubulaire ou au niveau de
l'aorte sus-tubulaire ;
- fréquence cardiaque et pression
artérielle lors de
l'échocardiographie.
Références 1.Minners J et al.
Inconsistencies of echocardiographic
criteria for the grading of aortic valve
stenosis. Eur Heart J 2008 ; 29 : 1
043-8.
2.Omran H et al. Silent and apparent
cerebral embolism after retrograde
catheterisation of the aortic valve in
valvular stenosis: a prospective,
randomised study. Lancet 2003 ; 361
: 1 241-6.
3.Nishimura RA et al. 2014
AHA/ACC guideline for the
management of patients with valvular
heart disease: a report of the
American College of
Cardiology/American Heart
Association Task Force on Practice
Guidelines. J Am Coll Cardiol 2014 ;
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
1
/
89
100%