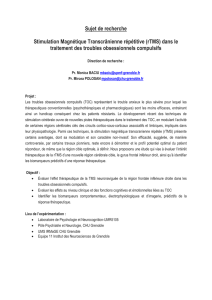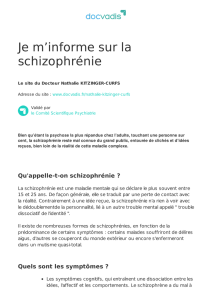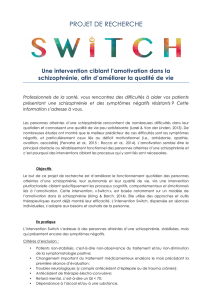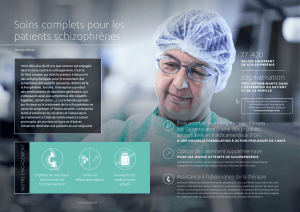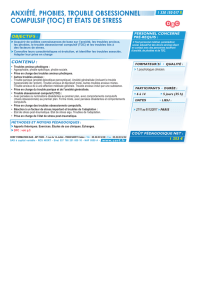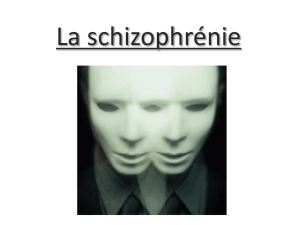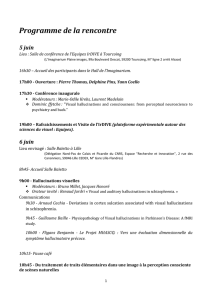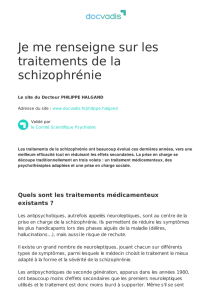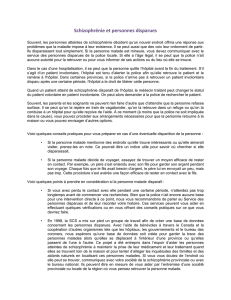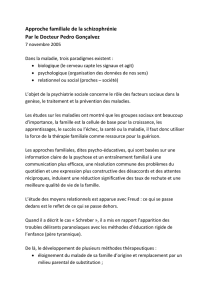Fréquence des symptômes et du trouble obsessionnel

L’Encéphale, 2006 ;
32 :
41-4, cahier 1
41
CLINIQUE
Fréquence des symptômes et du trouble obsessionnel compulsif
chez les personnes atteintes de schizophrénie et leur importance
pour le pronostic
A. ÜÇOK
(1)
, R. TÜKEL
(1)
, G. OZGEN
(2)
, M. SAYLAN
(1)
, G. UZUNER
(2)
(1) Clinique de Psychiatrie de la Faculté Médecine d’Istanbul, Turquie.
(2) Hôpital des Maladies Psychiatriques de Bakirköy, Istanbul, Turquie.
Travail reçu le 8 janvier 2001 et accepté le 7 octobre 2004.
Tirés à part :
A. Üçok (à l’adresse ci-dessus).
Résumé.
L’objectif est d’étudier la fréquence de la concomi-
tance du trouble et des symptômes obsessionnels compulsifs
(SOC) chez les schizophrènes et leur relation avec l’évolution
de la maladie. Un échantillon de 73 patients, hospitalisés dans
le Service de Psychiatrie de la Faculté de Médecine d’Istanbul
et dans la 4
e
unité de l’Hôpital des Maladies Psychiatriques
de Bakirköy, répondant aux critères du DSM III-R pour la schi-
zophrénie, n’étant pas en phase aiguë d’exacerbation selon
l’échelle de la schizophrénie ont été examinés. Les sujets ont
été évalués à l’aide de la liste de contrôle des symptômes OC,
sur l’échelle Obsessionnels Compulsifs de Yale-Brown (Y-
BOCS) et la GAF. La fréquence de concomitance du trouble
obsessionnel compulsif chez les patients schizophréniques
était de 9,6 %, et des symptômes compulsifs obsessionnels
ont également été détectés chez 31,5 % des patients. Ce sont
les obsessions d’agression qui se sont révélées le plus fré-
quemment. Les résultats suggèrent que les SOC sont plus fré-
quents chez les patients qui ont des points de fonctionnalité
supérieurs à 45 points. Les tentatives de suicide dans l’histoire
psychiatrique étaient significativement plus nombreuses chez
les patients présentant ces symptômes obsessionnels com-
pulsifs. Nos résultats indiquent que des symptômes obses-
sionnels compulsifs se rencontrent plus fréquemment que ce
qui avait été précédemment rapporté, et ont certains effets
négatifs sur l’évolution de la schizophrénie.
Mots clés :
Comorbidité ; Schizophrénie ; Symptômes obsession-
nels compulsifs ; Trouble obsessionnel compulsif.
Frequency of obsessive compulsive symptoms and disorder in patients with schizophrenia : importence
for prognosis
Objective.
The objective is to study the comorbidity rate of obsessive compulsive disorder and obsessive compulsive
symptoms in patients with schizophrenia and their relation with the course of this illness.
Design.
73 out-patients from
Istanbul Medical Faculty Department of Psychiatry and 4th Unit of Bakirköy Mental Hospital who met the DSM III-R criteria
for schizophrenia were recruited for this study. Other inclusion criteria were being out of acute exacerbation phase of schi-
zophrenia. Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale, Yale Brown Obsessive Compulsive Symptom Screening Inventory
were applied to patients.
Results.
Comorbidity rate of obsessive-compulsive disorder in patients with schizophrenia was
9.6 %, and also obsessive compulsive symptoms were detected 31 % of patients. Aggressive obsessions were seen most
frequently. These symptoms were also reported more frequently in the patients whose Global Assessment of Functionality
score was higher than 45 points. Suicide attempts in psychiatric history were significantly higher for patients with obsessive-
compulsive symptoms.
Conclusion.
Our findings indicate that obsessive-compulsive symptoms are seen more frequently
than previously reported, and have no major effect upon the course of schizophrenia.
Key words :
Comorbidity ; Obsessive-compulsive disorder ; Obsessive-compulsive symptoms ; Schizophrenia.

A. Üçok
et al.
L’Encéphale, 2006 ;
32 :
41-4, cahier 1
42
INTRODUCTION
Bien que la schizophrénie et le trouble obsessionnel
compulsif proviennent de causes différentes, au niveau de
la symptomatologie ils partagent des caractéristiques
communes (4, 22).
À peu près depuis une centaine d’années, on définit la
coexistence des symptômes obessionnels compulsifs
(SOC) et/ou du trouble obsessionnel compulsif (TOC)
chez les schizophrènes. Westphal, en 1878 a défini le syn-
drome obsessionnel compulsif comme une variété ou un
précédent de la schizophrénie (21). Bleuler prétend que
le vrai diagnostic de certains malades obsessionnels chro-
niques est la schizophrénie (3). En particulier, au début
de la première moitié du
XXe
siècle, des articles ont attiré
l’attention sur la possibilité de la transformation du trouble
obsessionnel compulsif en schizophrénie (9). D’autres
articles, de plus en plus nombreux aujourd’hui, préten-
daient le contraire dès cette époque. Par exemple, en
1935, Lewis affirme que, malgré que le trouble obsession-
nel compulsif soit une affection chronique et débilitante,
le pourcentage de la transformation vers la schizophrénie
est très faible (15). Stengel prétend que les symptômes
névrotiques du trouble obsessionnel compulsif sont une
partie des mécanismes de défense (19). Insel et Akiskal
affirment que le degré de conscience des troubles obses-
sifs compulsifs peut varier selon un large spectre et que
les malades se trouvant à l’extrémité de ce spectre mani-
festent des psychoses obsessives compulsives (10).
Au point de vue phénoménologique, on constate la pos-
sibilité d’une relation proche entre l’obsession, la pensée
surestimée et l’idée délirante. La différence est détermi-
née par le sens qu’on attribue à la pensée et le niveau de
la croyance à cette pensée. Par conséquent, quand la
résistance à ces obsessions disparaît et que la conscience
est perdue, l’obsession évolue vers le délire (13).
L’idée que la schizophrénie est une maladie hétéro-
gène a accentué les recherches sur les sous-groupes de
cette maladie. Aussi, les études sur des schizophrènes
avec des symptômes et/ou troubles obsessionnels com-
pulsifs, font des efforts pour rechercher un sous-groupe
au point de vue phénoménologique et de réponse au trai-
tement. La fréquence des symptômes obsessionnels
compulsifs que l’on rencontre chez les schizophrènes se
situe entre 25 % et 31,5 % dans les recherches récentes
(20-1). La différence entre les proportions provient de la
divergence des définitions et des méthodes. Par exemple,
dans les recherches basées sur l’exploration des dossiers,
la fréquence des symptômes obsessionnels compulsifs
est plus faible. Dans une recherche épidémiologique de
champ aux États-Unis, la fréquence de la coexistence du
trouble obsessionnel compulsif chez les schizophrènes
est de 12,8 % (12) tandis que, dans une autre recherche
réalisée par Eisen
et al.
(6) en utilisant un entretien struc-
turé et des critères standardisés, la fréquence constatée
est de 7,8 %. Deux autres études plus récentes (14, 16)
ont annoncé que les taux des TOC concomitants chez les
schizophrènes est de 15 % et 31 %. Quant à l’effet de ces
symptômes sur le pronostic de la schizophrénie, en géné-
ral on affirme que les compulsions ont un effet négatif (1,
7, 23). Certains auteurs ont déjà constaté chez les patients
qui ont des symptômes compulsifs, une réduction à une
perte d’autonomie, un début précoce de la maladie (1, 7).
En outre, dans ces 2 études précédentes, il est affirmé que
chez les schizophrènes souffrant de symptômes obses-
sionnels compulsifs, l’âge de déclenchement de la mala-
die est plus jeune. Le but de cette recherche est, en utili-
sant les méthodes du diagnostic et d’entretien structuré,
d’explorer la fréquence des symptômes et du trouble
obsessionnel compulsif chez les schizophrènes. En plus,
il s’agit d’examiner les relations de ces symptômes avec
le pronostic et d’autres paramètres cliniques.
MÉTHODE
Des personnes atteintes de schizophrénie selon les cri-
tères de la classification du DSM III-R et hospitalisées
dans les services de psychiatrie de la Faculté de Médecine
d’Istanbul ou dans les services de la 4
e
division de l’hôpital
psychiatrique de Bakirköy sont recrutées pour cette
recherche. Le consentement éclairé des sujets est obtenu
avant de les inclure dans l’étude. Le diagnostic de la schi-
zophrénie et (s’il existe) du trouble obsessionnel compulsif
est confirmé par l’utilisation de l’entretien structuré SCID-I
(18). Ceux qui se trouvent à la phase aiguë de la maladie
sont exclus. La phase d’exacerbation décrit la période
pendant laquelle on constate une détérioration de la fonc-
tionnalité par la suite des symptômes du groupe A des cri-
tères diagnostiques de la schizophrénie, et que la note de
l’impression globale clinique (GCI) est ainsi estimée égale
ou plus grande que 4. À cette fin, les évaluations ont été
faites avant leur sortie de l’hôpital et pour ceux qui ont une
note de l’impression globale clinique, égale ou inférieure
à 3.
La liste d’exploration des symptômes de Yale-Brown (8)
a été appliquée aux patients par les psychiatres. Les
patients ont été interrogés en détail sur les thèmes spé-
ciaux comme l’agression pour distinguer si cette pensée
est une obsession ou un délire. L’existence d’un symp-
tôme obsessionnel compulsif est déterminée au moins par
2 symptômes de groupes différents persistant au mini-
mum depuis 1 mois. Même si le patient exprimait la per-
sistance des symptômes dans le passé, et s’il ne les avait
pas au moment de l’examen, il n’a pas été inclus au groupe
des SOC. En outre, pour ceux qui confirment le diagnostic
du trouble obsessionnel compulsif, on a appliqué l’échelle
du trouble obsessionnel compulsif de Yale-Brown (8, 11)
(Y-BOCS) formée de 11 titres. Les caractères socio-
démographiques et cliniques sont évalués par un entretien
semi-structuré. Au moment de l’évaluation, la gravité de
la maladie et le niveau du fonctionnement sont estimés
consécutivement selon les échelles de l’impression glo-
bale clinique (CGI) et d’appréciation globale du fonction-
nement (GAF).
Pour les calculs des données, on a utilisé le logiciel de
SPSS. Pour les variables paramétriques, on a utilisé le
t
-test et le test de Mann Whitney U, et pour les variables
catégoriques, le test du
χ
2
.

L’Encéphale, 2006 ;
32 :
41-4, cahier 1 Fréquence des symptômes et du trouble obsessionnel compulsif chez le schizophrène
43
RÉSULTATS
Au total, 73 patients (47 hommes et 26 femmes) ont été
recrutés. L’âge moyen du groupe est de 31,4 (DS : 10,6 ;
compris entre 16 et 60), l’âge moyen du déclenchement
de la maladie est de 22,7 (DS : 6,5 ; compris entre 13 et
48) et la durée des maladies varie entre 7 mois et
33 années (en moyenne : 8,9 années ; DS : 7,2) ; 16 %
sont mariés, 67 % sont célibataires, 16,3 % sont veufs.
Les diplômés du lycée ou de l’université (30,1 %) sont en
majorité. Ceux qui ne travaillent pas à cause de la schi-
zophrénie forment 68,5 % du groupe tandis que 16 % seu-
lement travaillent actuellement. Au total, le sous-type le
plus fréquent est le type paranoïde (67,1 %). La fréquence
du type non différencié est de 21,9 %, celle du type désor-
ganisé est de 8,2 % et celle du type catatonique est de
1,4 %. La note moyenne d’appréciation générale du fonc-
tionnement (GAF) était 48 (comprise entre 35-85).
Le nombre moyen des hospitalisations varie entre 0 et
20 (en moyenne 3,4) ; 15 patients (20,5 %) avaient effec-
tué une tentative de suicide dans le passé. Un seul avait
un abus d’alcool et de drogue. Tous les patients étaient
traités avec des médicaments typiques (équivalent
halopéridol moyen : 16,7 mg/jour) et leur durée moyenne
d’hospitalisation était de 35,7 jours.
On a déterminé que 23 des 73 malades présentaient
des symptômes obsessionnels compulsifs. De plus, 7 con-
firmaient le diagnostic du trouble obsessionnel compulsif
avec la schizophrénie. La note moyenne de l’échelle Yale-
Brown obsessionnelle compulsive était 25,2. La note
moyenne du titre 11 qui estime la prise de conscience
envers les obsessions et/ou les compulsions était 3,6. Les
obsessions d’agression étaient le sous-groupe le plus fré-
quent. La plus fréquente compulsion exprimée était celle
de contrôle (12,3 %)
(tableau I)
.
Il n’existe pas une corrélation importante entre le sexe
des patients, les symptômes obsessionnels compulsifs et
les différents sous-types. On n’a pas non plus trouvé de
différence importante entre les patients qui ont et qui n’ont
pas de symptômes obsessionnels compulsifs au point de
vue de l’âge du début de la maladie (consécutivement 22,4
et 23), l’altération de la GAF (consécutivement 48 et 47,8),
le nombre moyen d’hospitalisations (consécutivement
3,08 et 3,66). En revanche, la fréquence des malades qui
ont essayé de se suicider était importante chez ceux qui
présentaient les symptômes obsessionnels compulsifs
(SD : 1, x
2
: 11, p < 0,002, consécutivement 10 % et 43 %).
Afin de pouvoir comprendre l’existence d’une relation
entre les symptômes obsessionnels compulsifs et la durée
de la maladie, on a comparé les patients qui souffrent
depuis plus de 3 ans avec les autres. Aucune différence
n’a été distinguée entre les deux groupes. Pour examiner
s’il existe une relation entre le niveau de fonctionnement
des patients atteints de schizophrénie et les symptômes
obsessionnels compulsifs, nous avons divisé notre échan-
tillon en 2 groupes selon les scores (n : 38 pour ceux qui
ont plus de 45 au GAF et n : 35 pour ceux qui ont moins
de 45). Au point de vue de la fréquence, il n’existait pas
de différence entre les deux groupes, mais cependant
nous avons retrouvé que la fréquence des obsessions
d’agression était assez importante chez ceux qui ont un
GAF supérieur à 45 (
χ
2
: 3,65, SD : 1, p < 0,05). On n’a
pas observé de différence de densité des SOC entre les
patients qui ne travaillent pas en raison de leur schizo-
phrénie et les autres.
DISCUSSION
Dans cette étude, en même temps qu’on recherche la
fréquence du trouble et des symptômes obsessionnels
compulsifs chez les patients schizophrènes, la relation de
ceux-ci avec les caractéristiques cliniques de la maladie
a été examinée. Nous croyons que cette étude est la pre-
mière faite sur ce thème parmi les populations qui n’appar-
tiennent pas à l’Ouest. Dans notre recherche, la proportion
de la coexistence du trouble obsessionnel compulsif chez
les schizophrènes (9,6 %) est proche de celle de la litté-
rature (13) et la fréquence des symptômes obsessionnels
compulsifs (31,5 %) est plus proche des résultats des arti-
cles récents. Le fait que l’obsession la plus fréquente
(22,2 %) est l’agression attire notre attention. Sachant
que, chez les schizophrènes, les délires de persécution
et paranoïdes sont les plus souvent rencontrés, il est facile
de pouvoir expliquer ce résultat. Nous pouvons en con-
clure que chez nos patients ces groupes de symptômes
reflètent, dans le spectre d’obsession-délire, une étape où
la conscience est partiellement conservée et où les pen-
sées agressives ne sont pas encore exprimées à l’exté-
rieur. Les résultats montrent que les obsessions avec thè-
mes d’agression sont rencontrées plus souvent dans le
groupe de patients ayant la plus grande GAF. Cette cons-
tatation supporte bien l’opinion qui prétend que les SOC
ont un rôle équilibrant pour la schizophrénie (17, 19).
TABLEAU I. —
Distribution des symptômes chez les patients
atteints de schizophrénie selon l’inventaire d’exploration
des symptômes obsessionnels compulsifs de Yale-Brown.
Obsessions Nombres %
De l’agression 16 22,2
De la saleté-contamination 11 15
De la religion 7 9,6
De la collection 2 2,7
De la sexualité 7 9,6
De la symétrie 6 8,2
Somatiques 2 2,7
D’autre nature 10 13,7
Compulsions Nombres %
De nettoyage-lavage 4 5,5
De contrôle 9 12,3
De la répétition rituelle 8 10,9
De comptage 6 8,2
De rangement-organisation 0 0
De ramassage-entassement 2 2,7
D’autre nature 6 8,2

A. Üçok
et al.
L’Encéphale, 2006 ;
32 :
41-4, cahier 1
44
De plus, le fait que le taux de suicide est plus élevé parmi
les malades présentant des SOC appuie l’hypothèse que
les SOC ont un effet négatif sur l’évolution de la schizo-
phrénie.
D’autre part, l’absence d’une relation entre les symptô-
mes obsessionnels compulsifs et les variables qui mon-
trent indirectement un déficit lié à la schizophrénie
(comme la situation de travail et la GAF) ne confirme pas
l’opinion du mauvais effet de ces symptômes sur le pro-
nostic. De la même façon, un autre point qui diffère de cer-
taines études précédentes (7, 1) est que l’on n’a pas trouvé
de relation entre l’existence des symptômes obsession-
nels compulsifs et l’âge du déclenchement de la schizo-
phrénie. Comme le début précoce de la maladie est un
signe de mauvais pronostic pour la schizophrénie, cette
donnée aussi apparaît concordante avec les autres.
CONCLUSION
Pour mieux comprendre l’effet des SOC sur l’évolution
de la schizophrénie il serait souhaitable de faire des étu-
des prospectives longitudinales et non pas ponctuelles.
Notre étude a des limites, la durée de la maladie fait
qu’il est impossible de déterminer à quel stade de la schi-
zophrénie sont apparus les TOC et les SOC, et de quelle
manière ils ont été affectés par sa sévérité.
Pour avoir des réponses plus nettes aux questions
qu’implique cette étude, il faut examiner un groupe de
patients plus large présentant un TOC et la schizophrénie.
Dans notre étude, l’insuffisance du nombre des patients
(n : 7) qui ont les deux diagnostics concomitants restreint
cette sorte d’observation. Mais les données obtenues
montrent que dans ce groupe de patients la prise de cons-
cience est très faible et même n’existe pas. Pour les étu-
des ultérieures sur ce thème, il serait utile d’examiner des
groupes plus vastes qui répondent aux critères cités ci-
dessus.
Remerciements.
Les auteurs remercient Vincent Bouvard pour
avoir contrôlé la rédaction de la version française de cet article.
Références
1. BERMAN I, KALINOWSKI A, BERMAN SM
et al.
Obsessive and
compulsive symptoms in chronic schizophrenia. Compr Psychiatry
1995 ; 36 : 6-10.
2. BERMANZOHN PC, ARLOW PB, STRONGER L. Hierarchical
diagnosis in chronic schizophrenia. Schizophr Bull 2000 ; 26 :
517-25.
3. BLEULER E. Textbook of psychiatry. AA Brill (trans), New York :
MacMillan, 1924.
4. DOUBREMELLE C, MILLET B, OLIÉ JP. Schizophrénie avec trou-
bles ou symptômes obsessionels compulsifs. Encephale 2000 ; 26 :
81-8.
5. EISEN JL, RASMUSSEN SA. Obsessive compulsive disorder with
psychotic features. J Clin Psychiatry 1993 ; 54 : 373-9.
6. EISEN JL, BEER DA, PATO M
et al.
Obsessive-compulsive disorder
in patients with schizophrenia or schizoaffective disorder. Am J Psy-
chiatry 1997 ; 154 : 271-3.
7. FENTON WS, McGLASHAN TH. The prognostic significance of
obsessive-compulsive symptoms in schizophrenia. Am J Psychiatry
1986 ; 143 : 437-41.
8. GOODMAN WK, PRICE LH, RASMUSSEN SA
et al.
The Yale-
Brown Obsessive Compulsive Scale, I : development, use and relia-
bilty. Arch Gen Psychiatry 1989 ; 1006-11.
9. GORDON A. Obsessions in their relation with psychosis. Am J Psy-
chiatry 1926 ; 5 : 647-59.
10. INSEL TR, AKISKAL HS. Obsessive-compulsive disorder with psy-
chotic features : a phenomenological analysis. Am J Psychiatry
1986 ; 143 : 1527-33.
11. KARAMUSTAFALIO ˇ
GLU O, ÜÇI¸SIK AM, ULUSOY M
et al.
The
reliability and the validity study of Yale-Brown Obsessive Compul-
sive Scale, 29
e
National Psychiatry Congress : September 29-Octo-
ber 4 1993, Bursa.
12. KARNO M, GOLDING JM, SORENSON SB
et al.
The epidemiology
of obsessive-compulsive disorder in five US communities. Arch Gen
Psychiatry 1988 ; 45 : 1094-9.
13. KOZAK MJ, FOA EB. Obsessions, overvalued ideas and delusions
in obsessive-compulsive disorder. Behav Res Ther 1994 ; 32 :
343-53.
14. KRUEGER S, BRAUNIG P, HOFFLER J
et al.
Prevalence of obses-
sive-compulsive disorder in schizophrenia and significance of motor
symptoms. J Neuropsychiatr Clin Neurosci 2000 ; 12 : 16-24.
15. LEWIS A. Problems of obsessional ilness. Proc R Soc Med 1935 ;
29 : 324-36.
16. MEGHANI SR. Schizophrenia patients with and without OCD : new
research program and abstracts, 151 APA Annual Meeting, Toronto
1998, abstract 138.
17. PIOUS W. Obsessive-compulsive symptoms in an incipient schi-
zophrenic. Psychoanalyt Quarter 1950 ; 19 : 327-39.
18. SPITZER RL, WILLIAMS JBW, GIBBON M
et al.
Structured clinical
interview for DSM III-R-Patient version 1.0 (SCID-P). Washington
DC : American Psychiatric Press, 1990.
19. STENGEL E. A study on some clinical aspects of the relationship
between obsessional neurosis and psychotic reaction types. J Ment
Sci 1945 ; 91 : 166-84.
20. TIBBO P, KROETSCH M, CHUE P
et al.
Obsessive-compulsive
disorder in schizophrenia. J Psychiatr Res 2000 ; 34 : 139-46.
21. WESTPHAL K. Ueber Zwangsvorstellungen. Archiv Psychiatr Ner-
venkrankheit 1878 ; 8 : 734-50.
22. YARYURA-TOBIAS JA, CAMPISI TA, McKAY D
et al.
Schizophrenia
and obsessive compulsive disorder : shared aspects of pathology.
Neur Psych Brain Res 1995 ; 3 : 143-8.
23. ZAHAROVITS I. Obsessive-compulsive symptoms in schizophre-
nia : new research program and abstracts, From the proceedings of
the 143rd APA Annual Meeting, New York, 1990, abstract 139.
1
/
4
100%