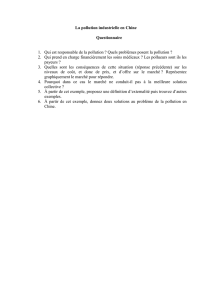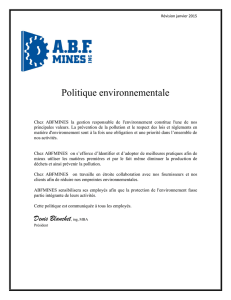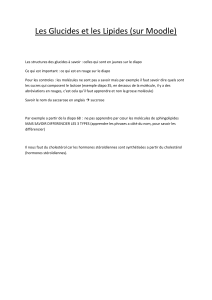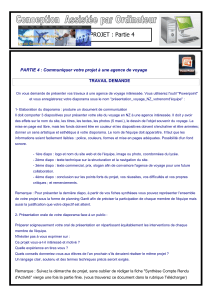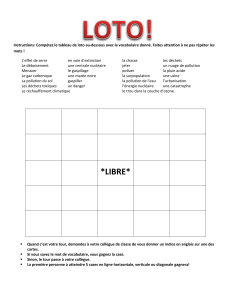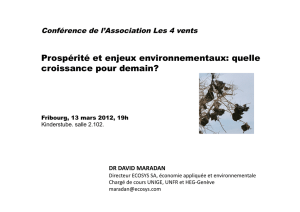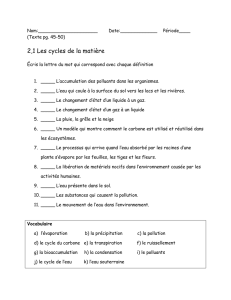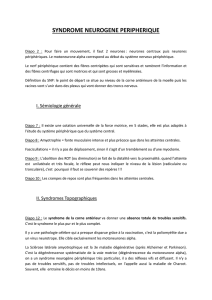La marchandisation de la biodiversité, peut-on donner une

La marchandisation de la biodiversité,
peut-on donner une valeur à la nature ?
Valérie BARBIER
DIAPO 2
Donner une valeur à la nature ?
La nature est pour l’homme une source de valeur importante au quotidien
au travers les services qu’elle peut rendre (des services d’entretien,
d’approvisionnement, de régulation, …).
La notion de valeur de la nature s’inscrit dans une logique d’utilité et conduit à attribuer aux
actifs naturels une valeur qui reflète leur contribution au bien-être social au bien-être de l’homme.
Donner une valeur à la nature, c’est évaluer les services qu’elle peut rendre ; c’est estimer sa
capacité à contribuer au bien-être des gens parce qu'elle est utile et rare.
DIAPO 3
Pourquoi donner une valeur à la nature ?
Pour la protéger, pour garantir la « conservation » des services
qu’elle nous procure, au nom d’un développement durable.
La nature est de plus en plus menacée (épuisement de ressources, disparition d’espèces, détérioration
de la qualité des milieux, disparition des habitats…) bien souvent à cause des actions de l’Homme.

La théorie économique néoclassique l’explique par le fait que la véritable valeur sociale de la nature,
mesurée par les multiples services qu’elle peut rendre pour participer au bien-être de l’homme
(ressources productives, intérêts scientifiques, esthétiques …), n’est que rarement reflétée dans les
prises de décisions de production, de consommation, d’aménagement ; ce qui prédispose à sa
détérioration.
L’un des moyens pour la protéger est de lui donner une valeur économique et de l’intégrer ou de
mieux l’intégrer dans les décisions publiques et privées.
DIAPO 4
Exemple d’un projet d’aménagement : la construction d’une voie de
transport.
Si ce projet se réalise, il y a atteinte à la nature, par exemple disparition
d’un écosystème forestier (atteinte à la nature en dehors de toute
considération de l’homme ; qui fait référence à sa valeur intrinsèque).
Mais il y a aussi atteinte au bien-être de l’Homme par la perte des services rendus jusque là par la
forêt. Ces services qui étaient :
-des services directs, que l'on appelle aussi services marchands, qui font référence à la valeur d’usage
direct de la forêt (exploitation forestière, activités récréatives…) ;
- des services indirects, qui font référence à la valeur d’usage indirect de la forêt (régulation des
précipitations, stockage et séquestration de carbone…) ;
- des services potentiels futurs, qui font référence à la valeur d’option de la forêt (services directs et
indirects disponibles pour les générations futures) ;
- des services passifs, qui font référence à la valeur d’héritage ou d’existence de la forêt (beauté du
paysage, valeur altruiste des espèces…).
Ces derniers services renvoient à des valeurs de non usage.
La destruction de la forêt va impliquer la perte de ces services.
Elle va être à l’origine de la disparition d’activités sylvicoles, d’activités de loisirs, de la disparition de
services fonctionnels (capacité à réguler les précipitations….), de désagréments pour la perte d’un
paysage ou la perte d’espèces faunistique et floristique….
La perte de ces services représente un coût pour la société, pour l’homme, sur ce territoire
donné, que l’on appelle coût social.
Ce coût social est représentatif de la valeur de la forêt.

Plusieurs méthodes permettent de déterminer ce coût social ou encore d’approcher la valeur monétaire des
différents services rendus par l’environnement.
Certaines méthodes estiment la valeur de la nature à partir des coûts qui n’ont pas été engagés pour produire
des services que la nature produit déjà.
Exemples
la méthode des coûts évités cherche à évaluer la valeur des services environnementaux à partir des coûts à
engager si ces services venaient à disparaître.
La présence d’une zone humide à proximité d’une agglomération limite les risques d’inondation. Sa disparition ou
sa dégradation génèrerait des dépenses supplémentaires d’assurance pour les particuliers comme pour la
collectivité ; elle nécessiterait aussi d’augmenter la capacité des stations d’épuration ou d’en construire de
nouvelles. Le calcul des dépenses liées à la dégradation de ce service écologique peut conduire à investir dans la
protection de la zone humide plutôt que de construire une nouvelle usine de traitement de l’eau.
la méthode des coûts de restauration, de remplacement détermine le coût induit par la dégradation ou la
disparition d’un écosystème en mesurant ce que couterait sa remise en état : coûts de la dépollution de la mer et
des plages après une marée noire (barrages, pompage, aspiration…), pertes de recettes au niveau des activités
touristiques et des activités liées aux produits de la mer (pêche, conchyliculture…), coût de la réintroduction des
espèces disparues du milieu pour « rétablir » la qualité de l’écosystème endommagé…
D’autres méthodes observent le comportement effectif des utilisateurs de la nature. Ce sont des méthodes
basées sur les préférences révélées.
Exemples
la méthode des prix hédonistiques consiste à estimer la valeur d’un service environnemental qui influe
directement sur le prix de certains biens, par exemple la valeur monétaire que les ménages retirent d’habiter ou de
travailler dans un endroit sain, en supposant que la valeur d’un bien immobilier reflète la qualité de cet
environnement.
Une maison située à côté d’une industrie polluante n’aura pas la même valeur comparée à une maison semblable
située loin de cette usine (l’écart de prix peut servir à mesurer le « coût » social de la pollution ou la valeur que l’on
peut accorder à la nature à cet endroit).
la méthode des coûts de transport évalue la valeur d’un site à usage récréatif à partir des dépenses supportées
par les usagers pour se rendre sur ce site (billet de train, essence, temps passé…) et profiter de certains services
offerts par la nature (ramassage de champignons, pêche, …).
S’il y a détérioration d’un site tout près de chez eux, quels coûts les ménages seront-ils prêts à dépenser pour aller
se promener dans un parc naturel, pour aller pêcher dans une rivière à truite…beaucoup plus loin ? (ce coût peut
servir à mesurer de façon monétaire le dommage, la perte de valeur, infligé au site riverain).
Il existe aussi des méthodes qui s’appuient sur des enquêtes auprès de la population. Ce sont des méthodes
basées sur les préférences déclarées.
Exemple
la méthode de l’évaluation contingente repose sur des enquêtes par questionnaire visant à obtenir une
information directe sur les préférences, souvent exprimées sous la forme d’un consentement à payer pour obtenir
ou préserver un service, pour éviter une dégradation de la nature.
Combien seriez-vous prêt à payer pour améliorer l’air autour de votre logement ? Combien seriez-vous prêt à payer
pour continuer vos promenades en forêt et ne pas la voir disparaître ?
Ce consentement à payer pour une reconquête ou une préservation de la nature est utilisé pour calculer la valeur
que l’on lui accorde.

Si le projet est réalisé, l’aménageur ne va pas payer pour la globalité de ce coût social.
La véritable valeur de la zone naturelle qui va être détériorée n’est pas prise en compte dans la
décision d’aménagement. Vont être évalués et pris en compte les pertes (en terme de coûts) des
services marchands, mais pas véritablement celles des services non marchands (spécialement celles
liées à la valeur de non-usage).
Une partie du coût social n'est donc pas pris en compte dans la décision d'aménagement, dans le
coût privé de l'aménageur.
Le coût privé ne reflète pas le coût social.
La connaissance des valeurs des services écosystémiques, par l’intermédiaire des méthodes de calcul
de la valeur, a l'avantage d’aider à pratiquer la vérité sur le coût social, sur les effets négatifs de
l'aménagement sur la nature.
Le schéma d’analyse reste le même dans le cas de phénomènes de pollution.
Si un industriel utilise l’air ou l’eau pour déverser des polluants issus de son activité, s’il ne paie rien
en contrepartie de cette pollution, si elle n’est pas incluse dans ses coûts de production (coûts
privés), il faut par contre considérer qu’elle représente un coût pour le reste de la société (coût
social) par le fait qu’elle exerce un effet défavorable, des dommages.
Pour l’air : dégradation de la qualité de l’air, services de santé plus élevés, dommages infligés aux
matériaux, aux cultures…
Pour l’eau : dégradation d’une ressource, traitement obligé de l’eau à destination de la
consommation courante, baisse des activités récréatives comme la pêche…
Aujourd’hui, la réglementation joue un grand rôle pour limiter les impacts des activités humaines
sur l’air, l’eau ou la biodiversité (limiter le coût social) : les normes de rejets dans l’air, dans l’eau
l’obligation de compenser pour les aménagements…
Mais de même que les limites d’émissions de polluants sont souvent dépassées, cette obligation de
compenser n’a jamais été réellement mises en œuvre.
En théorie, quand le pollueur ou l’aménageur ne supporte pas la totalité des coûts de son
action, il y a divergence entre le coût privé et le coût social. Cet écart entre coût privé et coût social
représente le coût des services perdus, le coût des dommages, que l’on appelle coût externe (car
extérieur à un mécanisme de prix).
La plupart des services offerts par la nature sont en effet souvent situées hors marché (services non
marchands). Ils ont une valeur mais ils n’ont pas de prix. Contrairement aux autres biens et services,
ils n’ont pas de prix déterminé par une offre et une demande sur un marché et n’ont pas de coût de
De par la loi, il y a obligation de compenser les impacts environnementaux résiduels lorsqu’un projet ne peut éviter la
destruction d’un écosystème. La loi impose de compenser cette perte par la restauration d’un milieu équivalent, de
préférence à proximité de la zone concernée.

production. Pendant longtemps (de l’ère industrielle aux années après-guerre 1960), détruire la
faune et la flore, rejeter des polluants dans l’air, dans l’eau, se faisaient sans contrepartie monétaire.
Leur détérioration était considérée comme une conséquence inévitable des activités économiques
dans un objectif de croissance. Les services qu’ils offraient avaient la particularité d’être gratuits,
donc comme si ils n’avaient pas de valeur. Ils ont donc été « utilisés » de façon abusive alors que la
capacité de résilience de la nature est limitée.
DIAPO 5
Quelle solution ?
Une solution est de combler l’écart entre coût privé et coût social, de
faire payer le coût externe, de faire en sorte que le coût privé soit plus
important, de faire payer pour la perte des services rendus ou pour les
dommages infligés à la nature.
Des instruments économiques sont ainsi mis en place. Ils sont censés traduire la valeur de la
nature en une unité de mesure ayant la dimension d'un prix. Ils sont censés responsabiliser les
acteurs économiques qui portent atteinte à la nature. Ce sont des « signaux prix », négatifs, en
direction des agents, afin qu’ils adoptent des comportements plus vertueux envers la nature.
Ils relèvent du principe pollueur payeur.
Quels sont ces instruments?
La taxe : les pollueurs doivent payer un impôt proportionnel à l’usage d’une ressource ou à l’impact
d’un polluant.
Le principe est que le pollueur compare le coût de réduction de sa pollution au prix de la taxe. Il sera
incité à dépolluer jusqu’à ce que le coût de dépollution soit égal au montant de la taxe.
Exemples : le Danemark, la Suède, la Norvège ont réussi à réduire d’au moins 50 % leur consommation de pesticides.
Cette diminution s’explique par la nouveauté des matières actives utilisées (à spectre plus large ou plus efficaces à
moindre dose), par la moindre fréquence de traitement des cultures, mais surtout par une réglementation très stricte
(interdiction de matières actives pourtant toujours autorisées par la Commission Européenne) et par la taxation
importante des pesticides vendus.
Au Danemark, depuis 1999, la taxe représente 34 % du prix des herbicides et fongicides et 54 % du prix des
insecticides (3 % en 1986). Elle a accru, de manière significative, le coût relatif de l’utilisation de ces intrants, et en a
réduit l’intérêt pour les agriculteurs.
En outre, cette écotaxe a permis à d’autres mesures de devenir compétitives (lutte biologique, désherbage
mécanique), d’autant plus que 83 % de l’argent récolté par les taxes est reversé aux agriculteurs sous diverses formes.
Une taxe carbone est également utilisée en Suède et en Norvège. Elle correspond au prix à payer pour les émissions
de CO2 liées au chauffage, au transport… Cette taxe a d’ailleurs été envisagée en France.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%