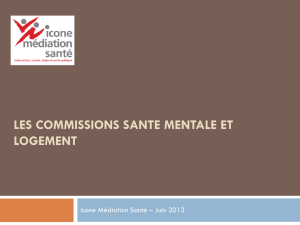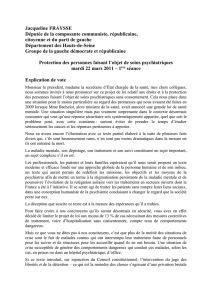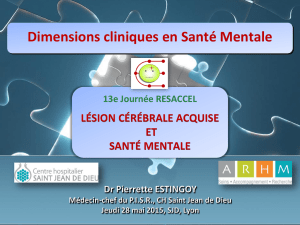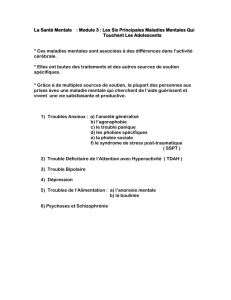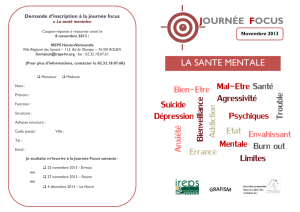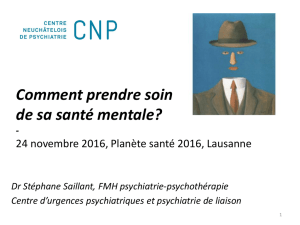Les changements de la relation normal

Les changements de la relation
normal-pathologique.
À propos de la souffrance psychique
et de la santé mentale
Alain Ehrenberg*
LA SOUFFRANCE psychique et la santé mentale symbolisent les boule-
versements qu’a connus la psychiatrie depuis les années 1970 :
quand bien même des conditions asilaires, voire des internements
abusifs perdureraient, la psychiatrie n’est plus assimilée à eux. Son
périmètre d’action, tout d’abord, s’est considérablement élargi ; l’hé-
térogénéité des problèmes dont elle traite, ensuite, s’est accrue en
même temps que de nombreux nouveaux acteurs ont pris pied dans le
domaine ; ces « problèmes », enfin, ont pris une importance écono-
mique, sociale, politique et culturelle inédite. De nouvelles espèces
morbides sont apparues au cours des trente dernières années dans les
sociétés libérales : dépression, stress post-traumatismes, troubles
obsessionnels compulsifs (TOC), attaques de panique, addictions s’in-
vestissant dans les objets les plus divers (l’héroïne, l’ecstasy, le can-
nabis, l’alcool, la nourriture, le jeu, le sexe, la consommation ou les
médicaments psychotropes), anxiété généralisée (le fait d’être en per-
manence angoissé), impulsions suicidaires et violentes (particulière-
ment chez les adolescents et les jeunes adultes), attaques de panique,
syndromes de fatigue chronique, « pathologies de l’exclusion », souf-
frances « psychosociales », conduites à risques, psychopathies, etc.
Les murs de l’asile sont tombés mais, parallèlement, un ensemble
protéiforme de souffrances s’est progressivement mis à sourdre de
partout. Elles trouvent une réponse dans la santé mentale.
Mai 2004
133
* Directeur du Cesames, CNRS-Inserm-Paris 5, www.cesames.org

Nous sommes manifestement entrés dans une période de redistri-
bution générale des cartes qui nécessite un éclaircissement. Il est
d’autant plus important de le faire qu’aucun des multiples rapports
sur la psychiatrie et la santé mentale commandés par diverses admi-
nistrations depuis vingt ans ne propose une analyse d’ensemble et
n’opère un état des lieux précis des problèmes, contrairement à ce
que l’on peut voir dans d’autres domaines, comme la famille ou le tra-
vail, par exemple. Les réflexions qui suivent ne prétendent pas com-
penser un tel manque, elles proposent une démarche pour répondre à
la question : en quoi consiste aujourd’hui le problème sociologique de
la souffrance psychique et de la santé mentale ?
L’usage récent et systématique dans la vie sociale de la référence à
la souffrance psychique et à la santé mentale relève d’une ambiance,
d’une atmosphère, d’un état d’esprit1. Il dessine une nouvelle forme
sociale qui peut être caractérisée par trois critères. Le premier est de
valeur : l’atteinte psychique est aujourd’hui considérée comme un
mal au moins aussi grave que l’atteinte corporelle et, souvent, plus
insidieux. Le deuxième critère est d’étendue : l’atteinte psychique
concerne chaque institution (école, famille, entreprise ou justice) et
mobilise les acteurs les plus hétérogènes (cliniciens en tout genre,
médecins et non-médecins, travailleurs sociaux, éducateurs, direc-
tions des ressources humaines, nouveaux mouvements religieux,
l’Église elle-même, où se développerait une spiritualité de perfor-
mance sur le déclin des notions de péché et de culpabilité2, etc.). Le
troisième critère est de description et de justification de l’action : non
seulement aucune maladie, mais encore aucune situation sociale « à
problèmes » (la délinquance adolescente, le chômage, l’attribution du
RMI, la relation entre employés et clients ou usagers, etc.) ne doit
aujourd’hui être abordée sans prendre en considération la souffrance
psychique et sans visée de restauration de la santé mentale. Là est la
nouveauté : ce souci pour les troubles de masse de la subjectivité indi-
viduelle. Ils imprègnent aujourd’hui l’ensemble de la vie sociale, et
balancent entre inconfort et pathologie, inconduite et déviance. Mais
de quelle subjectivité parle-t-on ?
Mon hypothèse peut être formulée comme suit : le couple souf-
france psychique-santé mentale s’est imposé dans notre vocabulaire à
mesure que les valeurs de propriété de soi et de choix de sa vie, d’ac-
complissement personnel (quasi-droit de l’homme) et d’initiative
individuelle s’ancraient dans l’opinion. C’est l’idéal d’autonomie tel
qu’il s’est traduit dans la vie quotidienne de chacun. Je considère ce
134
Les changements de la relation normal-pathologique
1. Ce problème a un versant psychologiste, que l’on examine ici, et un versant naturaliste,
qui sera prochainement exposé dans Esprit sous le titre : « Le cerveau de l’individu ».
2. Selon D. Hervieu-Léger, la Religion en miettes ou la question des sectes, Paris, Calmann-
Lévy, 2001.

135
Les changements de la relation normal-pathologique
couple comme l’expression publique des tensions d’un type d’indi-
vidu auquel on demande certes toujours de la discipline et de l’obéis-
sance, mais surtout de l’autonomie, de la capacité à décider et à agir
par lui-même. S’il est vrai que l’autonomie, « le fait d’agir de soi-
même », est une caractéristique générale de l’action humaine3, sur un
plan sociologique on pourrait dire que la norme sociale pousse à
acquérir une discipline de l’autonomie (y compris dans les emplois
ouvriers et employés). L’obéissance mécanique (« les corps dociles »
décrits par Foucault) n’a évidemment pas disparu, mais elle a été
englobée dans l’initiative. Autrement dit, ce qu’on appelle l’indivi-
dualisme aujourd’hui concerne des changements dans nos manières
d’agir et de justifier nos actions. L’élargissement des frontières de soi
s’est accompagné de l’augmentation parallèle de la responsabilité et
de l’insécurité personnelles.
Je déclinerai succinctement ces réflexions provisoires en quatre
temps. Dans le premier seront rapidement présentées les incertitudes
de la psychiatrie et plus généralement de la psychopathologie. Dans
le deuxième on verra comment nos deux expressions sont employées
dans les multiples rapports administratifs dont nous disposons. La
conclusion apparaîtra paradoxale : l’usage de la santé mentale est
aussi transversal que son objet est mal identifié. Pour résoudre le pro-
blème, je propose de l’attaquer par un examen de la relation normal-
pathologique. Je ne me demanderai pas, contrairement à l’usage
fâcheux, quelle est la frontière entre le normal et le pathologique,
mais proposerai une approche relationnelle consistant à décrire com-
ment la relation normal-pathologique se modifie, car ces deux pôles
ne se définissent que l’un par rapport à l’autre. C’est en effet toujours
la totalité relationnelle qui se modifie, c’est-à-dire non seulement la
maladie et la pathologie, mais aussi la santé et la normalité. Dans un
troisième temps, l’accent sera placé sur le pôle pathologique de la
relation : le fou à enfermer n’est plus qu’un élément dans un
ensemble plus vaste qui l’a englobé, celui du citoyen en difficulté,
qui souffre et qu’il faut soutenir, mais aussi réprimer et contenir
autrement qu’on ne le faisait avec le fou. On attend de ce citoyen
qu’il soit « l’acteur de sa maladie ». La santé mentale est ici un pro-
blème politique de santé publique. Enfin, je tenterai de montrer com-
ment le fait de justifier nos manières d’être et nos manières de faire
dans les termes de l’autonomie est l’élément qui conduit à adopter un
langage de la vulnérabilité individuelle de masse.
3. Elle requiert des conditions que V. Descombes explique en détail dans le Complément de
sujet. Enquête sur le fait d’agir de soi-même, Paris, Gallimard, 2004.

Paysage de crise : les trois événements « mentaux » de 2003
Bien que nos deux expressions soient solidaires, c’est plutôt la
référence à la santé mentale qui est employée par la multitude d’ins-
titutions et d’acteurs investis dans cette nouvelle question sociale. Si
le thème est ancien4, son ancrage s’amorce à partir du début des
années 1980. Depuis plus de vingt ans en France, rapports adminis-
tratifs (le premier date de 1981), lois, décrets, ordonnances, circu-
laires insistent peu ou prou sur le nécessaire déplacement de la psy-
chiatrie vers la santé mentale, pour reprendre le titre du rapport des
docteurs Éric Piel et Jean-Luc Rœlandt5. En dépit des intenses
controverses dont il a fait l’objet parmi les psychiatres, notamment
sur l’objectif de diminution des lits en milieu hospitalier, il a large-
ment inspiré le Plan santé mentale. L’usager au centre d’un dispositif
à rénover du ministre de la Santé, Bernard Kouchner, en 2001. La
plupart des professionnels et des associations de patients et de
famille de patients se revendiquent de cette référence.
Trois événements « mentaux » de l’année 2003 peuvent servir de
point de départ pour décrire le paysage de crise : les états généraux
de la psychiatrie, qui se sont tenus en juin, le rapport de la mission
Cléry-Melin, remis en septembre, et l’amendement Accoyer sur les
psychothérapies déposé en octobre.
Les états généraux de la psychiatrie ont été l’occasion de mettre en
scène la crise de la profession qui porte sur tous les sujets. Sur les
moyens, car le nombre de psychiatres diminue, les financements
affectés aux institutions publiques sont insuffisants et l’offre de soins
très inégalement répartie sur le territoire national. Sur la clinique : de
nouvelles pathologies, pathologies du lien ou narcissiques, comme les
dépressions, les addictions ou le traumatisme (l’état de stress post-
traumatique), sont aujourd’hui des problèmes massifs. Derrière la
nouvelle clinique, se profile le problème des conceptions du patient :
on a hautement affirmé la nécessité de ne pas oublier le Sujet parlant
face à une médecine et une recherche universitaires préoccupées
essentiellement du Sujet cérébral6. Les limites du domaine de la psy-
chiatrie, les relations entre le normal et le pathologique ou les par-
tages et alliances entre social et médical sont interrogés par tous les
acteurs. Si crise de la psychiatrie il y a – le thème est récurrent7–,
elle est multiforme, mais il faut souligner, parce qu’on l’oublie trop
136
Les changements de la relation normal-pathologique
4. Voir, par exemple, R. H. Ahrenfeld, « La notion de santé mentale », Encyclopédie médico-
chirurgicale, 37960 A10, novembre 1966.
5. É. Piel et J.-L. Rœlandt, De la psychiatrie vers la santé mentale, rapport de mission,
ministère de l’Emploi et de la Solidarité, ministère délégué à la Santé, juillet 2001.
6. Un colloque « Autisme et cerveau », qui s’est tenu au Collège de France à la fin du mois
de juin 2003, en est le miroir inversé.
7. Du Livre blanc des années 1965-1967 à aujourd’hui, sous la houlette d’Henri Ey.

souvent, que cette crise est aussi intellectuelle, tant dans la psychia-
trie du cadre que dans la psychiatrie hospitalo-universitaire : aux
lamentos des premiers succombant à l’accroissement de la demande
et démunis de moyens semble répondre en miroir l’assurance des
seconds justifiée par les progrès des neurosciences, des nouveaux
outils de la biologie moléculaire et de l’imagerie cérébrale (le progrès
scientifique finira par résoudre tous les problèmes).
Le deuxième événement est la remise du rapport de la mission
Cléry-Melin8en septembre. Le rapport est un ensemble de proposi-
tions pour résoudre la crise : sa mission est la réorganisation de l’offre
de soins. Ce n’est pas le premier rapport depuis 1981, il n’est pas
pour autant sans intérêt, loin de là. Se référant aux états généraux, le
préambule résume « les difficultés auxquelles est confrontée la disci-
pline » :
De fait, il semble que ces dernières années une confusion se soit pro-
duite entre les domaines de la psychiatrie et de la santé mentale, et
qu’il faille aujourd’hui réaffirmer la mission première de la psychia-
trie comme discipline médicale, dispensatrice de soins, sans pour
autant perdre de vue l’importance de la promotion de la santé mentale
et celle de la prévention.
La déclaration est œcuménique et suscite quelques questions. Confu-
sion certes, mais entre quoi et quoi ? Ancrer la psychiatrie dans la
médecine ? Mais cette discipline s’est toujours caractérisée, et se
caractérise toujours, par le fait qu’elle est à la fois une médecine
comme une autre et autre chose qu’elle du fait de la spécificité de son
objet : l’esprit humain, que nos sociétés considèrent comme le lieu de
la vérité de l’homme. Promouvoir la santé mentale ? Tous s’accordent
sur ce point, mais cet accord recouvre de fortes divergences sur ce
que désigne la santé mentale, ce véritable fourre-tout.
Le constat est donc que la discipline psychiatrique est à ce jour dans
une passe relativement problématique : qu’il s’agisse de la délimita-
tion de ses tâches, de l’organisation de l’offre de soins, des évolutions
du recours au soin, des populations concernées, de la gestion des
inégalités de répartition des moyens humains et matériels, de la com-
munication de son image9.
Le troisième événement est l’amendement déposé par le député UMP
(et médecin) Bernard Accoyer10 sur la question de la qualification des
psychothérapeutes en octobre. Il a suscité un séisme dans les profes-
sions hétérogènes regroupées sous cette étiquette11. Sa visée est de
137
Les changements de la relation normal-pathologique
8. P. Cléry-Melin, V. Kovess, J.-C. Pascal, Plan d’action pour le développement de la psy-
chiatrie et la promotion de la santé mentale, Rapport d’étape de la mission Cléry-Melin remis au
ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes handicapées, 15 septembre 2003.
9. Ibid., p. 4 et 6.
10. Sur les enjeux de l’amendement, voir le texte de P.-H. Castel, dans cette même livraison.
11. Le premier essai sur la société thérapeutique est celui de P. Rieff, The Triumph of Thera-
peutics. Uses of Faith after Freud, Chicago Press, 1966 (en poche, 1987). Rieff voit dans les tech-
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
1
/
24
100%