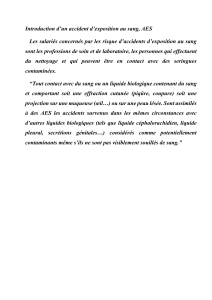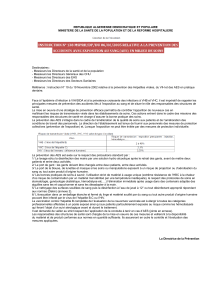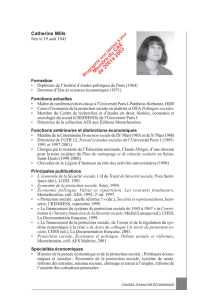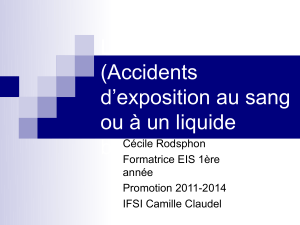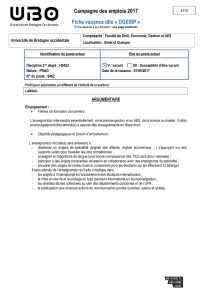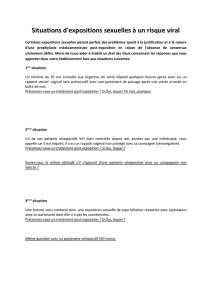Les accidents d`exposition au sang en anesthésie

Sécurité en anesthésie 73
LES ACCIDENTS D’EXPOSITION AU SANG EN
ANESTHESIE REANIMATION: SPECIFICITES ET
CONDUITE PRATIQUE
E. Casalino*, A. Tarantola**, E. Bouvet*** - *Service d’Accueil des urgences-
adultes. CHU Kremlin-Bicêtre. **GERES, Groupe d’étude du risque d’exposition des
soignants aux agents infectieux. ***Service de Maladies Infectieuses et Tropicales
(SMIT-A) et GERES. CHU Bichat-Claude Bernard.
INTRODUCTION
Les expositions potentielles aux agents transmissibles par le sang, dont le virus de
l’immunodéficience humaine (VIH) ou des hépatites en milieu de soins sont liées aux
accidents d’exposition au sang (AES), définis comme une exposition percutanée (piqûre,
coupure) ou cutanéo-muqueuse (contact sur une peau lésée, projection sur le visage ou
une muqueuse) à du sang ou un liquide biologique souillé par du sang. Les principaux
agents transmissibles par le sang sont présentés dans le Tableau I.
Le premier cas rapporté de transmission professionnelle du VIH chez un soignant
remonte à 1984 [1]. L’utilisation d’une chimioprophylaxie post-exposition au VIH a
été proposée de manière occasionnelle depuis 1989. La publication des résultats de
l’étude cas-témoin des Centers for Disease Control and prevention (CDC) [2] repris
dans une circulaire ministérielle [3] a banalisé son emploi depuis 1996. Le nombre
élevé d’AES en milieu de soins explique le recours fréquent à cette prescription d’anti-
rétroviraux. Des recommandations officielles en France [3, 4] ont incité les hôpitaux à
mettre en place des procédures permettant un accès facile et permanent aux anti-
rétroviraux dans cette indication. Ces mêmes recommandations permettent une évalua-
tion du risque et orientent la décision thérapeutique.
Tableau I
Principaux agents transmissibles par le sang
Personnes infectés en France Risque de transmission
VIH 80 000 à 120 000 Percutané : 0,3 %
Cutanéo-muqueux : 0,03 %
VHB 100 000 Si AgHBe+ et soignant non
immunisé : 30 %
VHC 500 000 Percutané : < 3 %

MAPAR 200274
Des incertitudes persistent néanmoins sur l’efficacité et la tolérance des schémas
proposés, sur le rapport coût-efficacité des traitements, sur l’impact sur la prévention
de la transmission du VIH en milieu de soins. Nous passerons en revue dans cet article
les principaux aspects ayant lien avec l’anesthésie-réanimation.
1. FREQUENCE DES AES EN MILIEU DE SOINS
La fréquence des AES en milieu hospitalier a été estimée à 33 pour 100 lits occupés
par an [5]. D’après cette formule, pour un hôpital de 1 000 lits avec un taux d’occu-
pation de 85 %, on peut s’attendre 280 à 300 AES chaque année. Environ 75 à 80 % des
AES déclarés concernent des accidents percutanés, les autres étant des expositions
cutanéo-muqueuses.
Tous les personnels soignants ne sont pas confrontés au même risque d’exposition
(Tableau II) : le personnel soignant paramédical est le plus exposé en termes de
fréquence et de gravité, avec une incidence chez les infirmières en France de 30 acci-
dents percutanés pour 100 IDE/an et de 100 accidents cutanéo-muqueux pour 100 IDE/
an [6]. Le personnel infirmier déclare 40 à 50 % de leurs AES. Les médecins ne repré-
sentent que 10 % des AES déclarés. Une sous-déclaration importante est à craindre
chez le personnel médical, notamment chez les chirurgiens. Ces derniers sont les plus
souvent exposés avec une incidence estimée à environ un accident percutané par chi-
rurgien et par mois [7].
L’analyse des circonstances de survenue des AES lors de l’enquête du GERES de
1990 à 1992, avait révélé que 35 % des accidents avaient lieu pendant la réalisation du
geste, et que les deux tiers restants survenaient pendant la phase de rangement du maté-
riel. Sur la base des données de cette étude, une hiérarchie du risque lié à chaque acte a
été établie. Les gestes à risque accru de survenue d’un AES étaient les piqûres sur
chambre implantable, les prélèvements artériels, les poses et déposes de perfusions.
Outre le fait qu’elle a globalement réduit le risque pour les gestes médicaux, l’intro-
duction de matériels de sécurité a depuis modifié cette hiérarchie, comme l’a montré
les résultats préliminaires de cette étude répétée en 1999 et 2000 (Etude GERES 2000).
1.1. FREQUENCE DES AES EN MILIEU CHIRURGIC AL
Les chirurgiens au bloc opératoire sont probablement les plus souvent exposés en
milieu hospitalier. L’incidence rapportée chez les chirurgiens en France est de
950 accidents percutanés pour 100 chirurgiens par an et 2 800 contacts cutanéo-
Tableau II
Différentes catégories des soignants exposés
Catégories de soignants
Infirmières (50 %)
Aides-soignantes (15 %)
Elèves IDE (10 %)
Médecins (10 %)
Chirurgiens (2 %)
Etudiants médecine (2 %)
Autres (10 %)

Sécurité en anesthésie 75
muqueux/100 chirurgiens par an [7]. La fréquence rapportée d’actes chirurgicaux com-
pliqués d’un AES varie entre 6 et 30 %, avec des incidences comprises entre 1 et
3 accidents percutanés pour 100 personnes par acte [8]. Les panseuses ou infirmières
instrumentistes sont également exposées, ceci à l’évidence en raison de la manipula-
tion des instruments chirurgicaux.
Tous les types de chirurgie sont à risque. Les actes de chirurgie orthopédique, gyné-
cologique ou viscérale semblent clairement à risque accru. Comme pour certains gestes
de chirurgie plastique, ce sont les procédures menées hors du contrôle direct de la vue
et celles associés à la préhension ou fixation des tissus à la main tandis que l’autre
réalise la suture qui sont à l’origine de nombreux accidents. Il a par ailleurs été démon-
tré que des microtraumatismes survenus au cours des interventions chirurgicales, avec
comme conséquence une porosité accrue des gants, exposaient les chirurgiens au sang
du patient.
Certaines études ont prouvé que le port de gants - et notamment le port d’une dou-
ble paire de gants - réduit le volume de sang inoculé par une aiguille de suture après
piqûre accidentelle [9, 10]. De la même façon, l’imperméabilité des gants est mieux
assurée lorsque le chirurgien porte deux paires de gants. Il a été proposé au vu de ces
données d’avoir recours à une double paire de gants pour les actes chirurgicaux à haut
risque de traumatisme et de piqûre ou tout du moins lors de la phase de suture.
1.2. FREQUENCE DES AES EN ANESTHESIE-REANIMA TION
Très peu de données sont disponibles dans ce cadre. Heald a rapporté en 1990 une
incidence de 130 APC/100 personnes par an chez les anesthésistes (APC = Accident
percutané), alors que celle-ci varie entre 50 et 60 pour les autres médecins non chirur-
giens [11]. L’incidence est estimée entre 27 et 42/100 personnes par an avec une sous
déclaration très importante, seulement 45 % des AES sont déclarés.
Des données concernant les secteurs de soins intensifs (réanimation médicale, réa-
nimation chirurgicale, salle de réveil) font cruellement défaut. Sur la base des enquêtes
réalisées par le GERES et des données disponibles à la médecine du travail, la fréquence
des AES dans les services de réanimation en France ne semble pas plus élevée que dans
les autres services de médecine. Il est néanmoins important de souligner que la densité
des gestes infirmiers est bien plus élevée dans les services de réanimation que dans les
services de médecine, que le personnel infirmier réalise des soins spécialisés tels que
des pansements, des séances de dialyse, et que l’absence de différence dans la fréquence
des AES pourrait traduire une meilleure organisation des soins et une politique plus
agressive de prévention des AES.
2. FACTEURS DE RISQUE DE TRANSMISSION DU VIH
On estime que le risque de transmission du VIH après piqûre accidentelle est de
l’ordre 0,03 à 0,3 %. Ce risque faible limite la puissance statistique des études visant à
évaluer les facteurs de risque de transmission du VIH. Le risque est évidemment lié au
statut VIH positif du patient source. Rappelons néanmoins que, bien que seul les sujets
infectés par le VIH peuvent transmettre l’infection, le diagnostic repose habituellement
sur la détection d’anticorps anti-VIH et que leur apparition est décalée de 2 à 4 semai-
nes après l’acquisition de infection. Bien que séronégatif pendant cette période, le patient
est virémique et contaminant. Le risque de se trouver confronté à cette situation est
faible, probablement proche du risque transfusionnel résiduel, soit inférieur à 1/500 000
ou 1/1 000 000 de culots globulaires transfusés. Un cas de transmission survenu chez
une infirmière dans ces circonstances a néanmoins été documenté.

MAPAR 200276
Dans l’évaluation du risque, les accidents percutanés sont à plus haut risque que les
expositions cutanéo-muqueuses. L’étude cas-témoin du CDC [2] a défini les facteurs
de risque de transmission des accidents percutanés (APC) : blessure profonde (OR 16,1),
sang visible sur le matériel (OR 5,2), aiguille ayant servi à un prélèvement intra-
veineux ou intra-artériel direct (OR 5,1), patient source au stade SIDA.
Ces variables peuvent être considérées comme des marqueurs reflétant l’importance
de l’inoculum viral. Les piqûres profondes permettent un inoculum viral plus élevé,
ainsi que les dispositifs creux qui sont souillés à l’extérieur et à l’intérieur de l’aiguille
avec des volumes de sang plus importants que pour les aiguilles «pleines», type aiguille
de suture. Le diamètre de l’aiguille et l’utilisation qui en a été faite (ponction intravas-
culaire ou non, amenant l’aiguille à contenir du sang) sont ainsi des facteurs de risque
de transmission couramment acceptés. Le port de gants pourrait avoir un effet mécani-
que de réduction des volumes de sang véhiculés par une aiguille, essentiellement en cas
de piqûre par aiguille pleine [9, 10].
Bien qu’il soit couramment accepté que le risque majeur est lié à des expositions au
sang ou à des liquides biologiques souillés avec du sang, le VIH peut être isolé à partir
d’autres liquides biologiques. En règle générale, tous les liquides exudatifs riches en
cellules doivent être considérés comme potentiellement contaminants.
La charge virale du patient source devient une variable dont l’importance est fon-
damentale. Des études récentes confirment l’importance de la charge virale maternelle
dans la transmission verticale du VIH [12] et dans la transmission sexuelle du
VIH [13, 14, 15]. Bien qu’il ne soit pas possible de déterminer un seuil en dessous
duquel le risque serait nul, les patients avec des charges virales indétectables ou faible-
ment positives ont à volume égal un inoculum viral moindre à transmettre que les patients
avec des charges virales fortement positives. De la même façon, une charge virale indé-
tectable ne doit pas être considérée comme une situation à risque nul. Il est bien
documenté que les patients avec des charges virales faibles restent potentiellement con-
taminants. Le Tableau III présente les facteurs de risque de transmission du VIH au
cours des AES chez le personnel de santé.
Tableau III
Facteurs de risque de transmission du VIH
Facteurs liés au type d’accident Percutané > cutanéo-muqueux
Pour les accidents cutanéo-muqueux Temps d’exposition prolon
g
é > court
Présence de lésions cutanées > absence
Pour les accidents percutanés Blessure profonde > superficielle
Ai
g
uille creuse > ai
g
uille pleine
Dispositif intravasculaire > sous-cutané ou intra
-
musculaire
Présence de sang visible > absence
Aiguille de gros calibre > faible calibre
Absence de port de gants > port de gants
Facteurs liés au patient source Stade SIDA > stades précoces de la maladie
VIH
(
sauf seroconversion
)
Lymphocytes CD4 inférieurs à 200 > CD4
su
p
érieurs à 200
Charge virale fortement positive > CV
faiblement positive ou indétectable

Sécurité en anesthésie 77
3. NOMBRE DE CAS DE TRANSMISSION DU VIH EN MILIEU DE SOINS
Le nombre total de contaminations VIH après AES chez des soignants était fin 1997
de 264 cas [16]. Parmi eux, 94 cas (35,6 %) sont des cas prouvés de séroconversion
après un AES. Des infirmières ou du personnel de laboratoire réalisant des prélève-
ments sont concernés dans un peu plus de 50 % des cas, 10 % sont des médecins non
chirurgiens, et 5,7 % des chirurgiens. Quatre cas (1,7 %) sont survenus chez du person-
nel de dialyse. Deux cas sont rapportés en anesthésie : un cas chez un «anesthesiology
technician» aux Etats-Unis après un accident percutané, et un cas chez une infirmière
de bloc opératoire après coupure avec du matériel orthopédique. Le nombre de cas en
France est de 42 cas, dont 13 cas prouvés, le dernier cas documenté étant survenu chez
une interne au décours d’une piqûre après gaz du sang.
3.1. RISQUE DE TR ANSMISSION DU VIH D ANS UNE STRUCTURE DE SOINS
Le risque de transmission du VIH est fonction de plusieurs variables : densité des
gestes, fréquence des AES, caractéristiques des AES, type de matériel employé, préva-
lence de sujets infectés par le VIH dans le service.
Les AES survenant au bloc opératoire sont à faible risque de transmission car ils
incriminent largement des aiguilles pleines à travers des gants ou des expositions cuta-
néo-muqueuses par porosité des gants ou des projections. Néanmoins, un nombre
important des cas de transmission sont survenus au bloc. Ceci peut être expliqué par la
très forte fréquence des AES au bloc opératoire et par la survenue de quelques acci-
dents à haut risque, tels que des coupures profondes avec des lames de bistouri
lourdement souillées avec du sang.
Les infirmiers paient un lourd tribut. Les prélèvements par ponction directe,
notamment artériel, les poses et déposes de perfusion, sont des gestes techniques com-
plexes à risque élevé de se compliquer d’un AES. Ce sont, en outre, des gestes très
courants, quotidiens pour certains patients, très denses en nombre pour une IDE dans
une seule journée dans certains services. Ils utilisent du matériel à haut risque de trans-
mission : aiguilles creuses, ayant servi pour des prélèvements sanguins (la lumière de
l’aiguille contenant du sang). L’association de gestes fréquents, souvent compliqués
d’AES, et de risque élevé de transmission potentielle du VIH, explique que plus de la
moitié des cas de contamination aient été rapportés chez des infirmiers.
La prévalence de l’infection par le VIH est de 0,11 % en Ile de France. Il est
couramment accepté que la prévalence dans les services de médecine et de chirurgie est
basse, mais celle-ci peut atteindre 80 à 90 % dans certains services de maladies infec-
tieuses. Les services à forte prévalence de patients infectés par le VIH sont à risque
accru lorsqu’aucune politique de lutte contre les AES n’y a pas été instaurée.
La méconnaissance du statut VIH des patients hospitalisés ou au bloc opératoire ne
pose pas de problème en soi. Le respect des règles de prévention des AES doit être
systématique, pour tous les patients et dans tous les secteurs de soins : médecine,
chirurgie, réanimation, et bloc opératoire. C’est le respect des mesures universelles de
prévention. Le dépistage systématique préopératoire n’est pas seulement contraire à la
déontologie. Il est surtout économiquement non rentable et n’a pas démontré son inté-
rêt en termes de réduction des AES au bloc opératoire. Certaines études ont même mis
en évidence une fréquence accrue d’AES peropératoires chez les chirurgiens informés
du statut VIH positif de leur patient. Enfin, le fait de prendre plus de précautions chez
un patient séropositif pour le VIH sous-entend qu’on en prend moins pour les patients
VIH négatifs, mais qui peuvent être porteurs d’autres agents non recherchés ou encore
à découvrir.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%