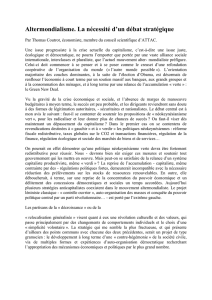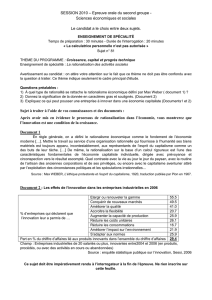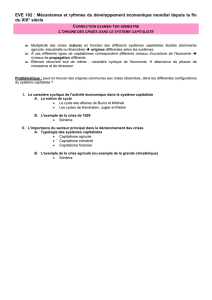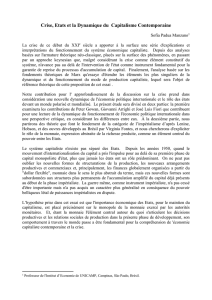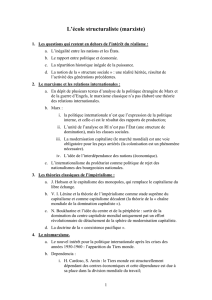Amérique latine et Caraïbes, des alternatives face à la crise

276
Amérique latine et Caraïbes,
des alternatives face à la crise
Julio Gambina
Une rupture de taille a eu lieu dans le champ des idées et la politique ; il
y a peu de temps encore, les agendas politiques se focalisaient sur les
effets des politiques de libéralisation de l’économie. L’appareil idéologique
et la pratique politique néolibéraux, à de rares exceptions près, étaient hégé-
moniques dans la pensée et l’action gouvernementales au niveau mondial.
Désormais, et depuis la n de la première décennie de ce 21e siècle, deux
phénomènes se présentent avec des autonomies relatives, notamment la crise
capitaliste d’une part et l’émergence d’un processus politique avec une visée
transformatrice en Amérique du Sud d’autre part.
Il s’agit d’une relation dialectique, d’une coexistence entre une crise de
l’ordre en vigueur construit depuis la dictature militaire au Chili en 1973
avec des processus politiques dans la région latino-américaine et caribéenne
qui sont les produits de la résistance aux politiques hégémoniques menées
jusqu’à aujourd’hui depuis ces années 1970. C’est un nouveau scénario qui se
construit depuis l’émergence du nouveau siècle, avec le forum social mondial
et ses suites ; les campagnes continentales contre la dette externe, la militarisa-
tion et le libre-échange ; et les luttes de chacun des peuples de la région contre
les politiques développementalistes impopulaires ; ces luttes sont liées aux
espoirs générés par les gouvernements constitutionnels portant un discours
critique vis-à-vis des modèles d’ouverture, de privatisation et de libéralisation
généralisées dans les années 1980 et 1990.

277
Amérique latine et Caraïbes, des alternatives face à la crise
Les États-Unis face aux mouvements populaires d’Amérique latine
Au sein de l’affrontement entre les idéologues néolibéraux soutenant qu’« un
autre capitalisme est possible » et ceux qui se prononcent pour « la voie socia-
liste », la cohabitation de visions contradictoires est un fait étrange. L’évidence
de la crise capitaliste nécessite une discussion entre les deux conceptions.
L’Amérique du Sud est précisément un territoire où se développe cette contra-
diction. On y trouve en effet à la fois des dynamiques politiques qui radicali-
sent leur critique du néolibéralisme et postulent l’idée d’un « socialisme du 21e
siècle » ; et en même temps d’autres qui persistent dans une perspective néodé-
veloppementaliste, avec l’illusion qu’un regain d’interventionnisme étatique
permettrait de normaliser le cycle économique et de rétablir les conditions du
« modèle social ».
Les espoirs de transformation, générés dans la région latino-américaine, s’enra-
cinent dans 50 ans de révolution cubaine et dans une expérience de lutte populaire
soutenue. Cette dernière contribua en 2001 à limiter l’expansion du capital. La
crise capitaliste qui s’est traduite par une récession cette année-là aux États-Unis
exigeait d’afner et d’accentuer la stratégie de libre circulation capitalistique.
Les États-Unis avaient besoin des capitaux mondiaux et sont parvenus à les
obtenir au prix de l’explosion de leur dette externe et d’une inversion des ac-
tifs dollarisés de tous les pays du monde. Dans ce cadre, le projet de l’ALCA
paraissait fondamental : il supposait la consolidation d’un domaine d’exploi-
tation propre, pour les capitaux étasuniens. L’objectif était l’exploitation de la
richesse en pétrole, eau, minéraux, biodiversité, en bref des ressources natu-
relles et de la force de travail qualiée et bon marché par rapport au prix de la
force de travail dans les pays capitalistes industrialisés.
La puissance impérialiste s’est transformée en grand acheteur du monde,
par l’approfondissement de son décit commercial et de sa dette pour soutenir
un immense décit scal. Celui-ci avait été creusé par sa politique de militari-
sation et d’agression mondiales.
Nous avons pu sortir de cette crise, bien que difcilement, grâce à des taux
de croissance limités en comparaison avec les années précédentes et en retar-
dant le moment de l’explosion jusqu’à 2007. Cette fuite en avant n’a donc pas
signié la réactivation d’un cycle de croissance durable.
Néanmoins, nous avons mentionné l’ALCA qui fut une stratégie validée
par les luttes populaires dont la force se manifesta durant le sommet des prési-
dents américains en avril 2001 à Québec (Canada). C’est là que s’agrégèrent
des mouvements sociaux de résistance (à la mondialisation capitaliste et au
libre-échange), avec les premières dissensions au sein des mandataires face
au rejet vénézuelien. Le Venezuela avait dans le même temps refusé 2005
comme échéance pour inaugurer la stratégie libre-échangiste ; et suggéré de
défendre la démocratie « participative » pour remplacer la « représentative ».

278
Julio Gambina
La résistance manifestée en novembre 2005 lors du sommet suivant fut bien
plus puissante. Ainsi, les peuples organisèrent leur propre sommet et réalisè-
rent des campagnes impliquant des millions de personnes dans la résistance
à la subordination. Face à la tentative étasunienne d’incorporer l’ALCA au
débat, le bloc MERCOSUR en lien avec le Venezuela (qui s’y intègrerait par
la suite) lui inigea une défaite : la politique étrangère des États-Unis considé-
rant l’Amérique du Sud comme son pré carré fut mise en échec.
Il existe des phénomènes propres au capitalisme étasunien pour expliquer sa
crise, mais on doit néanmoins faire des parallèles avec d’autres capitalismes
associés dans le cadre du système mondial, surtout dans les régions voisines.
En partant d’un autre point de vue, il s’agirait de voir comment s’articulent les
luttes populaires anti-ALCA, « antiyanqui », et anticapitalistes, et comment
elles s’inuencent mutuellement.
On ne saurait concevoir la crise des États-Unis sans les limites que les peu-
ples en lutte ont mises aux plans agressifs de l’impérialisme et à l’économie
de marché. Cela vaut tant pour la résistance irakienne et pour le mouvement
global de protestation contre l’invasion en 2003 que pour les dynamiques
populaires de lutte dans la région latino-américaine et caribéenne instituées
toutes ces dernières années. La mobilisation globale à Seattle en 1999, dont
les antécédents se manifestent dans la forêt Lacandona avec le soulèvement
des zapatistes en 1994 (simultanément à l’inauguration de la NAFTA), reste
signicative par son ampleur. Ce sont des moments fondateurs pour rééchir
au Forum de Porto Alegre en 2001 et à la consolidation du FSM durant les
rencontres successives jusqu’à Belém en 2009. On peut alors envisager une
proposition commune aux mouvements réunis en assemblée, avec 3 dimen-
sions : anticapitaliste, féministe et socialiste.
La réponse du capital
Pour toutes ces raisons, une discussion portant sur les raisons de la crise et
ses caractéristiques est tout à fait indispensable. Si le problème est la régu-
lation (en particulier des nances) alors la résolution doit passer par là, c’est
l’option choisie par les principaux conclaves ofciels depuis le début de la
crise et par la plupart de ceux qui dénoncent les excès des entreprises (que ce
soit par leurs pratiques managériales ou par l’accaparement des richesses) :
pour eux, la solution passe par la limitation des gains, des salaires et des pri-
mes, tant pour les actionnaires que pour les gestionnaires.
Est-il possible de réguler la domination monopolistique des multinationales
en ces temps de « révolution communicationnelle » ? Les normes de Bâle 1 (et
la qualité de leur application) donnent un avant-goût amer des échecs dans les
tentatives régulatrices du système nancier mondial ; de même que l’échec po-
litique concernant l’établissement de « codes de bonne conduite » aux FTN 2

279
Amérique latine et Caraïbes, des alternatives face à la crise
au sein de l’ONU. Ces derniers sont en totale contradiction avec l’accélération
de la dérégulation et des réformes législatives et judiciaires (surtout jurispru-
dentielles) favorisant la libre circulation des capitaux.
L’agression du capital portant sur l’exploitation des travailleurs et des res-
sources naturelles en vue d’atteindre ses objectifs propres met en lumière le
fait qu’il ne s’agit pas uniquement d’une crise économique mais bien d’une
crise systémique. La réponse du capital, au-delà de quelques nationalisations
proposées par les États capitalistes, est stratégique : il cherche à mettre en
place de nouvelles conditions économiques et politiques an de continuer à
faire avancer le capital. Et ce, quels qu’en soient les coûts sociaux et environ-
nementaux directement corrélés.
Récemment, le prix Nobel d’économie 2008 3 signalait : « Lorsque je lis les
commentaires récents concernant la politique nancière des hauts fonction-
naires [du gouvernement] d’Obama, je me sens dans un tunnel : c’est comme
si nous étions toujours en 2005, qu’Allan Greenspan était le maître, et les ban-
quiers des héros du capitalisme ». Cet analyste fait notamment référence aux
propos du « Mr Économie » aux États-Unis, qui avait afrmé : « Nous avons
un système nancier dirigé par des actionnaires privés et conduit par des ins-
tances privées ; et nous voudrions faire tout ce qui est en notre pouvoir pour
conserver ce système » (sic). Ce qui, venant de Timothy Geithner (secrétaire
au Trésor américain), est d’autant plus paradoxal que celui-ci s’apprêtait au
même moment à solliciter les contribuables pour compenser les pertes pha-
raoniques de ce même système.
De son côté, le Washington Post indique que Geithner et Lawrence Summer
(principal conseiller économique de Barack Obama) « considèrent que les
États sont de mauvais gestionnaires de banques », très probablement par op-
position aux génies du secteur privé qui se sont ingéniés à perdre plus d’un
milliard de dollars en quelques années. Paul Krugman exige d’aller dans le
sens des nationalisations temporaires puis de reprivatiser.
Dans une autre orientation, mais toujours dans le cadre du système capi-
taliste, Jeffrey Sachs 4 suggère qu’« un des apports historiques du président
Barack Obama sera une impressionnante démonstration de malabarisme po-
litique : convertir la sinistre crise économique en ouverture d’une ère de déve-
loppement durable. Son paquet de relance macroéconomique pourrait ou non
amortir la récession et il n’y a aucun doute que commencent d’âpres luttes
entre les partis pour dénir les priorités. Mais Obama a déjà xé le nouveau
chemin en réorientant l’économie, de la consommation des ménages vers les
investissements publics concentrés dans les secteurs-clés qui sont autant de
dés : énergie, climat, production agroalimentaire, eau, biodiversité. »
Il ajoute que « ce qui est en train de prendre forme n’est rien de moins qu’un
modèle de capitalisme du 21e siècle, conciliant les deux objectifs du déve-
loppement économique et de la durabilité ». Il suggère enn qu’il faut res-

280
Julio Gambina
tructurer l’industrie automobile an d’abandonner le « paradigme productif »
s’appuyant sur le pétrole ; au prot de nouvelles technologies énergétiques.
La réunion du G20 à Washington le 15/11/2008 sur « Les marchés nanciers
et l’économie mondiale » a insisté sur l’argumentaire de la libéralisation. Cette
réunion est la première d’une longue série dont la prochaine aura lieu début
avril 2009 à Londres 5. En réalité, il en est sorti peu de choses, et il ne saurait
en être autrement. En effet, cette problématique a été abordée de façon « natio-
nale » par tous les pays alors que la crise est globale et nécessite des réponses
systémiques et mondiales.
Il ne suft pas de dire que la crise vient des États-Unis ou qu’elle y a com-
mencé. Il est évident que la crise touche l’économie mondiale. Un autre pro-
blème a été la focalisation sur la dimension nancière : c’est sur elle que les
principales recommandations se sont portées. À savoir :
1. régulation et harmonisation dans la dénition et la prévention des risques ;
2. contrôle sur les produits nanciers dérivés et sur les organismes ban-
caires d’investissement qui étaient non contrôlés et insufsamment régulés ;
de façon générale, contrôle accru des instruments d’ingénierie de la nance
développés au cours des dernières années ;
3. revalorisation du FMI an qu’il retrouve son statut de premier assistant
nancier au sein des organismes nanciers internationaux, ce qui passe par
une augmentation de ses ressources.
En fait, le problème n’est pas seulement nancier mais économique, voire
civilisationnel : il affecte par là même la cohésion sociale en général. Or ce
problème est encore peu abordé. Durant la réunion du G7 de février 2009, à
Rome, le président de la Banque mondiale (Robert Zoellick) nous mettait en
garde : nous vivons « des temps très dangereux parce que la crise nancière
s’est convertie en une crise économique et de chômage de masse ; sans in-
terventions immédiates et de grande ampleur, elle se convertira en une crise
humanitaire » . La démission du ministre des Finances japonais, ivre durant
la réunion (dont il n’est rien ressorti de concret), est un fait curieux qu’il faut
noter. Cette absence de solution était également agrante lors du forum éco-
nomique mondial à Davos en 2009, où son coordinateur et instigateur Klaus
Schwab avouait que « ce fut l’édition la plus glauque » du fait des rares solu-
tions apportées pour régler la crise.
Cacher les dangers de la crise et, de la même façon, persister dans les recet-
tes ayant abouti à des crises locales depuis la « restauration conservatrice » 6
est grave. C’est pour cela qu’il faut penser en termes d’alternatives à l’ordre
nancier et économique an de proposer un autre agencement du système
mondial. C’est pourquoi, à côté du diagnostic, il nous semble intéressant de
pouvoir inclure de nouvelles réexions sur quelques-unes des possibilités
dans la conjoncture mondiale : en particulier les initiatives qui émergent en
Amérique latine et dans les Caraïbes.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%