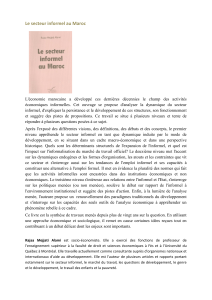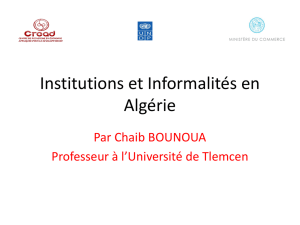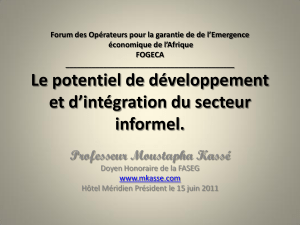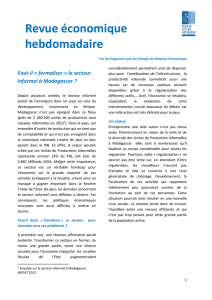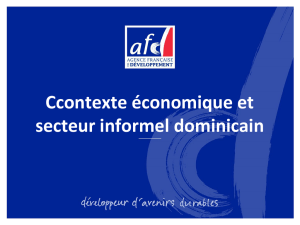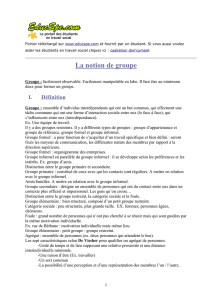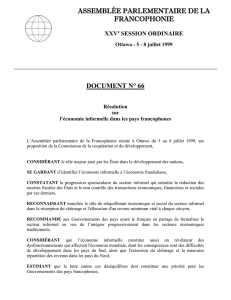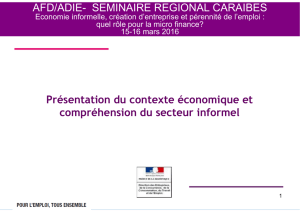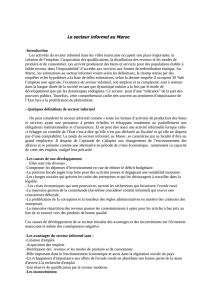LE SECTEUR INFORMEL

1
LE SECTEUR INFORMEL : CONCEPTS, ANALYSE
ET POLITIQUES
SOMMAIRE
INTRO
§ Accroche, ampleur du phénomène (quelques chiffres).
§ Historique, genèse de la notion se secteur informel : analyses dualistes en économie du
développement et réflexion sur le problème de l’absorption par le secteur moderne d’une
offre de travail croissante dans les villes (exode rural conjugué à la croissance
démographique). La présence dans les zones urbaines d’actifs à la recherche d’emploi a
mis en évidence l’existence d’un chômage ouvert [MARTINET, 1991]. Face à l’absence
d’indemnisation, les chômeurs urbains se sont alors organisés afin de trouver des revenus
monétaire hors du secteur moderne. Ce sont ces stratégies de survie qui ont fait émerger le
concept de secteur informel.
K. HART
Rapport Kenya BIT
§ Importance et enjeux des débats sur ce thème.
§ Problématique.
§ Plan.
I- Le concept de secteur informel en question.
Il s’agira dans cette section d’atteindre un triple objectif. D’abord, rappeler via une brève
synthèse les définitions et descriptions objectives du secteur informel, puis ensuite, en préciser le
fonctionnement et les logiques internes, pour enfin l’aborder à la lumière des théories élaborées à
son sujet (concernant ses causes et son rôle dans le cadre des PED.
A) Secteur informel : définitions, mesure et typologies.
1° Définitions et contenu descriptif.
a- D’une définition multicritère à la recherche du critère opérationnel.
L’intensité des débats sur la définition et le repérage du secteur informel semble pouvoir être
expliquée, outre les divergences théoriques sur la perception de ce secteur (cf. infra), par une
volonté manifeste des différents auteurs travaillant sur le sujet de parvenir à définir et cerner une
réalité éminemment complexe et hétérogène, tout en cherchant à rendre celle-ci la plus
opérationnelle possible à des fins statistiques et économétriques.
1ère définitions : définitions multicritère du BIT (rapport Kenya, 1972).
Reformulation de SETHURAMAN (1981)
Recherche d’un critère pertinent :
Taille
Non respect de la loi (non enregistrement, absence de comptabilité…) [CHARMES, 1990]
Facilité d’accès [DOERINGER,1988 ; FIELDS, 1990 ; HARBERGER, 1971]

2
Deux critères majeures : taille et non respect de la loi. On les retrouves dans la nouvelle définition
internationale du secteur informel donnée par la 15ème Conférence Internationale des Statisticiens
du Travail (CIST).
b- Contenu descriptif : acteurs et activités.
Patrons, entrepreneurs, salariés, apprentis…
Femmes, enfants, âge des acteurs du secteur informel…
2° Comment mesurer le secteur informel ?
a- Quelques difficultés.
Outre la difficulté de choisir une définition du secteur informel (cf. supra), la question de la
mesure du secteur informel se heurte à deux difficultés majeures :
Le problème de l’impossible dichotomie entre secteur informel et formel
[LAUTIER, 1994]
Le recueil des données [CHARMES, 1999 ; BACKINY-YETNA, 1999]
b- La mesure du secteur informel
En terme d’emploi
En terme de production (PIB)
3° Les typologies du secteur informel : vers une appréhension de son hétérogénéité.
Il est question ici de souligner l’apport des analyses de données ou de classification de groupes
dans l’objectif d’une meilleur observation du secteur informel notamment dans la distinction de
sous-groupes homogènes.
a- Analyse a priori [CHARMES, 1982 ; HUGON, 1980]
b- Analyse a posteriori [LACHAUD, 1995]
B) Logiques et dynamiques du secteur informel.
1° Les barrières à l’entrée
Financière
Non financière
2° Les sources de financement
Apport personnel
Famille
Finance informelle…
3° Dynamique de développement et accumulation du capital
Reproduction simple / élargie
Secteur involutif / évolutif
Accumulation extensive (logique économique, sociale et culturelle)

3
4° Les liens secteur informel / secteur formel
Sous-traitance
Achat de matière première
Pluriactivité
C) Les divergences théoriques.
1° L’approche néolibérale.
2° Le secteur informel soumis au capital : l’approche marxiste, néo-marxiste.
3° Economie populaire solidaire et sociale ou "autre société".
Toutes ces analyses s’intègrent dans une vision largement partagée et démontrée empiriquement
aujourd’hui d’un secteur informel duale (évolutif / involutif ou végétatif).

4
II- Les politiques d’accompagnement : soutien ou formalisation ?
A) Les politiques de formalisation.
1° L’échec des politiques de formalisation des années 70 au milieu des années 80.
2° L’approche néolibérale ou la "formalisation par le bas".
DE SOTO
PAS
3° La normalisation du secteur informel ou la "formalisation par le haut".
Droit du travail (contrat de travail), protection sociale.
Fiscalisation
B) Les politiques de soutien.
1° Les différentes formes de soutien
Action sur l’offre
Action sur la demande
Action sur l’environnement macroéconomique
2° Exemple de politique de soutien : Bénin [MALDONADO, 1995]
C) Pour une vision réaliste des politiques d’accompagnements : quelques éléments de
réflexions.
1° Revue critique : le dilemme du secteur informel.
Comment agir sur le secteur informel sans casser son dynamisme voire détruire son essence
même.
2° Soutien et formalisation : interdépendances et complémentarités.
Normes de travail et productivité.
Formalisation par la normalisation si et seulement si visibilité pour les petits producteurs
(suppose une politique de soutient).
3° La nécessité d’adaptation des politiques aux spécificités du secteur.
CONCLU
§ Synthèse
§ Ouverture : Question du système capitaliste et libéral dominant, concurrence
internationale…
Question du type de développement que l’on recherche, de la pertinence de la
notion de développement, de l’existence ou non de normes, droits
international…

5
INTRODUCTION
Les débats entamés depuis quelques années sur les alternatives possibles au système
économique dominant ont fait porter un nouveau regard sur le concept de secteur informel. Celui-
ci s’est vu attribué le rôle d’une possible "alternative informelle" [LAUTIER, 2003] à la
mondialisation libérale ou capitaliste. Dans le cadre des pays en développement (PED), la même
potentialité lui est attribuée en terme de stratégie alternative de développement. Mais avant
d’ambitionner de telles perspectives pour ce secteur, encore faut-il savoir de quoi l’on parle. En
effet, après plus de 30 ans de débats, la notion reste encore floue et on ne sait trop quelles
politiques lui appliquer.
La genèse de la notion de secteur informel nous renvoie au début des années 1950 avec
l’apparition des analyses dualiste des économies en développement1 et la réflexion sur le
problème de l’absorption par le secteur moderne d’une offre de travail croissante dans les villes
(sous l’effet conjugué de la croissance démographique et de l’exode rural). Si le modèle de LEWIS
(1954) prévoyait l’absorption progressive du surplus de main d’œuvre du secteur traditionnel par
le secteur moderne, force est de constater, pourtant, la présence dans les zones urbaines de la
plupart des PED, d’actifs à la recherche d’un emploi. L’existence de ce sous-emploi, ou chômage
ouvert, dans un contexte d’extrême rareté des indemnisations a obligé les chômeurs urbains à
trouver des opportunités de revenus hors du système moderne afin de vivre ou survivre2. Keith
HART, étudiant les opportunités de revenus des ménages au Ghana, introduit alors pour la
première en fois en 1971 la notion de secteur informel ("informal sector"3). Son étude ne sera
publiée que deux ans plus tard en 1973 dans le Journal of Modern African Studies [HART, 1973].
Entre temps, en 1972, le Bureau International du Travail (BIT) publie le fameux "rapport Kenya"
sur la situation de l’emploi urbain, à Nairobi notamment, et donne un première définition du
secteur informel en identifiant sept caractéristiques principales (cf. section I). C’est le point de
départ de plusieurs années de débats, toujours en cours à l’heure actuelle, voyant s’affronter une
multitude de définitions et théories du secteur informel. Pour s’en convaincre il n’est qu’à
constater la multiplicité des appellations (une vingtaine environs) apportés au fil de ces intenses
débats pour désigner une même réalité (cf. Annexe 1).
A partir des années 1980, la mise en place des programmes d’ajustement structurel (PAS),
sous l’égide du Fonds Monétaire International (FMI) et de la Banque Mondial (BM), dans la
majorité des PED va favoriser une explosion du secteur informel. Au nom d’une doctrine libérale,
les PAS vont imposer le désengagement de l’Etat dans les économies en développement, tant par
ses investissements que par ses effectifs. A un moment où l’offre de travail est en pleine
croissance, la chute des salaires, la multiplication des licenciements et plus généralement
l’aggravation de la crise économique et social engendrée par ces politiques d’austérités vont
contribuer à faire du secteur informel le plus grands pourvoyeur d’emploi. Ce sont, en effet,
plusieurs millions d’individus à travers le monde (hommes, femmes, enfants, vieillards) qui,
poussés par un naturel et légitime instinct de survie, viennent grossir les rangs du secteur
informel. Ainsi, selon MALDONADO (1993), en Afrique près de deux citadins sur trois en vivent et
dans un avenir proche, ce secteur fournira 93 % des nouveaux emplois. L’Amérique latine
n’échappe pas non plus au phénomène, le secteur informel créer dans cette région bien plus
1 On peut ainsi rappeler l’approche classique d’Arthur LEWIS (1954) dont le modèle dualiste distinguait un secteur
moderne d’un secteur traditionnel, le développement se définissant alors comme un processus d’absorption du
surplus de main d’œuvre du secteur traditionnel par le secteur moderne.
2 Titre de l’ouvrage dirigé par P. HUGON et I. DEBLÉ (1982) : Vivre et survivre dans les villes africaines, PUF, coll.
Tiers Monde.
3 La traduction française a souvent été critiqué car le terme informel renvoie à l’absence de forme alors que
"informal" signifie irrégulier et renvoie donc plus à l’absence de caractère officiel [MARTINET, 1991].
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
1
/
26
100%