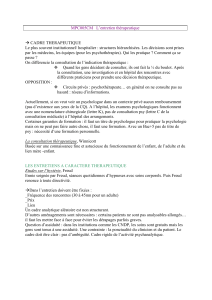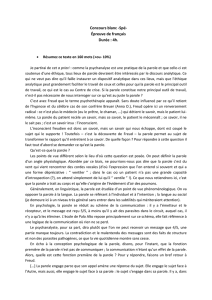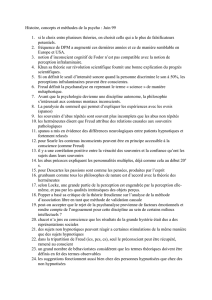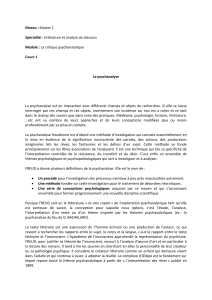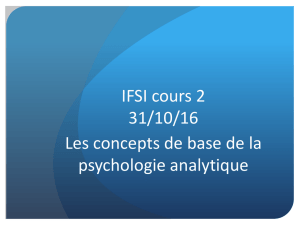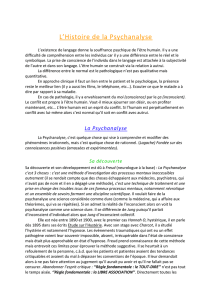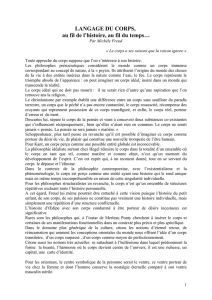160. Le désir ne tire pas, il pousse

GUY LE GAUFEY
LE DÉSIR NE TIRE PAS, IL POUSSE
Si les sciences sociales que vous défendez se heurtent à la monomanie de l’utilitarisme,
cette pressante et constante invitation à courber la tête sous la puissance rationnelle de l’utilité
en tant que cause finale, la psychanalyse depuis Freud peut passer pour être, à vos côtés, ce
que l’on appelait dans le temps un « allié objectif ». Depuis ses tout débuts en effet, on ne
cesse, aujourd’hui comme hier (et peut-être plus encore qu’hier) de la considérer comme une
forme de psychothérapie, autrement dit de lui refiler en douce un but univoque puisque
« thérapie », de quelque façon qu’on le prenne ou le leste, indique un but à atteindre qui
placerait l’acte analytique sous l’égide du serment d’ Hippocrate.
L’affaire n’est pas nouvelle. Dans un texte célèbre à plus d’un titre – La question de
l’analyse profane – Freud avait en 1926 entrepris de défendre publiquement Théodore Reik des
accusations de « pratique illégale » de la médecine relativement à son activité de jeune
psychanalyste. Dans son effort pour détacher la pratique analytique de tout ce qui lui paraissait
de nature à faire litière de sa singularité, Freud tenait à la distinguer de la médecine dont il la
savait pertinemment issue. Lui-même avait déconseillé au jeune Reik d’entreprendre des études
de médecine pour devenir analyste, ce qui, évidemment, lui donnait quelque responsabilité dans
le procès alors intenté à son élève.
Dans ce texte décisif, Freud se donne un « interlocuteur impartial », sorte de grand
commis de l’État dont Alexandre Kojève incarne pour nous le modèle : un mélange de
rationalité, d’intelligence et de bienveillance toute républicaine. Cet interlocuteur veut
comprendre la psychanalyse, et Freud, bonne pâte, lui explique par le menu refoulement, après-
coup, symptôme, fantasme, transfert, etc. L’autre accepte toutes ces merveilleuses et subtiles
explications qui lui dévoilent des pans entiers de la psyché humaine, mais il reste à chaque fois

Cerisy, p. 2
avec une question dont il lui paraît que Freud ne cesse pas de ne pas y répondre : quel est le
but de tout ce travail et de toutes ces constructions passionnantes, sinon la guérison des
souffrances initiales du patient ? Et Freud, qui pourtant tient la plume, se dérobe
méthodiquement, ne convient à aucun moment d’une finalité ultime de tout ce travail. Au point
que l’interlocuteur presque s’énerve : tout cela est fort bien, mais la logique de l’État implique
que toute activité qu’il est prêt à reconnaître s’inscrive, d’une façon ou d’une autre, dans la
perspective du bien des sujets dont il est lui-même composé. Donc aucune activité légitime ne
peut échapper à une telle exigence, quand bien même elle y contreviendrait, comme celle du
grand criminel, dont la vilenie reste jugée selon les critères de ce bien commun qui mérite
l’adjectif de « souverain ». La stratégie de Freud à cet endroit est assez complexe à déplier.
Ce refus de répondre n’est en rien idéologique, mais clinique. Au décours de ses
premiers traitements de patientes hystériques, Freud a appris à ses dépens que plus il leur
dévoilait ses ambitions thérapeutiques, et plus il pouvait être assuré d’un échec complet, voire
cuisant. C’était donc d’abord au titre de ruse technique qu’il importait de n’établir aucun « contrat
thérapeutique » sur la base d’un objectif commun que le mouvement même de l’hystérie était
destiné à nier de par la dynamique du désir qui l’anime.
Dans l’exacte mesure où le désir de l’hystérique revient à susciter et soutenir le désir de
l’autre, il est en effet exclu que ce désir là soit satisfait et, de ce fait, courre le risque de s’écraser
dans son propre accomplissement. Les exemples ici pourraient abonder ; on se contentera ici
du plus spirituel, celui dit de « la belle bouchère ». Dans le droit fil de l’analyse d’un rêve fait
pour démontrer à Freud que son idée selon laquelle « tout rêve est accomplissement de désir »
est erronée (elle est lectrice de L’interprétation du rêve), celle-ci raconte à Freud qu’elle adore
les sandwiches au caviar, mais qu’elle se garde bien de le dire à son mari parce que, ce dernier
cédant systématiquement à toutes ses demandes, il s’empresserait de lui en apporter. Or ce à
quoi elle tient avec son désir de caviar, pour le dire un peu trop vite, c’est qu’il fonctionne
comme métonymie du désir qu’elle veut que son mari ait pour elle : elle désire donc avant tout
que ce dernier puisse deviner ce qu’elle désire, qu’il se risque à lui donner forme et substance,
raison pour laquelle elle se doit de ne pas le lui souffler à l’oreille. Si par précipitation et
maladresse, elle ravalait son désir de caviar à une simple demande de caviar, elle pourrait être
sure de rester sur sa faim quant à savoir si son mari la désire ou seulement cherche à lui plaire.
Je ne doute pas que vous perceviez la nuance puisque, en tant que spécialistes du don, vous
savez à quel point le don véritable ne relève pas de la prestation de services.

Cerisy, p. 3
Si les choses s’arrêtaient là, néanmoins, il ne s’agirait que de ne pas dévoiler un but qui,
par ailleurs, pourrait fort bien se maintenir en fonction. Nous en resterions au niveau de la ruse,
disons, stratégique : je ne te dévoile pas mon objectif de façon à ce que tu ne saches pas
comment organiser ta défense ou ton attaque. Sauf qu’il ne s’agit pas ici d’«objectif », mais de
« finalité ». Subtile différence.
Une « fin » peut certes s’incarner dans un « objet », sinon toujours mondain, à tout le
moins idéel. Plutôt que de me lancer ici dans de subtils distinguos philosophiques, je me
tournerai une nouvelle fois vers Freud, celui de la troisième partie de l’Esquisse, ce texte génial
qu’il écrivit à son ami Fliess en 1897. Cherchant à définir le type de travail qu’il exige du patient
avec sa règle dite « fondamentale » mise en place de l’hypnose, à savoir « dire ce qui vient à
l’esprit » en suspendant tout ce qu’il appelle des « représentations-but » (Zielvorstellungen), il en
vient à parler d’un travail « Zielloss », sans but. La psyché ne livrera certains de ses secrets que
si celle ou celui qui convient de se prêter à cette règle analytique accepte de parler « sans but »,
révélant de ce fait la machinerie qui a permis d’en construire quelques-uns, entre autres ceux
qui s’organisent sous le nom de « symptômes », voire ce qui s’est organisé jusqu’à mériter le
nom de « fantasme ». Cela ne va pas sans résistance, bien sûr, mais il importe de bien
comprendre à quel point cette règle porte autant à conséquences pour celui ou celle qui l’édicte
que pour celui ou celle qui s’y soumet.
Car c’est là que l’affaire dépasse la simple ruse technique. Loin d’être le spécialiste de
l’inconscient, du trauma, de la vie sexuelle, des désordres pulsionnels, du complexe d’Œdipe ou
des problèmes relationnels, l’analyste se prête d’abord et délibérément à ce que Lacan n’a pas
hésité à nommer « une pratique de bavardage ». De là s’ensuit, tout simplement, qu’il ne sait
pas où il va alors même qu’il ne démord pas de la façon selon laquelle il y va. J’oserai dire qu’à
l’inverse bon nombre de psychothérapeutes savent d’autant mieux où ils veulent aller qu’ils sont
assez peu regardant sur les moyens d’y parvenir (pure médisance).
Cela suffit-il néanmoins pour libérer l’analyste de quelque finalité que ce soit par simple
respect pour son acte ? Sûrement pas, puisqu’une une finalité reste toujours possible, d’une part
du côté de l’analysant qui, d’une façon ou d’une autre, entreprend ce travail coûteux en temps et
en argent non sans quelque petite idée derrière la tête (entre autres celle, parfaitement
respectable, d’aller mieux), mais aussi bien du côté de l’analyste où l’ambition de n’entretenir
aucun but pourrait s’en révéler un d’autant plus retors. Je tiens donc seulement pour décisif le
fait que tous deux ne scellent aucun accord de principe sur une finalité qu’ils partageraient, ne
s’entendant explicitement que sur une méthode, sans précision aucune sur sa fin, qu’on la

Cerisy, p. 4
conçoive comme événement conclusif (quand et comment se séparer) ou comme but à
atteindre.
La raison d’une telle retenue méthodique tient encore au transfert. Lorsque Freud, à la fin
d’un chapitre de L’interprétation du rêve, fait une nouvelle fois état de ladite règle fondamentale
et de sa suspension de toute « représentation-but », il remarque que, même dans le cas idéal
où une telle règle serait pleinement appliquée, une Zielvorstellung restera en vigueur, quand
bien même le patient n’en « aurait aucune idée » ; celle de « die meiner Person ». La prise en
considération de ce phénomène change tout.
Celui ou celle qui a mis en place cette procédure doit s’en tenir pour l’adresse
permanente, et ne pas négliger ce fait dans le déroulement de ladite procédure. C’est même la
raison pour laquelle il tient autant à ce qu’aucune autre finalité ne vienne s’interposer entre le
patient et lui ou elle. Le tiers est exclu, non seulement en corps – pas de vitre teintée, ici,
comme dans les interrogatoires/confessions des séries policières –, mais tout autant sous la
forme idéelle d’un but à atteindre en commun, comme aussi bien sous la forme larvée
d’informations extérieures à la parole du patient, qui viendraient confirmer ou infirmer son dire.
Avec toutes ces contraintes, nous voilà bien au-delà de la simple ruse technique, coincés dans
une pratique langagière qui, tout en ayant l’air d’un libre échange entre deux individus qui « se
causent », révèle un usage très artificiel de la parole dans lequel le tiers est tenu à l’écart,
jusque dans ses formes les plus subtiles.
Si on l’applique avec rigueur, ce refus systématique du tiers, au départ dicté pour des
raisons qu’on pourrait presque dire « techniques », atteint des extrêmes que Freud lui-même
n’avait pas prévus, ou pas osé affronter. À la fin de son texte en effet, après avoir débouté la
bienveillance du grand commis de l’État à accueillir la psychanalyse sous son égide, il la confie
au tout jeune institut de Berlin, estimant que seuls des psychanalystes peuvent assurer et
surtout contrôler la production d’analystes, puisque tout analyste doit avoir accompli une
analyse. Or, depuis lors, à la différence de Freud, nous savons bien à quel point les différents
instituts de psychanalyse se sont ingéniés à s’immiscer dans les cures dites « didactiques »
jusqu’à y jouer ce rôle de tiers qu’officiellement elles continuent bien sûr de proscrire. En
dénonçant cette pratique, Lacan a été conduit à inventer une procédure dite de la « passe » qui
ambitionne de jouer autrement sur ce point crucial, sans qu’on puisse dire avec clarté
aujourd’hui si elle y est parvenu ou pas. Dans certains cas, il est sensible qu’elle n’est qu’un
paravent au jeu institutionnel classique, dans d’autres… il est bien difficile de savoir ce qui se
passe.

Cerisy, p. 5
En dépit des mystères et des difficultés qui continuent de planer sur la transmission
effective de la psychanalyse, l’expérience freudienne met l’accent sur le mode d’existence du
tiers dans la question de la finalité, d’une façon peut-être pas toujours aussi visible sur le terrain
sociologique. J’en tiens pour preuve l’argument des deux prisonniers que j’ai été amusé de
trouver à des endroits fort différents dans mes récentes lectures sur les sciences sociales : si
l’un des deux suspects dénonce l’autre et que l’autre se taise, le premier est libre et le second
écope de dix ans de prison, si tous deux se dénoncent, ils ont cinq ans chacun, et s’ils se taisent
tous deux, ils n’ont plus que six mois à faire. L’argument supposément utilitaire voudrait que,
face au risque de se retrouver avec dix ans de prison si l’autre parle, aucun ne garde le silence,
et qu’ils fassent chacun cinq ans alors qu’ils auraient pu ne faire que six mois. Mais d’où
s’énonce une telle règle d’utilité qui démontrerait l’absurdité de l’utilitarisme ? Il est clair qu’en
pays mafieux, un tel argument n’a plus qu’un seul destin : provoquer l’éclat de rire général, car
l‘omerta étant la règle, il est bien évident que chacun va se taire – dans son plus strict intérêt, au
demeurant, puisque, s’il parle et dénonce l’autre, il est mort dès la sortie que le juge, en toute
innocence, va lui accorder. Le tiers de l’État de droit n’est donc pas celui de la famille mafieuse :
on s’en doutait un peu, au moins depuis Hobbes et sa « personne fictive », mais l’on pressent
par là qu’aucun argument ou paradoxe anti utilitaire n’aura jamais force de loi, ne sera jamais
très convaincant.
On devine aussi de ce fait par où l’utilitarisme, qui sait pouvoir gagner à tous les coups,
offre le flanc : son imputation d’une utilité dernière et rectrice vaut ce que vaut l’existence du
tiers sur lequel il accroche, l‘air de rien, la question des fins dernières. Qui osera en effet jamais
dire que, de tiers, il n’y en a pas ? Personne ! Y en a-t-il pour autant toujours et partout ? Bien
sûr que non ! La moindre des disputes de ménage vient démontrer le contraire. Et rien n’assure
à l’inverse que les amoureux regardent ensemble dans la même direction ! Pour ne rien dire de
la répétition qui anime le symptôme névrotique, logée par Freud à l’enseigne d’un « au-delà » du
principe de plaisir.
Parce que sa politique l’a d’emblée rendue pour le moins méfiante à l’égard de toute
forme du tiers, la psychanalyse en est venue à constituer son pré carré à la fois hors toute
reconnaissance étatique et hors toute finalité expressément affirmée de son acte – les deux
étant étroitement corrélées. Aujourd’hui que l’État a promu, par-delà le citoyen qui constitue sa
base, la figure du « consommateur » qu’il entend désormais protéger de toutes les malfaçons
possibles et imaginables en régime capitaliste du profit maximum, l’utilitarisme est plus que
jamais aux commandes. Le Tiers-État en sort magnifié, considérant comme mafieux, terroristes,
 6
6
1
/
6
100%