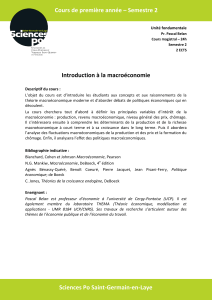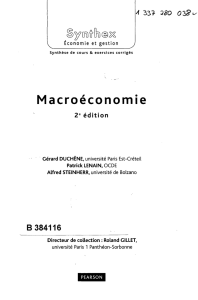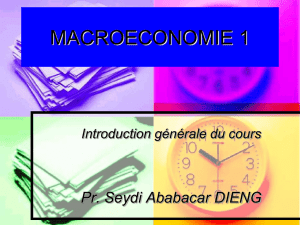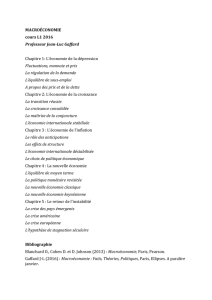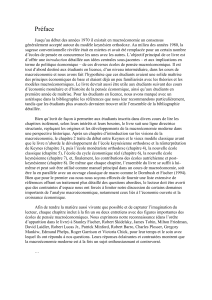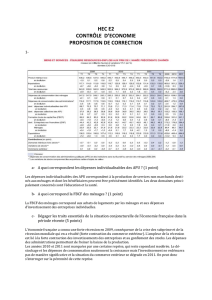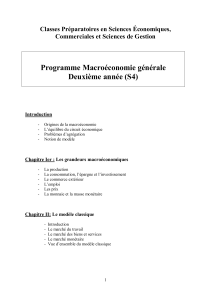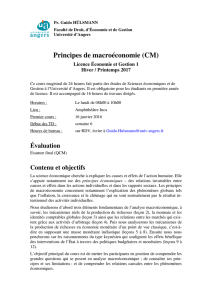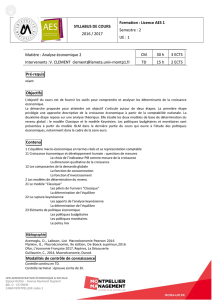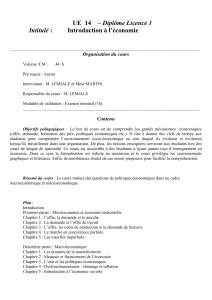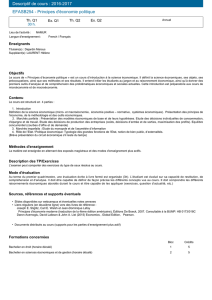Chroniques d`économie politique - Espace Culture

Pour le lecteur peu habitué aux « subtilités » de la science
économique, il est de coutume en économie de distinguer
la microéconomie de la macroéconomie. Cette distinction
repose, de prime abord, sur le niveau d’analyse retenu par
chacune des deux disciplines, la microéconomie se préoccu-
pant des phénomènes concernant des entités économiques
singulières (entreprise, ménage, marché) quand la macro-
économie s’intéresse à la dynamique du système économique
pris dans son ensemble.
Mais cette simple différence d’échelle de l’analyse a éga-
lement de profondes implications, trop souvent oubliées,
quant à la nature même de l’analyse. Dès lors que l’on se situe
au niveau microéconomique, il est normal de se concentrer
sur des dimensions comportementales, comme la rationalité d’un
acteur plongé dans un environnement donné (la fameuse
clause selon laquelle « toutes choses doivent rester égales
par ailleurs » tient), les décisions que cet acteur prendra...
Quand on se situe au niveau macroéconomique, il n’est plus
question de traiter du « comportement » à proprement parler,
ou des « décisions » d’un système. Ce qui importe, c’est la
confrontation des décisions des acteurs dans un environ-
nement où les choses ne sont plus égales par ailleurs. Trop
d’économistes, obnubilés par les questions d’optimalité
associées à l’univers microéconomique de la prise de décision
sous contrainte, oublient cette nécessaire suspension de
la clause ceteris paribus quand ils en viennent à parler de
macroéconomie. Or, ce qui confère à la macroéconomie son
autonomie, son existence propre, c’est bien le fait qu’elle ne
se réduise pas à une agrégation des différentes microécono-
mies. Celui qui a le mieux mis en évidence que le tout ne
se résumait pas à la somme des parties dès les années 1930,
à savoir John Maynard Keynes, est aussi celui qui a le plus
sûrement établi une macroéconomie pleinement ouverte à
des effets de composition, à des paradoxes spécifiquement
macroéconomiques. Ce qui est valable au niveau d’un acteur
isolé ne l’est plus nécessairement quand on passe au niveau
macroéconomique de l’ensemble des acteurs, et les choses
peuvent même tout bonnement s’inverser. L’oublier, c’est
se condamner à retourner dans un univers pré-keynésien
dont on sait qu’il était plutôt mal agencé pour traiter des
problèmes d’une économie en dépression. À l’heure où la
conjoncture économique sonne comme l’écho inquiétant de
la Grande Dépression des années 1930, il peut être oppor-
tun de se remémorer quelques recettes macroéconomiques
de bonne conduite en cas de crise, recettes basées sur une
solide distinction entre les conclusions valables au niveau
microéconomique et celles valables au niveau macroécono-
mique.
L’épargne, entre vertu privée et vice public
Le premier exemple de décalage entre les niveaux micro et
macro tient au caractère souhaitable de l’épargne. S’il est
souvent mis en avant que l’épargne est une vertu pour un
ménage particulier, parce que cela dénote une forme de pru-
dence dans la gestion des affaires du foyer, la recherche de
la frugalité, quand elle est généralisée au niveau du système
économique, engendre une dynamique macroéconomique
beaucoup plus questionnable. L’épargne n’est qu’un refus de
dépenser aujourd’hui, qui ne s’accompagne d’aucun enga-
gement à dépenser plus demain. En cela, une société dont
les membres seraient contaminés par un désir d’épargner
davantage verrait son activité économique ralentir, faute
de débouchés offerts aux productions nationales (avec, au
bout du compte, une épargne globale qui pourrait même
se mettre à baisser). Inversement, une société touchée par
une fièvre de « désépargne », c’est-à-dire d’endettement, se
verrait stimulée dans sa croissance économique.
Les États-Unis (mais aussi l’Espagne ou l’Irlande des années
2000) ont constitué un exemple extrême d’une croissance
économique tirée par la baisse du taux d’épargne et l’envolée
du crédit, avant que la bulle de l’endettement n’éclate, à
partir de 2007. Malgré sa condamnation morale dans la
sphère privée, le goût de la dépense est donc un puis-
sant levier de croissance au niveau macroéconomique, et
cela d’autant plus quand existent des effets d’imitation qui
déversent en cascade les normes de consommation, petit à
petit des ultra-riches aux aisés, puis aux classes moyennes et
populaires. En quelque sorte, sur la voie de la prospérité éco-
nomique, le chemin du paradis est pavé de mauvaises inten-
tions (la dépense), quand les bonnes intentions (l’épargne)
conduisent tout droit à l’enfer (la dépression économique).
En particulier en cas de crise économique, une vague de
désendettement désiré par les ménages pourra se traduire
par une dépression prolongée, surtout si personne n’accepte
de s’endetter en lieu et place des ménages... Or, c’est juste-
L’État n’est pas un « bon père de famille »
Maître de conférences en économie, Université
du Littoral Côte d’Opale, TVES
Par Thomas DALLERY
Si cette sentence fait oce de titre, c’est parce qu’elle résume ce qui pourrait être tenu comme le message essentiel
d’une bonne macroéconomie.
14
chroniques d'économie politique coordonnées par Richard Sobel / LNA#63 LNA#63 / chroniques d'économie politique coordonnées par Richard Sobel

ment l’une des fonctions essentielles de l’État que d’accepter
une dégradation de ses comptes lorsque l’économie privée
se grippe, et c’est même l’accroissement du déficit public qui
permettra le désendettement du secteur privé.
Vouloir réduire le décit public a toutes les chances
de l’aggraver
On en arrive ainsi au deuxième exemple de paradoxe micro/
macro. S’il est parfaitement normal d’attendre d’un ménage
qu’il exhibe une situation financière saine, un État n’est pas
un acteur microéconomique et, à ce titre, il n’est pas soumis
aux mêmes règles de bon sens. En particulier, un ménage
isolé a toutes les chances de réussir à se désendetter en se serrant
la ceinture, lorsque les autres maintiennent leur comporte-
ment inchangé. Il n’en va pas de même d’un État. De par
son poids économique, et surtout de par les effets multi-
plicateurs de ces actions, un État qui déciderait de couper
dans ses dépenses et d’augmenter les impôts pour essayer
de résorber son déficit public provoquerait une récession
économique potentiellement si marquée qu’elle aboutirait
à une dégradation des comptes publics, sous l’effet conju-
gué d’une remontée mécanique des dépenses liées à la
crise (indemnités chômage notamment) et d’une diminu-
tion tout aussi mécanique des recettes fiscales (ex : moins
de TVA rentre dans les caisses de l’État s’il y a moins de
consommation).
Après une période relativement courte durant laquelle les
gouvernements ont exhumé quelques vieilles recettes de
relance keynésiennes, ils ont presque unanimement fixé
comme nouvelle priorité le redressement des comptes
publics (depuis 2010). Les plans d’austérité, d’abord admi-
nistrés aux pays les plus fragiles de la zone euro (Grèce,
Irlande, Portugal, Espagne), se sont ensuite généralisés
aux États du cœur de l’Europe (France, Allemagne,
Italie, Royaume-Uni). Or, au-delà des degrés variés de baisse
de dépenses et d’augmentation d’impôts selon les pays,
le point commun de ces plans est qu’ils pêchent à chaque
fois par excès d’optimisme, ou par refoulement de la pensée
keynésienne. En effet, les prévisions de croissance qui sous-
tendent la réussite de ces politiques de rigueur sont à chaque
fois surestimées, puisque ces prévisions sont basées sur des
multiplicateurs keynésiens eux-mêmes sous-estimés, ce qui
génère une non-prise en compte des effets récessifs des plans
de rigueur. Devant les révisions successives (à la baisse) des
prévisions de croissance, et donc des déficits publics (à la
hausse), le Fonds Monétaire International a récemment fait
son mea culpa, en concédant qu’il avait mal pris en compte
les effets multiplicateurs des plans de rigueur sur la croissance
(et les déficits) dans ses études.
L’enjeu de cette concession du FMI (tournant historique
durable ou simple feu follet) est bien crucial, notamment en
Europe. Le FMI est en effet partie prenante de la Troïka
(avec la BCE et la Commission européenne) qui a poussé à
l’adoption des plans d’austérité dans les pays en difficulté,
et les plans ont été d’autant plus sévères que ces coupes dans
les dépenses publiques avaient été anticipées comme n’ayant
que peu d’effets sur la croissance et l’emploi. La redécouverte
qu’a permis la crise – l’État est un acteur macroéconomique,
et la réduction de son déficit public a des effets sur le sys-
tème économique, là où l’action d’un individu isolé n’aurait
guère d’impact – n’a pas été obtenue sans frais. Certes, le
FMI a fait amende honorable, mais les Grecs, les Espagnols,
les Italiens... ont eu à subir les ravages des politiques
d’austérité, sans que celles-ci aient atteint leur objectif (redres-
ser les comptes publics). L’oubli de la macroéconomie, et
notamment de la macroéconomie keynésienne, a mené à
adopter des politiques économiques aussi cruelles qu’inutiles,
ouvrant ainsi la voie à une décomposition sociale favorisée
par des États européens se comportant en bien piètres pères
de famille pour leurs citoyens...
chroniques d'économie politique coordonnées par Richard Sobel / LNA#63
15
1
/
2
100%