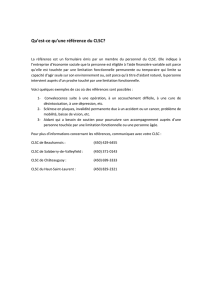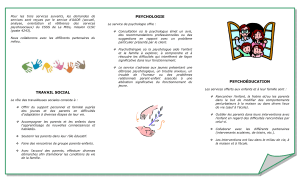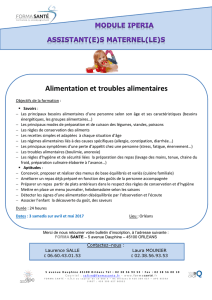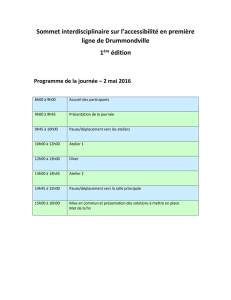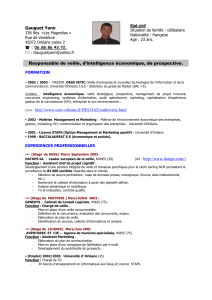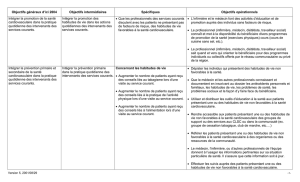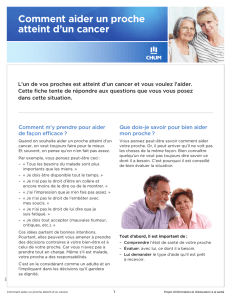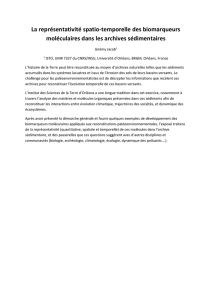Projet d`intervention communautaire pour la lutte au cancer du sein

6
RÉGIE RÉGIONALE
DÉ LA SANTÉ ET DES
SERVICES SOCIAUX
DE QUÉBEC
DE LA SANTÉ PUBLIQUE
Projet d'intervention communautaire
pour la lutte au cancer du sein
dans le territoire du CLSC Orléans
Rapport de l'évaluation de l'implantation
Louise Moreault
Claude Gagnon
Céline Lepage
Direction de la santé publique
Régie régionale de la santé et des services sociaux de Québec
Novembre 2000
e
INSPQ.Montréal
. .
, ,
\mm

SANTÉCOM
Vous pouvez vous procurer ce rapport au coût de 5,00 $ incluant la
TPS et les frais postaux en faisant parvenir votre chèque au :
Centre de documentation
Direction de la santé publique de Québec
2400, d'Estimauville
Beauport (Québec) G1E 7G9
Téléphone : (418) 666-7000 poste 217
Télécopieur : (418) 666-2776
Courrier électronique : sbelanqer@csDQ.qc.ca
Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Canada, 2000
Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Québec, 2000
ISBN : 2-89496-161-8
Citation suggérée :
Moreault, L., Gagnon, C., Lepage, C. (2000). Projet d'intervention
communautaire pour la lutte au cancer du sein dans le territoire du
CLSC Orléans : rapport de l'évaluation de l'implantation, Direction de
la santé publique, Régie régionale de la santé et des services sociaux
de Québec, 34 p.
Cette publication a été versée dans la banque SANTÉCOM.

RÉGIE RÉGIONALE
DE LA SANTÉ ET DES
SERVICES SOCIAUX
DE QUEBEC
DIRECTION!
DE
LA
SANTÉ PUBLIQUE
Institut national
de
santé publique,
du
Québec
4835,
avenue Christophe-Colomb, bureau 200
Montréal
(Québec)
H2J3G8
Tél.:
(514)
597-0606
Projet d'intervention communautaire
pour la lutte au cancer du sein
dans le territoire du CLSC Orléans
Rapport de l'évaluation de l'implantation
Louise Moreault
Claude Gagnon
Céline Lepage
Direction de la santé publique
Régie régionale de la santé et des services sociaux de Québec
Novembre 2000

RÉSUMÉ
Le projet d'intervention communautaire pour la lutte au cancer du sein dans
le territoire du CLSC Orléans est un projet issu de la communauté qui
consiste à sensibiliser les femmes à l'importance du dépistage du cancer du
sein. Plus spécifiquement, les objectifs du projet visent l'amélioration des
connaissances des femmes sur le cancer du sein et la mise en place
d'interventions les incitant à adhérer au Programme québécois DE DÉPISTAGE
DU CANCER DU SEIN.
Une évaluation a été réalisée afin d'analyser l'implantation de ce projet de
mobilisation communautaire. Cette évaluation comporte trois objectifs. Le
premier consiste à mesurer les écarts entre la clientèle visée et celle
rejointe. Le deuxième veut vérifier si les activités et les modalités de
fonctionnement réalisées correspondent à celles prévues. Le troisième tente
d'identifier les conditions facilitantes et les principales difficultés rencontrées.
Il ressort des résultats que la stratégie de mobilisation communautaire a été
appliquée avec succès. Elle a permis la mise en commun de ressources, la
coordination d'actions complémentaires sur le terrain et semble avoir
contribué à une prise de conscience plus intense du problème de santé que
représente le cancer du sein.
Les résultats concernant la clientèle montrent que plusieurs femmes ont été
rejointes, en particulier celles de 50 à 69 ans, groupe d'âge spécialement
visé par le projet et par le Programme québécois DE DÉPISTAGE DU CANCER DU
SEIN.
L'analyse des résultats portant sur les activités et les modalités de
fonctionnement met en lumière l'importance de réaliser différentes
interventions pour rejoindre le plus de femmes possibles. Ainsi, les
rencontres animées, les cafés-rencontres, les dîners-causeries, les kiosques
en grande surface et les « mini-kiosques » ont représenté des moyens variés
et complémentaires. Parallèlement, des activités promotionnelles ont servi à
annoncer la tenue de ces activités.
L'évaluation a finalement permis de distinguer quelques conditions
facilitantes et certaines difficultés rencontrées. Du côté des conditions de
succès, il convient de signaler, entre autres, l'intégration de cliniques de
sensibilisation existantes au CLSC, la souplesse dans la gestion et le mode
de fonctionnement et l'implication de gestionnaires dès le début du projet.
En revanche, la connotation négative du terme « cancer » au moment du
recrutement, le roulement des partenaires, plus particulièrement des
médecins du CLSC et les délais dans l'attribution du budget se sont avérés
des embûches dont il faudrait tenir compte advenant la reprise du projet
ailleurs ou dans d'autres contextes.
PROJET D'INTERVENTION COMMUNAUTAIRE POUR LA LUTTE AU CANCER DU SEIN DANS LE TERRITOIRE DU CLSC ORLÉANS - NOVEMBRE 2000 I

REMERCIEMENTS
Les auteurs tiennent à remercier chaleureusement les partenaires du projet
de mobilisation qui ont participé activement au comité de gestion. Il s'agit de
mesdames Johanne Vézina et Claire Benjamin, infirmières au CLSC Orléans,
madame Pauline Bergeron, chef de programme en soins infirmiers au CLSC,
mesdames Simone Bérubé du Comité Beauport Ville en santé et
Marie-Thérèse Mercier des Filles d'Isabelle de la Côte de Beaupré,
animatrices ainsi que mesdames Louise Côté et France Dupont, médecins au
CLSC Orléans.
Nous sommes aussi reconnaissants envers les coordonnatrices du CLSC qui
se sont impliquées au moment du démarrage du projet : madame
Andrée Gauthier, madame Marielle Lavallée et madame Linda Gorman. De
plus, nous voulons souligner l'implication récente de deux nouvelles
collaboratrices du CLSC, mesdames Lisane Boisvert, organisatrice
communautaire et Odette Nicole, médecin.
Nous remercions enfin madame Dany Laverdière pour le traitement
informatique des données et madame Hélène Girard qui a réalisé
minutieusement le travail d'édition de ce rapport.
PROJET D'INTERVENTION COMMUNAUTAIRE POUR LA LUTTE AU CANCER DU SEIN DANS LE TERRITOIRE DU CLSC ORLÉANS - NOVEMBRE 2000 iii
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
1
/
43
100%