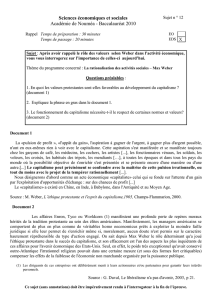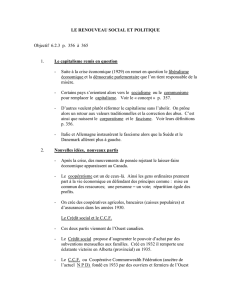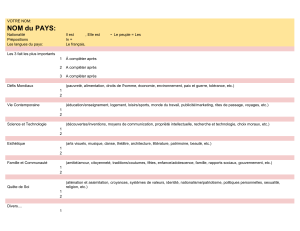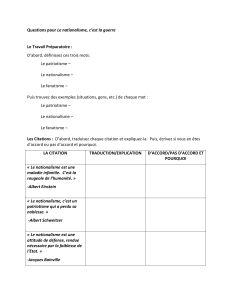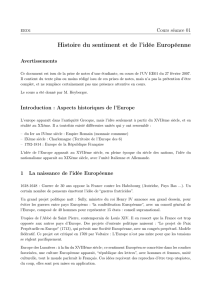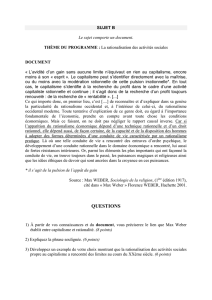Le capitalisme, fils du nationalisme ?

127
Sociétal
N° 39
1er trimestre
2003
1Liah Greenfeld,
The Spirit of
Capitalism :
Nationalism and
Economic Growth,
Cambridge
University Press,
2001, 541 pages,
index.
Cet ouvrage1ambitieux se situe
dans la même lignée et affronte
les mêmes questions que deux livres
célèbres : Les étapes de la croissance
économique de Walt Rostow (1960),
et surtout L’éthique protestante et
l’esprit du capitalisme (1904 et 1920)
de Max Weber. L’auteur, Liah Green-
feld, est spécialiste d’anthropologie
sociale. Professeur de science poli-
tique et de sociologie à l’université
de Boston, elle avait déjà attiré
l’attention du public universitaire
en 1992 en publiant un livre intitulé
Nationalism : Five Roads to Modernity
(Harvard University Press), où
elle analysait la nature et le rôle
du nationalisme dans l’histoire. Le
nationalisme était, selon elle, la
principale force organisatrice de la
vie politique des nations, mais
aussi de tous les aspects de la vie
sociale et économique. En ce sens,
le présent essai s’inscrit dans le
prolongement de la recherche
précédente de l’auteur.
D’entrée de jeu, Liah Greenfeld
prend position contre un pur
déterminisme économique qui
rendrait compte, à lui seul, des
processus de croissance auto-
entretenue. Et réfute à la fois la
démarche des marxistes et celle
des économistes libéraux, qui
expliquent la croissance par le jeu de
la concurrence et des marchés.
Pourquoi fait-elle référence aux
livres de Weber et de Rostow ? Pour
ce qui est de Max Weber, Greenfeld
cherche à attribuer au nationalisme
une partie du rôle que le sociologue
assignait à l’éthique protestante
dans le développement du capita-
lisme. Quant à Rostow, elle récuse
son approche essentiellement des-
criptive et économique. A son avis,
Rostow, comme Weber, envisage
le capitalisme comme un système
caractérisé par sa vocation à la
croissance, mais il n’explique pas
vraiment pourquoi cette croissance
a lieu, car en décrire les étapes ne
suffit pas à en élucider les causes.
Pour Greenfeld, le nationalisme
occupe une place centrale comme
facteur explicatif du développement
des économies capitalistes. Certes,
Rostow n’oublie pas, dans le passage
de la société traditionnelle à la
société moderne, le rôle essentiel
de ce qu’il appelle un « nationalisme
réactionnel », au moins aussi
important, estime-t-il, que la pour-
suite du profit. Il entend par là qu’un
Etat souverain est naturellement
incité à réagir pour défendre les
marchands, engagés dans la concur-
rence internationale, face à l’intru-
sion de nations plus avancées. Aux
yeux de Greenfeld, cependant, c’est
L E S L I V R E S E T L E S I D É E S
Le capitalisme, fils du
nationalisme ?
CLAUDE JESSUA*
La thèse du livre est que le capitalisme, système
caractérisé par une croissance économique auto-
entretenue, n’a pu naître que sur le terreau
du nationalisme, avec l’appui et sous l’impulsion
du pouvoir politique. Cette clé d’explication
permettrait de situer son apparition au XVIIesiècle,
en Angleterre, et de suivre son développement
dans les pays développés jusqu’à nos jours. Une
vision contestable dans la plupart des cas traités
par l’auteur, qui semble s’être laissé aveugler
par son aversion pour la science économique.
The Spirit of Capitalism :
Nationalism and Economic
Growth
par Liah Greenfeld
*Professeur émérite à l’université Panthéon-Assas (Paris II).

128
Sociétal
N° 39
1er trimestre
2003
L E S L I V R E S E T L E S I D É E S
là un élément d’analyse peu
compatible avec le déterminisme
économique que Rostow invoquait
pour expliquer le décollage d’une
société traditionnelle vers une
croissance auto-entretenue : un tel
processus implique, en effet, une
analyse plus fine des motivations des
hommes, et une prise en compte
explicite des institutions.
LA MÉTHODE DE MAX
WEBER, AVEC D’AUTRES
HYPOTHÈSES
Pour notre auteur, le grand
mérite de Max Weber est
justement d’avoir procédé à cette
analyse des motivations. Cepen-
dant, l’intérêt de sa démarche ne
tient pas à la pertinence de ses
vues sur l’influence du protestan-
tisme, mais à sa méthode. Weber
lui-même admettait d’ailleurs
que la domination de l’éthique
protestante dans une culture
n’est une condition ni nécessaire
ni suffisante pour que s’enclenche
un processus de croissance capita-
liste. Sa méthode, en revanche,
impliquait la prise en compte, dans
toute analyse, des motivations
et comportements des hommes
dans l’explication des grands
enchaînements historiques. C’est
cette méthode que Greenfeld
tente d’utiliser, à partir d’une
hypothèse explicative différente.
Elle a, avec Weber, un point de
départ commun : la poursuite de
l’intérêt personnel et du profit ne
peut pas être considérée comme
simplement inhérente à la nature
humaine. En effet, s’il en était ainsi,
le capitalisme reposerait sur de
banales considérations hédonistes,
et aurait existé à toutes les époques
de l’humanité. Pour qu’on puisse
identifier des comportements
typiques du capitalisme, il faut, nous
dit Weber, que les entrepreneurs
s’imposent, sinon une ascèse, du
moins une discipline. Or cette
discipline ne peut être que
transcendante par rapport aux
motivations humaines ordinaires.
C’est en ce sens que l’éthique
protestante fonde des normes
sociales de comportement particu-
lièrement favorables à l’apparition
et à l’expansion du capitalisme,
même si ce n’est pas la seule base
morale concevable ou observable
dans ce domaine.
Weber considère que le capitalisme
a commencé à prendre son aspect
vraiment moderne au XVIIe siècle,
en Angleterre et dans l’Europe du
Nord, au moment où se produisait
dans ces pays une révolution
religieuse qui modifiait l’attitude
dominante à l’égard du travail et
de l’enrichissement personnel. Il
constate que le calvinisme et le
puritanisme anglais étaient devenus
moins hostiles à la poursuite de
l’enrichissement, ce qui constituait
un facteur éminemment favorable
à l’essor du capitalisme. Greenfeld,
qui admet cette thèse, soutient
cependant que l’éthique protes-
tante ne peut pas être le seul
fondement de cette norme sociale
nouvelle : le nationalisme, selon elle,
a joué un rôle important dans cette
rupture, ce qui explique pourquoi la
nation qui a accompli la dém arche
décisive est l’Angleterre, et non
la Hollande, la France, l’Espagne,
l’Al lemagne ou l’Italie, pays au
moins aussi bien placés pour
s’engager dans la conquête éco -
nomique du monde. Ainsi, le
capitalisme moderne commencerait
au XVIIe siècle, et déboucherait
sur la révolution industrielle.
C’est ici que prend place la
définition du nationalisme. Pour
Greenfeld, il revêt trois variantes. Il
y a d’abord le nationalisme individua-
liste-civique, qui constitue la forme
originelle. Elle est liée à l’idée de
nation constituée juridiquement et
au concept de citoyenneté, ce qui
implique une certaine égalité des
membres de cette collectivité, et
donc les premiers fondements
d’une démocratie. Si la nation est
souveraine, cela suppose, en effet,
que les individus qui la composent
sont eux-mêmes libres (ce ne sont
pas des esclaves) et qu’ils sont égaux
devant la loi. L’Angleterre et, par la
suite, les Etats-Unis illustreraient
cette variante du nationalisme.
Ensuite, le nationalisme collectiviste-
civique, qui envisage la nation comme
un être collectif, dont la volonté,
les besoins et les intérêts ne se
confondent pas avec ceux des
individus qui la composent. La
volonté générale ne peut être
perçue que par une élite qui s’est
elle-même désignée comme telle,
et dont les membres estiment
représenter la volonté de la nation.
C’est le cas de toutes les dictatures
modernes, y compris les « démo-
craties » socialistes ou populaires.
Enfin, et c’est la variété la plus
commune, le nationalisme collecti-
viste-ethnique, qui combine la notion
unitaire de la nation avec le concept
ethnique d’appartenance. Plus
précisément, la nationalité est un
critère génétique qui ne peut
provenir que de la naissance, et
ne peut donc être ni acquis ni
perdu. Dans sa forme extrême, ce
type de nationalisme peut aller
jusqu’au racisme ; il renforce le ca-
ractère autoritaire de la conception
collectiviste, la liberté individuelle
disparaît, et la liberté de la nation
s’identifie à son indépendance
par rapport à toute domination
étrangère.Les exemples historiques
les plus significatifs seraient à
chercher du côté de la Russie et
des pays d’Orient.
POURQUOI
L’ANGLETERRE
ÉTAIT EN AVANCE
Greenfeld admet cependant
que cette classification ne
doit pas être comprise de façon
trop rigide, car la réalité présente
des formes hybrides. Pour elle, la
France, par exemple, symboliserait
une combinaison des deux pre-
mières variétés de nationalisme,
ce qui expliquerait le caractère
turbulent de son histoire… Tout
peuple doté d’une identité natio-

129
Sociétal
N° 39
1er trimestre
2003
LE CAPITALISME, FILS DU NATIONALISME ?
nale, quelle que soit la variante
de nationalisme dont il relève,
acquiert un sens de la dignité qui
sera à la base de son sentiment
patriotique et de son engagement
au service de causes nationales.
Et ce sens de la dignité est
pro fondément lié à la croissance
économique. C’est ce que le livre
va s’attacher à démontrer en
croisant les destins économiques
de différents pays.
Le « miracle économique britan-
nique »,événement majeur,se serait
produit à la fin du XVIesiècle et au
début du XVIIe, dans la concurrence
commerciale effrénée qui mit aux
prises les marchands
anglais avec ceux de la
Ligue hanséatique. C’est
à l’occasion de cette
compétition que l’on
vit surgir l’intervention
du pouvoir royal, sous
diverses formes, en
faveur des marchands
anglais, et que l’on vit ces
derniers se comporter
comme des sortes
d’ambassadeurs de leur
pays vis-à-vis des nations
étrangères avec lesquels ils
commerçaient. Greenfeld voit dans
cet épisode l’origine du patriotisme
économique manifeste des Anglais
et le début d’une évolution qui
s’amplifiera tout au long des XVIIIe
et XIXesiècles, consacrant la
prépondérance économique de
l’Angleterre en Europe, en particu-
lier aux dépens de la France.
Le récit des étapes parcourues par
la France, l’Allemagne, la Hollande,
la Russie, le Japon, et enfin les Etats-
Unis au cours de leur développe-
ment fait l’objet d’une succession
de monographies très vivantes,
agrémentées de nombreuses
citations de textes de l’époque.
Au cœur de l’argumentation : la
croissance économique n’est pas
séparable d’une tendance à l’expan-
sion sur les marchés extérieurs,
elle-même fondée sur le double
moteur d’une volonté de conquête,
souvent encouragée par le pouvoir
central, et d’une politique défensive
à l’égard des concurrents étran-
gers. En somme, ce que Greenfeld
décrit n’est autre que le mercanti-
lisme envisagé, soit sous l’angle
de la politique économique des
gouvernements, soit sous celui du
raisonnement économique tel qu’il
apparaît dans les écrits des premiers
économistes. Aucun pays n’aurait
donc pu enclencher un processus
de croissance durable sans avoir bé-
néficié en premier lieu de l’appui ou
de l’impulsion de l’Etat. Les entre-
preneurs prolongeraient, en
quelque sorte, par leur sentiment de
fierté nationale, l’attitude et les aspi-
rations de leur prince.
Le cas de la France sert
à mettre à l’épreuve
l’argumentation. Entre
le colbertisme et le
snobisme social qui tend
à déprécier la condition
des marchands, la France
du XVIIe siècle, et jus-
qu’aux alentours de 1760,
est en retard par rapport
à sa rivale britannique.
Mais, à la veille de la
Révolution, elle avait nettement
rejoint l’Angleterre. En Hollande,
au contraire, à partir du milieu du
XVIIesiècle, l’impulsion nationale
qui avait déterminé la conquête de
l’indépendance a faibli, et les
Hollandais, peuple individualiste et
rationnel, ne manifestent plus
cette dynamique de croissance
qui avait caractérisé l’âge d’or du
pays. L’Allemagne, quant à elle, ne
connaîtra de véritable expansion de
longue durée qu’à partir du milieu
du XIXesiècle, sous l’impulsion de
Friedrich List et de l’éveil de la
nation allemande. C’est le sentiment
national qui, tout au fil du siècle, a
favorisé outre-Rhin une puissante
révolution industrielle et une
expansion sans précédent sur les
marchés extérieurs.
Greenfeld examine ensuite le cas
du Japon et celui des Etats-Unis, qui
lui semblent confirmer de façon
éclatante son hypothèse. Au Japon,
le nationalisme s’enracinait déjà
dans le sentiment, profondément
ancré, d’une supériorité de la
culture nationale face aux étrangers,
considérés comme des barbares.
La révolution Meiji, qui a donné
naissance au Japon moderne, repré-
sentait pour les Nippons l’occasion
de prendre leur revanche sur les
humiliations infligées par l’Occident.
La mentalité japonaise étant loin
d’être inspirée par des valeurs
individualistes, la croissance écono-
mique de ce pays ne repose pas sur
l’action des marchés : elle est le
résultat d’un effort collectif. Aux
Etats-Unis, l’esprit du capitalisme
imprégnait dès le départ la
popu lation, en raison de ses ori-
gines britanniques. Le nationalisme
proprement dit n’a joué de rôle
que sur le plan politique, avec la
conquête de l’indépendance, mais
les colons qui ont fondé cette
nouvelle nation étaient déjà des
capitalistes. Le cas des Etats-Unis
ne semble donc pas renforcer
la thèse de Greenfeld, car il s’agit
d’une croissance économique
auto- entretenue qui s’est déroulée
à l’intérieur des frontières de l’Union,
c’est-à-dire, en fait, à l’échelle d’un
continent.
UN MAUVAIS PROCÈS
À LA SCIENCE
ÉCONOMIQUE
En définitive, que penser de cet
imposant ouvrage ? La thèse
est présentée de façon péremp-
toire, dès l’introduction : « L’esprit
du capitalisme n’est autre que le
nationalisme. Le nationalisme a
été la force éthique motivante que
l’on trouve derrière l’économie
moderne de la croissance ». Pour
l’auteur, en effet, tout le destin
économique d’un pays est décidé à
partir du moment où cette prise
de conscience collective, déclen-
chée ou au moins stimulée par
l’initiative des pouvoirs publics, a
eu lieu. Peu importent ensuite les
révolutions techniques qui inter-
viendront ; l’essentiel se sera déjà
Selon Greenfeld,
les entrepreneurs
prolongeraient,
par leur
sentiment de
fierté nationale,
l’attitude et
les aspirations
de leur prince.

130
Sociétal
N° 39
1er trimestre
2003
L E S L I V R E S E T L E S I D É E S
produit : « Le point important est
que, lorsque la révolution indus-
trielle a commencé, l’économie
britannique était déjà consciem-
ment orientée vers une croissance
auto-entretenue, et elle avait la
capacité de s’y engager ». Autant
dire que, la naissance du capita-
lisme une fois expliquée, ce qui
advient ensuite, n’offre que peu
d’intérêt et peut donc
être abandonné sans
inconvénient à une dis-
cipline mineure comme
l’économie…
Liah Greenfeld, en effet,
ne fait pas mystère
du peu d’estime que
lui inspire la science
économique en général,
et ses développements
contemporains en parti-
culier. Elle l’assimile à
ce que de nombreux
spécialistes américains
des sciences sociales
appellent le « libéralisme
de marché » (market
liberalism). Elle lui re-
proche de reposer sur
une vision fausse et
étriquée des compor -
tements humains, d’un
homo oeconomicus qui n’a jamais
eu de réalité que dans l’imagination
des économistes.
Greenfeld n’est certes pas la
première à exprimer cette critique.
Son argument repose pourtant
sur un contresens sur l’économie.
Celle-ci, en effet, n’est jamais que
l’ensemble des conduites humaines
vues sous un certain angle. Elle n’a
pas d’existence objective : c’est un
certain regard posé sur le monde des
hommes. L’homo oeconomicus signifie
simplement que, pour l’économiste,
l’homme est censé être rationnel
chaque fois que l’obligation de choisir
entre plusieurs partis alternatifs se
présente à lui. Cette hypothèse
est indispensable, car elle seule per-
met de prévoir comment, dans la
plupart des cas, le sujet réagira au
mouvement de telle ou telle variable
économique. Les hommes peuvent
certes être inspirés par leurs pas-
sions ou par leurs émotions ; tout ce
que l’économiste suppose est que,
parmi toutes les motivations qui les
inspirent, les considérations écono-
miques sont présentes ; on saura
dès lors dans quel sens elles agiront.
L’analyse économique n’exclut
donc pas que les hommes puissent
être soumis à d’autres
influences et que, parfois,
celles-ci l’emportent. Les
économistes ne préten-
dent pas livrer les clés de
l’évolution des sociétés.
Depuis Marx, ils n’ont
plus l’ambition d’édifier
une théorie scientifique
de l’histoire. Du coup,
l’accusation de Greenfeld,
qui reproche aux écono-
mistes leur arrogance ou
leur impérialisme, perd
une bonne part de sa
pertinence.
DES QUESTIONS
SANS RÉPONSE
Quant à la partie
positive de sa thèse,
elle n’est pas beaucoup
plus solide. En premier
lieu, elle prend le parti de faire
commencer le capitalisme au
début du XVIIesiècle en Angle-
terre. N’est-ce pas faire bon
marché d’une marche progres-
sive vers le capitalisme, dont les
premiers éléments apparaissent en
Europe dès les XIVeet XVesiècles,
avec la révolution communale et
le développement du commerce
maritime ? L’essor économique qui
a suivi a été le fait de marchands
développant leurs affaires en
fonction de leurs intérêts person-
nels, d’où toute considération
nationaliste était absente. Adam
Smith2a clairement montré, dans
La richesse des nations, comment
cette expansion des marchés a
entraîné une croissance que le
phénomène de la division du tra-
vail a rendu cumulative. Tout cela
était fort étranger à la notion de
nationalisme. Prétendre ensuite
que la Hollande du siècle d’or
n’était pas capitaliste parce que
non nationaliste à l’époque paraît
procéder d’une logique circulaire,
puisqu’on pose en principe que
le capitalisme se confond avec le
nationalisme…
Comment comprendre, à la lecture
de cet ouvrage, que la France du
XVIIIesiècle, avant même la
Révolution française, était déjà
pourvue des institutions les plus
caractéristiques du capitalisme, et
que ses économistes (Cantillon,
Quesnay, Turgot, Condillac) avaient
développé des schémas explicatifs
fondamentalement comparables à
ceux des économistes britanniques ?
La Russie est rapidement exclue du
palmarès de Greenfeld pour la raison
que ses principaux réformateurs,
avant la Révolution de 1917, étaient
d’origine étrangère. C’est oublier
qu’en 1913 elle présentait tous les
signes d’une économie capitaliste,
avec le taux de croissance de la
production le plus élevé d’Europe.
Enfin, constatant que l’Union euro-
péenne n’est pas encore parvenue
jusqu’ici à constituer une nation
malgré ses institutions économiques
et sa monnaie commune, alors que
le sentiment national est encore
très vivant dans les pays qui la
composent, l’auteur en infère que
l’Europe ne pourra pas être considé-
rée comme une véritable puissance
économique. N’y a-t-il donc aucun
lien entre l’essor économique de
pays comme l’Espagne, le Portugal ou
l’Irlande et leur entrée dans la CEE ?
Enfin, peut-on se passer de l’analyse
économique pour mettre au jour des
enchaînements de phénomènes qui
ne seraient saisissables autrement
que par la simple description, sans
espoir d’y déceler des régularités ? Le
livre de Greenfeld est certes vivant,
abondant, enrichi de vastes lectures.
Mais il démontre la stérilité des
querelles interdisciplinaires dans des
domaines où, seule, la coopération
entre disciplines différentes peut
enrichir le débat.l
2Greenfeld va
jusqu’à affirmer
que Smith
n’aurait pas
voulu que son
livre fût
interprété
comme un
ouvrage
d’économie.
C’est au sein de
la sociologie qu’il
aurait trouvé sa
place…
Faire commencer
le capitalisme
au début du
XVIIesiècle
en Angleterre,
c’est oublier
un mouvement
qui apparaît
en Europe dès
les XIVeet XVe
siècles, avec
la révolution
communale et
le développement
du commerce
maritime.
1
/
4
100%