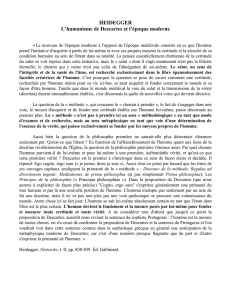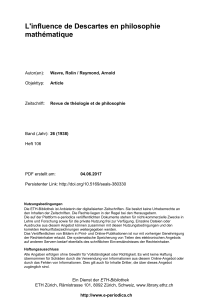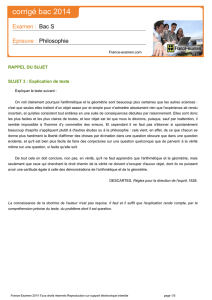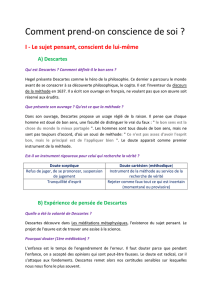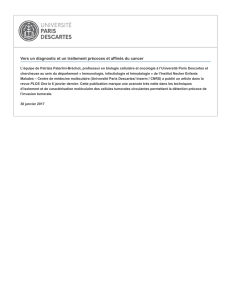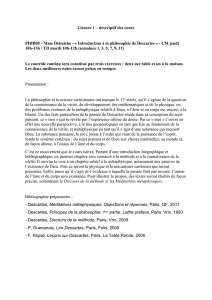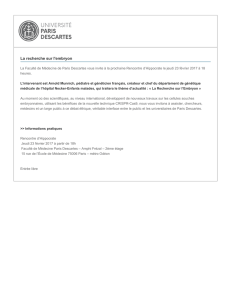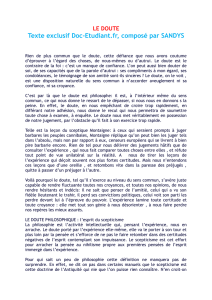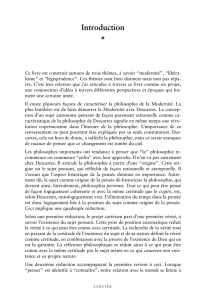De l`évidence cartésienne au probabilisme de Cournot - E

De l'évidence cartésienne au probabilisme de
Cournot : évidence, certitude et probabilité
Autor(en): La Harpe, Jean de
Objekttyp: Article
Zeitschrift: Revue de théologie et de philosophie
Band (Jahr): 26 (1938)
Heft 106
Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-380329
PDF erstellt am: 21.04.2017
Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.
Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.
Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch
http://www.e-periodica.ch

DE L'EVIDENCE CARTÉSIENNE AU PROBABILISME
DE COURNOT :ÉVIDENCE, CERTITUDE ET PROBABILITÉ
Nous omettons volontairement dans cette communication, faute
de place, la nécessaire médiation de Kant entre Descartes et Cournot,
cela soit dit pour prévenir toute objection de traitement arbitraire.
La philosophie cartésienne apour fondement la certitude et l'évi¬
dence ;Cournot opérera, deux siècles plus tard, le total renversement
du problème que se posait Descartes :la certitude de terminus aquo
deviendra terminus ad quern, plus exactement limite extrême de
l'effort rationnel chez Cournot, attitude qui modifiera complètement
la perspective du rationalisme lui-même.
Ces deux philosophies ont leur source commune dans la spéculation
mathématique, ce qui les rend homogènes et par là comparables ;les
sources du mathématisme cartésien sont si connues qu'il suffira de
rappeler, pour mémoire, la Géométrie de 1637. Cournot fut le créa¬
teur de l'économie mathématique (1838), l'un des fondateurs de la
statistique mathématique, le précurseur le plus autorisé qui soit des
théories modernes des groupes et des ensembles. Non seulement les
deux philosophes ont une commune inspiration mathématique, mais ils
ont médité le même problème fondamental des rapports de l'analyse
avec les figures géométriques, l'un en constituant la géométrie ana-
NB. Cette communication, faite àRolle lors de la célébration du tricentenaire
du Discours ie la méthoie, est le développement de celle présentée postérieurement
au Congrès Descartes àParis (Travaux iu IXe congrès international ie Philosophie,
VII, p. 115-21). La deuxième partie (moins la dernière page) n'a été présentée qu'à
la réunion de Rolle.

32 JEAN DE LA HARPE
lytique, l'autre dans le dernier de ses ouvrages mathématiques (1847)
sur L'origine et les limites de la correspondance entre l'algèbre et la
géométrie. Ce qui était vérité implicite chez le premier, devient
vérité explicite chez le second.
Enfin, la théorie de la certitude chez Descartes est aussi éloignée
de se perdre dans un vague psychologisme que la théorie de la pro¬
babilité chez Cournot est étrangère au probabilisme sceptique d'un
Camèade.
I
C'est dans les Régules ad directionem ingenii que nous trouvons les
bases mêmes de la méthode cartésienne et c'est àelles seules que
nous nous référons ici. L'évidence est au regard de Descartes la con¬
dition nécessaire d'une théorie du jugement mathématique et même
du jugement en général, puisque l'intelligence humaine
reste toujours une, toujours la même, si variés que soient les sujets auxquels
elle s'applique, et qui n'en reçoit pas plus de changement que n'en apporte
àla lumière du soleil la variété des objets qu'elle éclaire (Reg. Y).
L'intelligence exactement obéie, libre de toute impatience de la
volonté et du désir, conduit infailliblement àune «connaissance cer¬
taine et évidente », adjectifs qui vont constamment de pair sous sa
plume. Cette méthode d'évidence s'oppose àcelle qui conclut vi
forma, àla façon du syllogisme, et oppose l'acte verbal et automa¬
tique de raisonnement àl'acte même de raison ;Descartes reproche
àla méthode syllogistique de laisser la raison «oisive »et de ne pas
examiner «la déduction elle-même pour en vérifier l'évidence »(Reg.
III). Cette méthode d'évidence élimine également toute référence à
la notion du probable ;Descartes exclut àplusieurs reprises «tou¬
tes les connaissances qui ne sont que probables », posant «en
principe qu'on ne doit se fier qu'à celles qui sont certaines et dont
on ne peut douter» (Reg. III).
Cette méthode d'évidence ne l'amènera pas, comme Leibniz, à
une tentative de «réduction aux identiques », ni de symbolisation
logistique du discours, mais àl'exigence, de la part du philosophe et
du mathématicien, d'un langage qui fournisse àl'esprit une certitude
du type mathématique (Reg. III). Dès lors cette méthode exige,
presque fatalement, le recours àl'intuition qui caractérise l'esprit des
Regula.

DE DESCARTES ACOURNOT 33
M. Lalande, dans son précieux Vocabulaire philosophique, oppose à
juste titre l'apport cartésien àl'apport kantien :l'idée cartésienne
d'intuition est celle «d'évidence, de pleine clarté intellectuelle »;
l'idée kantienne est celle «de présentation concrète, de réalité actuel¬
lement donnée ». On ne peut toutefois exclure de l'intuition carté¬
sienne la notion même de «présentation »qu'elle implique, puisqu'elle
porte sur les «natures simples », c'est-à-dire sur les absolus discrets
et discontinus de l'analyse ;il yaseulement, chez Descartes, prédo¬
minance de la première sur la seconde, la présentation étant aussi bien
concrète qu'abstraite :«D'abord », écrit Descartes, «la manière
dont nous nous servons de nos yeux nous apprend l'usage de
l'intuition »(Reg. IX). Ensuite, lorsqu'il s'agit d'objets pure¬
ment intellectuels, elle devra porter sur des objets si simples et si
peu nombreux
que jamais on ne croie savoir ce dont on n'a pas une intuition aussi claire
que la chose dont on ala connaissance la plus distincte (Reg. IX).
Des termes initiaux l'intuition d'évidence gagnera de proche en
proche les divers termes du raisonnement déductif, devenant ainsi
intuition de «relations »et non plus seulement d'absolus isolés ;ainsi
se constitueront «les longues chaînes de raisons »qui s'achèvent en
enumeration. L'intuition se propage àla façon d'une onde concentri¬
que qui naît du choc initial de ces centres d'évidence que sont les
natures simples et se prolonge jusqu'aux conclusions extrêmes du
raisonnement.
L'intuition n'est pas seulement, chez Descartes, une suite de mou¬
vements discrets qui se propagent, car la déduction, en tant qu'elle
se constitue, participe de l'intuition sans se confondre avec elle, mais
elle est encore un processus inverse de contraction de l'esprit sur
soi-même :la déduction est-elle achevée, elle ne désigne plus que «le
terme d'un mouvement ;c'est pour cela que nous supposons la voir
par intuition quand elle est simple et claire »(Reg. XI). Ainsi la véri¬
fication que comporte tout raisonnement correctement fait consis¬
tera dans l'effort de contraction de tous ses termes en une unique
vue de l'esprit. Descartes va plus loin encore dans sa prétention à
accroître le dynamisme de la raison, puisqu'il exige de l'énuméra-
tion elle-même qu'elle puisse se condenser en un acte unique de l'in¬
telligence, s'agissant de la chaîne parcourue du premier terme au
dernier suivant tous les intermédiaires :
RIV. DE THÉOL. ET PHIL. N. S. t. XXVI (n° Io6, I938). 3

34 JEAN DE LA HARPE
jusqu'à ce que je passe du premier au dernier (terme) assez rapidement
pour paraître, presque sans le secours de la mémoire, en embrasser toute la
suite d'une seule intuition (Reg. XI).
Ainsi l'intuition comporte des moments différents :choc initial de
l'évidence première, rattachement àcelle-ci des termes successifs,
puis acte de retournement sur soi-même et synthèse du multiple dé¬
ductif ou inductif dans l'acte unique d'intuition synthétique.
On conçoit dès lors qu'évidence et certitude se confondent dans
l'unité d'une pensée àdouble face impliquant la certitude du côté du
sujet et l'évidence du côté de l'objet, pensée que nul autre que Des¬
cartes n'avait jusqu'alors aussi profondément creusée. La certitude-
évidence sera donc àla fois transparence complète de l'objet àl'esprit
et adéquation parfaite de l'esprit àson objet. Il yaura si complète
réciprocité des deux termes que le problème psychologique de la cer¬
titude ne se posera même pas ;cette réciprocité de l'évidence et de la
certitude constitue le fondement même du rationalisme carté¬
sien, type par excellence d'un rationalisme catégorique que rien ne
limite du dedans.
Avec Cournot le paysage philosophique change. Nous nous référons
aux quelques pages que celui-ci consacre àDescartes dans ses Consi¬
dérations*1'), pages serrées et pleines de contenu. La critique de Des¬
cartes par Cournot nous servira de transition entre la méthode d'évi¬
dence et celle de probabilité. Descartes avoulu, aux yeux de Cournot,
franchir l'étape nécessaire du doute pour atteindre àla pleine certi¬
tude de telle sorte que «de la solidité des fondations résulte néces¬
sairement celle de la construction tout entière» (p. 258). Ces fonda¬
tions, ce sont précisément les idées claires et distinctes que Descartes
subordonne au contrôle d'une garantie divine; et Cournot de citer,
dans le texte, un passage de la quatrième partie du Discours de la
Méthode dont il souligne quelques passages sur lesquels porteront ses
critiques fondamentales.
1. Descartes établit entre les idées confuses et obscures et le
néant (d'intelligence) une relation de participation que Cournot tient
pour fort obscure, la plupart de ces confusions s'expliquant par des
«causes perturbatrices »foncièrement positives.
(*) Consilérations sur la marche les ilêes et les événements Ians les temps molernes.
Réédition, Paris, Boivin, 1934. Tome I, p. 258-265.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
1
/
20
100%