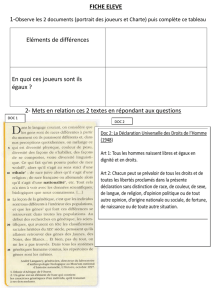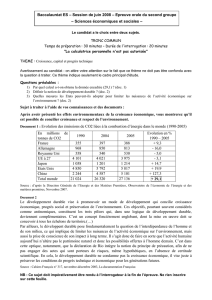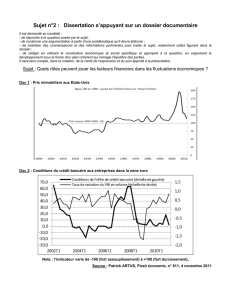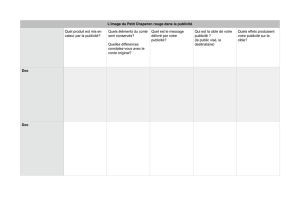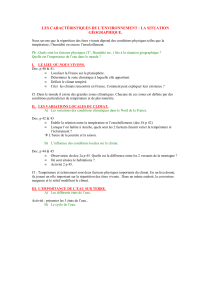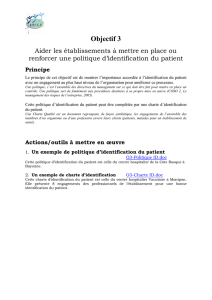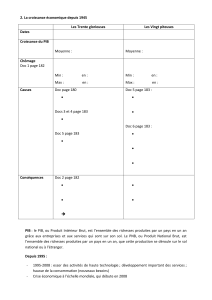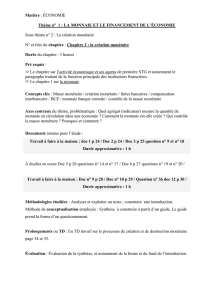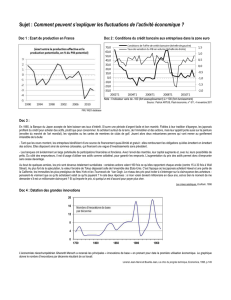Sciences économiques et sociales, 1re ES, livre du professeur

Sous la direction de
Jean-Paul Lebel et Adeline Richet
Laurence Bénaïm
Carole Bernier
Céline Cravatte
Sarah Daubin
Daniel Didier
Stany Grelet
Laurent Le Guen
Alain Nabat
Françoise Rault
Philippe Watrelot
Professeurs de sciences
économiques et sociales
sciences
économiques
sociales
&
1
Sous la direction de
J.-P. LEBEL et A. RICHET
COLLECTION
re
ES

2
SOMMAIRE
Les grandes questions des économistes 3
La production dans l’entreprise 13
Marché et concurrence 24
Les limites du marché 35
La monnaie et le financement 42
Le rôle économique des pouvoirs publics 54
Les politiques conjonctuelles 65
Introduction à la sociologie 77
Socialisation(s) et identités sociales 81
Groupes et réseaux sociaux 90
Contrôle et déviance 98
Ordre politique et légitimation 106
Entreprise, institution et organisation 119
Action publique et régulation sociale 127
Fiches Outils 142
1. Calculs de proportions et de pourcentages de répartition 142
2. Moyenne, moyenne pondérée, médiane 143
3. Lecture et analyse de graphiques 144
4. Le calcul des variations 145
5. Les tableaux à double entrée 145
6. Déflater (distinguer valeur/volume) 146
7. Les élasticités 146

3
CHAPITRE 1 • Les grandes questions des économistes
CHAPITRE
La première partie du programme invite à présenter quelques
grandes interrogations centrales en économie. Les cinq grandes
questions posées par le programme portent sur la rareté, la spé-
cialisation des activités, la production des richesses, la répar-
tition des richesses et sur les grands équilibres macroécono-
miques. Elles sont regroupées ici en trois grandes parties.
Comment les économistes
répondent-ils aux grandes questions
qu’ils se posent? (p. 12-13)
La rareté se fait-elle sentir par tout le monde
de la même façon?
La rareté est une question centrale en économie. Elle peut être
dénie comme l’utilité d’une chose qui vient à manquer. Sont
dits économiques des biens rares qui n’existent donc pas en
quantité illimitée et qui répondent à un besoin.
Les deux images permettent de sensibiliser les élèves avec la
notion de rareté, à partir d’un phénomène qu’ils connaissent:
celui de la rareté de l’eau (programme de 2nde de géographie).
L’eau est une ressource limitée dont la rareté ne se fait pas
sentir par tous de la même façon. Au gâchis dans les sociétés
modernes, on peut opposer la très grande insusance (ou l’in-
salubrité) dans nombre de pays en développement. Cette res-
source naturelle est longtemps apparue comme « illimitée »,
d’où son gaspillage. Mais on sait aujourd’hui que c’est un bien
rare donc précieux (à l’origine, d’ailleurs, de nombreuses guerres
et conits dans le monde pour son contrôle).
Pourquoi les boulangeries existent-elles alors qu’il est
assez aisé de faire du pain soi-même?
Une question très ancienne des sciences économiques est celle
de la division des tâches et de la spécialisation des individus, qui
peut se résumer de la façon suivante: «Faut-il mieux faire soi-
même ou faire faire par des individus spécialisés?» On retrouve
dans ce questionnement, cher à Adam Smith, le principe de la
division sociale du travail. Il est, en eet, aisé de faire son pain,
mais la division sociale des tâches nous enseigne qu’il est encore
plus ecace et se spécialiser dans une seule activité et de faire
appel aux autres pour satisfaire ses besoins. Les deux images
permettent de sensibiliser les élèves à cette notion de spécialisa-
tion des individus. Elles permettent aussi de s’interroger sur la
façon dont les individus font des arbitrages. Faut-il mieux être
femme au foyer et faire soi-même son pain, ou être une femme
active et avoir recours au service du boulanger pour se nourrir?
D’où viennent les richesses produites?
Les deux images doivent permettre aux élèves de rappeler que
pour produire des richesses, il faut des facteurs de produc-
tion (du travail et du capital) et que c’est la combinaison de
ces facteurs, dans la sphère réelle, qui va être à l’origine de la
création de biens et services nouveaux, et donc de richesses
supplémentaires. Les richesses sont donc le résultat de l’activité
de production.
1. Comment faire des choix
lorsque les ressources
sont limitées? (p. 14-17)
Il s’agit ici de s’interroger sur la façon dont les individus font des
choix, alors qu’ils sont contraints par la rareté des ressources.
Dans la première sous-partie (A), on s’interrogera donc sur ce
qu’est l’utilité pour les économistes et sur la façon de satisfaire
les besoins. La subjectivité des goûts des individus n’empêche
pas les économistes de les étudier. On présentera également la
notion d’utilité marginale, qui permet de comprendre comment
se xe la valeur des biens. Dans la seconde sous-partie (B), il
s’agit de montrer aux élèves que le consommateur est contraint
dans ses choix, en particulier par le prix des biens et par ses
revenus. Il doit donc, en permanence, eectuer des arbitrages
pour consommer (contrainte budgétaire, temps…).
Pour commencer
Il s’agit ici de sensibiliser les élèves à la question de la rareté et
à la subjectivité des goûts. Plusieurs paniers sont proposés aux
élèves. Il s’agit ensuite de voir dans quelle proportion chaque
panier a été choisi, à l’aide du tableau ci-dessous, ce qui permet
ensuite de lancer une discussion sur la façon de faire des choix
(en fonction des goûts, par exemple) et les contraintes exis-
tantes (en fonction des prix, par exemple).
2. Paniers 1 2 2 4
Répartition % % % %
3. Les choix dièrent en fonction des goûts, des besoins des
élèves, du prix des biens et services…
A. Les goûts et les couleurs, ça se discute? (p. 14-15)
Doc. 1 • Manger bio ou pas?
1. Les fruits et légumes achetés sur les marchés ou en magasins
sont 68% plus chers en moyenne, selon l’association Famille
rurales. Et selon Que Choisir, un panier bio acheté en grande sur-
face est, en moyenne, plus cher de 22% qu’un panier équivalent
non bio.
2. Le prix plus élevé du bio n’empêche pas la croissance de la
lière bio. En eet, les achats de produits bio ont progressé de
19% en volume, entre 2008 et 2009, et de nouvelles fermes se
lancent sans cesse dans le bio (3000 en 2010).
3. Les prix des produits bio sont sensiblement plus élevés que
les produits non bio, mais il est également possible de réaliser
des repas bio à des prix raisonnables. Certains menus de cantine
100% bio reviennent à 2,9€ par personne. Il s’agit ici d’arbi-
trer entre diérents types de protéines, puisque les protéines
carnées sont beaucoup plus chères que des protéines d’origine
végétale.
Les grandes questions
des économistes
1

4
CHAPITRE 1 • Les grandes questions des économistes
4. Plusieurs explications peuvent être évoquées. Manger bio est
considéré comme meilleur pour la santé. Cela permet de pré-
server l’environnement. C’est bien souvent également un acte
militant. Le texte explique ainsi que certains consommateurs
sont attirés par le bio dans un «souci éthique et écologique».
Enn manger bio peut être un signe de distinction sociale; les
produits bio peuvent être considérés comme «un luxe réservé
aux “bobos”».
Doc. 2 • Qu’est-ce que l’utilité en économie?
1. Pour les économistes, est utile ce qui est capable de satisfaire
un besoin.
2. Vous pouvez considérer qu’un scooter serait très utile pour
vos déplacements, contrairement à vos parents qui le jugent
inutile, onéreux, voire dangereux.
3. Les économistes ne distinguent pas les diérents types de
besoins. Il existe donc des limites à la notion d’utilité, puisque
même les produits néfastes à la santé de l’homme peuvent ainsi
être considérés comme «utiles» par les économistes, s’il s’agit
de satisfaire un besoin. Par exemple, l’alcool, la drogue et les
cigarettes.
Doc. 3 • Qu’est-ce que la rareté?
1. Le maïs est une denrée alimentaire de base pour de nom-
breuses personnes, mais il est également le composant essen-
tiel d’une nouvelle forme de carburant, l’éthanol. Le maïs est
une ressource rare, ce qui fait dire au conducteur (cynique) de
la voiture que des arbitrages sont désormais nécessaires entre
«nourrir la population» (en particulier les plus pauvres, dont
les céréales constituent la nourriture de base) et «faire rouler les
voitures» (essentiellement dans les pays riches).
2. Les ressources, comme les produits céréaliers, ne sont pas
illimitées. Leur consommation par les uns peut en diminuer la
consommation pour les autres.
3. Les risques sont que désormais les céréales ne soient pro-
duites que dans le but de produire des énergies renouvelables,
principalement utilisées dans les pays riches, au détriment de la
survie des populations des pays en développement. Par ailleurs,
la forte demande de produits céréaliers par les pays riches, asso-
ciée à des phénomènes de spéculation, entraîne une hausse
considérable des cours empêchant les plus pauvres de se nourrir.
4. Il existe d’autres ressources rares, telles que l’eau (pour les
consommateurs et les producteurs), le pétrole (la production de
produits plastiques), l’étain et l’or (la production de téléphones
portables)…
Doc. 4 • Une satisfaction inépuisable?
1. L’utilité marginale est la satisfaction individuelle procurée par
la dernière unité consommée d’un bien ou d’un service. En eet,
la satisfaction n’est pas la même selon les quantités de biens
consommées. Il peut exister une forme de «lassitude», voire
d’insatisfaction lorsque les quantités consommées augmentent.
2. Le premier verre d’eau permet d’étancher en grande partie la
soif et procure une satisfaction directe très importante. Le deu-
xième verre procurera certainement un supplément de satisfac-
tion, si la soif est très importante. Mais rapidement la soif dis-
paraît, et un troisième ou un quatrième verre n’apporteront pas
de satisfaction supplémentaire. Le quatrième verre aura donc
moins de valeur que le premier. On dit alors que l’utilité margi-
nale est décroissante avec la quantité consommée.
3. La paradoxe de l’eau et du diamant peut s’énoncer de la façon
suivante. Le diamant n’est pas très utile en soi (voire inutile)
mais il est très rare, ce qui lui donne une grande valeur. Son uti-
lité marginale est très élevée. À l’inverse, l’eau est très utile pour
la survie des individus, mais sa relative abondance fait que son
utilité marginale est quasi nulle. Un verre d’eau supplémentaire
n’apporte pas de satisfaction supplémentaire; il ne vaut donc
rien alors que le diamant lui coûte très cher.
4. C’est l’utilité marginale qui détermine les valeurs mar-
chandes; ainsi le diamant est très cher et l’eau peu chère.
Faire le point
1. 6 bouteilles de lait à 1,25€ coûtent 7,5€. Il reste donc 42,5€
pour acheter d’autres biens.
Le prix du lait augmente de 0,6€, c’est-à-dire qu’une bouteille
coûte 1,85€. Les 6bouteilles utiles pour la consommation heb-
domadaire coûtent désormais 11,1€; il reste donc 38,9€ pour
acheter d’autres biens.
Si on souhaite maintenir constante la consommation des autres
biens, c’est-à-dire acheter des biens pour un montant équiva-
lent à 42,5€, il faut diminuer la consommation de lait et n’ache-
ter que 4,05 bouteilles (7,5€ divisés par le prix d’une bouteille
1,85€).
Le consommateur dispose d’un budget limité pour sa consom-
mation; il est donc contraint de faire des choix. Un des éléments
déterminants à prendre en compte est le prix des biens. Lorsque
le prix d’un bien augmente, le consommateur doit faire des arbi-
trages. Soit il maintient constante la consommation du bien
dont le prix augmente et diminue la consommation des autres
biens, soit il baisse la consommation du bien qui vient de voir
son prix augmenter pour maintenir constante la consommation
des autres biens.
2. L’intérêt de mesurer l’utilité marginale est de donner une
valeur marchande, c’est-à-dire un prix, aux biens et services. En
eet, certains biens ont une très faible utilité, comme le dia-
mant, mais leur rareté leur donne une grande valeur. L’utilité
marginale correspond à l’utilité de la dernière unité consommée,
celle du diamant est alors très élevée. À l’inverse, l’eau, qui est
d’une grande utilité, a peu de valeur quand elle existe en abon-
dance. Les besoins en eau sont vite satisfaits et une unité d’eau
supplémentaire n’apporte pas de satisfaction supplémentaire.
B. Comment le consommateur arme-t-il
ses préférences fait-il ses choix? (p. 16-17)
Doc. 1 • Évolution annuelle de l’indice des prix
à la consommation et du salaire mensuel
de base (en %)
1. En 2009, le salaire mensuel de base a augmenté de 3%, alors
que l’indice des prix à la consommation a augmenté de 0,75%.
2. Le salaire mensuel n’a pas baissé entre décembre 2007 et
décembre 2010. Il s’agit ici d’une variation en pourcentage
(mesurée avec un taux de variation). La hausse du salaire men-
suel a été de moins en moins forte, mais elle reste positive sur
l’ensemble de la période (taux de variation toujours positif).
3. Le pouvoir d’achat, qui mesure la quantité de biens et services
qu’un revenu permet d’acquérir, a progressé entre début 2008
et n 2010. Cela s’explique par une progression plus rapide du
salaire mensuel de base que celle des prix à la consommation.
Les prix ont même connu une légère baisse pendant quelques
mois (taux de variation négatif) en 2009.
Doc. 2 • Consommation et prix relatif du tabac
1. En 2009, la consommation de tabac en France s’élevait à
3grammes par jour et par adulte de 15ans ou plus. L’indice de
prix relatif du tabac était quant à lui égal à 225, base 100 en
1970, soit une augmentation du prix relatif du tabac de 115%
depuis 1970.
2. Depuis 1971, la consommation de tabac (en grammes par
adulte de 15ans ou plus) a été divisée par 2,23, alors que dans le
même temps son prix relatif a été multiplié par 2,44.
3. Ce graphique met en évidence une corrélation de sens inverse
entre la consommation de tabac et son prix relatif. En eet,
on constate que plus le prix relatif du tabac augmente, plus sa

5
CHAPITRE 1 • Les grandes questions des économistes
consommation diminue. On peut dire que la consommation de
tabac est sensible au prix (bien élastique). Il s’agit d’un argu-
ment essentiel pour tous ceux qui luttent contre la consomma-
tion de tabac.
4. Les eets néfastes sur la santé, les conséquences d’une mau-
vaise hygiène de vie, des campagnes de prévention… peuvent
inuencer la consommation de tabac.
Doc. 3 • Qu’est-ce que la contrainte budgétaire?
1. Le consommateur dispose d’un budget de 3 000 € et doit
faire des arbitrages. Il doit choisir entre une certaine quantité
d’aliments et de biens d’équipement. Sachant qu’une unité d’ali-
ments coûte 40 €, il peut en acheter 75 ; il ne lui reste alors
plus de budget disponible pour acheter des biens d’équipement
(biens d’équipement = 0). Il peut aussi décider de ne pas ache-
ter de nourriture du tout et dépenser tout son budget dans les
biens d’équipement; il pourra alors acheter 15unités de biens
d’équipement à 200€.
2. Sur la droite de budget, chaque point correspond à des asso-
ciations diérentes d’unités d’aliments et d’unités de biens
d’équipement. Il s’agit de l’ensemble des paniers de consom-
mation possibles avec un budget égal à 3000€. Le point A par
exemple correspond à un panier composé de 50 unités d’ali-
ments (à 40€) et 5unités de biens d’équipement (à 200€).
3. Lorsqu’une unité d’aliments passe à 45€, 15unités coûtent
désormais 675€. Il ne reste plus que 2325€ pour acheter des
biens d’équipement. Sachant que le prix des biens d’équipement
est inchangé (200€), le consommateur ne peut désormais plus
qu’en acheter 11,6. On assiste à un «pivotement» de la droite de
budget autour du point correspondant aux aliments.
4. Si le budget du consommateur passe à 3520€, la droite de
budget se déplace «vers le haut». Soit parallèlement si le rap-
port aliments/biens d’équipement reste le même, soit de façon
non parallèle si ce rapport se modie. Exemple: avec un bud-
get de 3520€, on peut obtenir 18unités d’aliments à 40€ et
14unités de biens d’équipement à 200€.
Doc. 4 • Comment les économistes raisonnent-ils?
1. Les éléments observables et mesurables permettant d’expli-
quer la baisse de la consommation de tomates de M. Dupont
sont, par exemple, la hausse du prix des tomates, la détériora-
tion de la qualité ou du rapport qualité/prix.
2. Les économistes raisonnent à partir d’hypothèses vériables
et réfutables. Ils ne peuvent pas prendre en compte des déci-
sions subjectives dictées par les goûts des consommateurs,
comme par exemple ne plus aimer le goût des tomates (cette
hypothèse ne peut pas être réfutée). Si la consommation de
tomates baisse, les économistes vont chercher à l’expliquer en
considérant que M. Dupont aime toujours autant les tomates.
Ils n’ont pas d’autres choix. Ils raisonnent «toutes choses égales
par ailleurs».
3. La démarche des économistes est une démarche scientique
qui s’appuie sur des variables «extérieures» à l’individu, mesu-
rables et observables. L’économiste met en avant des hypo-
thèses pour expliquer les comportements des consommateurs,
et il vérie la validité de ses hypothèses. Les hypothèses sont
forcément réfutables, c’est-à-dire qu’elles peuvent faire l’objet
d’une vérication.
Faire le point
1. Les déterminants économiques du choix des consommateurs
sont principalement les revenus et les prix des biens, ce que per-
met de prendre en compte la contrainte budgétaire. Le consom-
mateur est contraint de faire des arbitrages, car ses revenus
sont limités. Il a plusieurs façons de composer son panier de
consommation en fonction de son revenu.
Un autre déterminant qui peut être pris en compte est le temps
dont dispose le consommateur. Possibilité d’évoquer avec les
élèves le «prix du temps». Exemple: le cadre supérieur a-t-il
intérêt à moins travailler pour s’occuper de sa maison, ou bien
à embaucher une femme de ménage pour faire le travail à sa
place?
2. Les économistes ne font que des hypothèses qui peuvent faire
l’objet de vérications pour expliquer les comportements des
consommateurs. Si les hypothèses sont réfutées, il faut alors en
trouver d’autres pour expliquer les comportements.
2. Pourquoi acheter à d’autres
ce que l’on peut faire soi-même? (p. 18-21)
Le programme propose dans cette partie de s’intéresser à la
spécialisation des individus et des nations, ainsi qu’à l’échange
qui en résulte. Il convient de montrer que l’échange permet de
mettre à prot les diérences entre individus et nations. On
montrera alors que les individus font des arbitrages permanents
entre «faire» soi-même ou «faire faire». On montrera égale-
ment que la division du travail entre les pays permet une spécia-
lisation, en fonction de divers avantages, et que les pays échan-
gent ensuite. Le développement des échanges s’explique par les
avantages qui en découlent, comme une diversité des produits
proposés, une amélioration de la compétitivité…
Pour commencer
1. L’industrie française est fortement spécialisée dans l’agroali-
mentaire et l’aéronautique. On constate aussi une spécialisation
dans les domaines comme la chimie, les produits pharmaceu-
tiques, le textile, le travail des métaux, les trains… Par contre,
l’industrie française est absente de certains secteurs, comme
l’énergie et l’informatique.
2. La France possède un savoir-faire et de la main-d’œuvre
qualiée dans ce domaine. C’est aussi le résultat de politiques
publiques mises en œuvre pour développer la recherche-déve-
loppement, l’innovation dans ce secteur.
3. La provenance probable, parmi les pays proposés dans ce
tableau, est le Japon qui est spécialisé dans ce domaine.
A. «Faire » ou « faire faire»? (p. 00)
Doc. 1 • Comment choisir entre «préparation maison»
et «plats tout prêts»?
1. Une soupe préparée à la maison coûte 0,85€, alors que dans le
commerce la même soupe coûtera 1,87€, soit un surcoût de 120%.
Un sandwich fait maison coûte 2€ à fabriquer. Si le consomma-
teur décide d’en acheter un tout prêt dans le commerce, il paiera
un surcoût de 50%, c’est-à-dire que le sandwich lui reviendra à 3€.
2. Quel que soit le plat, il revient toujours moins cher de la
préparer soi-même à la maison que de l’acheter tout prêt dans
le commerce. Le surcoût peut aller de 15 %, pour un hachis
Parmentier, à 180%, pour un rôti de dinde avec des légumes. Il
apparaît alors plus rationnel pour le consommateur de «faire»
que de «faire faire».
3. Le surcoût des plats préparés s’explique en grande partie par
la marge qui revient aux producteurs de ces plats tout prêts. En
eet, si les producteurs ne réalisent aucune marge (prot), il y a
peu de chance qu’ils fabriquent ces plats tout prêts. Il s’explique
aussi par les coûts de fabrication, de distribution, de commer-
cialisation de ces produits.
Doc. 2 • Faire ou «faire faire»pour les femmes?
1. « […] travail et famille sont deux activités en concurrence
l’une avec l’autre». «Le temps domestique est, en quantité, très
lourd, puisqu’il constitue pour la moyenne des femmes le deu-
xième temps, devant le temps de travail et de formation.»
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
1
/
146
100%