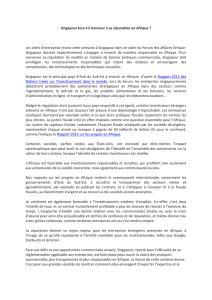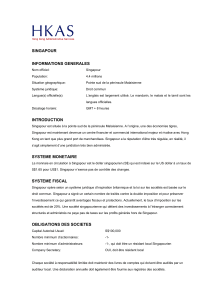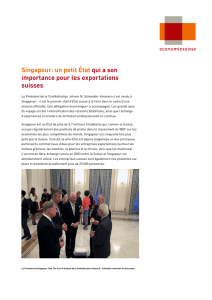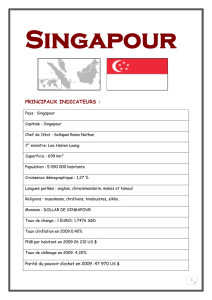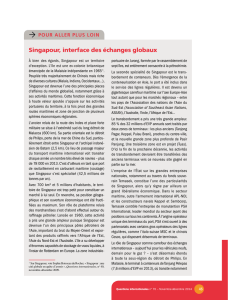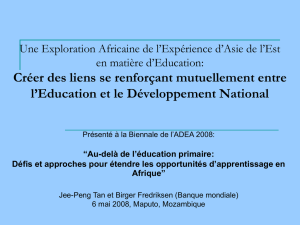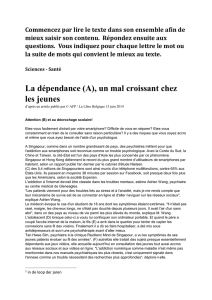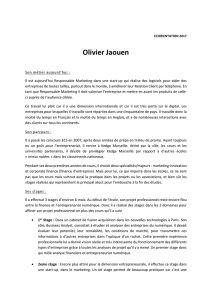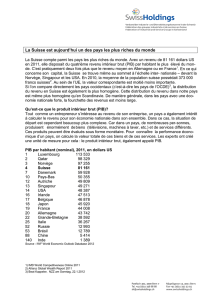Modèle d`en-tête - Français - Direction Générale du Trésor

Ambassade de France
101-103 Cluny Park Road
259595 Singapour
Tél. : +65 6880 7878 - http://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/singapour
AMBASSADE DE FRANCE A SINGAPOUR
SERVICE ÉCONOMIQUE REGIONAL DE SINGAPOUR
Le Chef du Service économique régional de l’ASEAN A Singapour, le 17 février 2017
NOTE
Rédigée par : Jérôme Olympie, Eric Paridimal (Chancellerie)
Revue par : Antoine Chéry, Jérôme Destombes
Objet : Les conclusions consensuelles du Comité sur l’économie du futur de Singapour
Après un an de travaux et de consultations tous azimuts, le Comité sur l’économie du futur (Committee on the
Future Economy – CFE) vient de présenter son rapport dans lequel sont exposées sept grandes mesures, se
déclinant en 22 recommandations, visant à assurer à Singapour une croissance économique durable de 2-3%
par an en moyenne sur les 10 prochaines années.
Mis en place par le Premier ministre en décembre 2015 dans un contexte de ralentissement structurel de la
croissance, caractéristique d’une économie arrivée à maturité, le CFE appelle Singapour à renforcer son
aptitude à diffuser de nouvelles connaissances par l’éducation et la formation et à en faire usage pour
renforcer les capacités technologiques des entreprises et développer un environnement urbain innovant et
connecté. Davantage qu’un remède miracle visant à une relance immédiate de la croissance, le CFE
concentre donc ses recommandations sur des orientations stratégiques et structurelles de long terme.
Si cet exercice était nécessaire, il présente néanmoins un certain nombre de limites que les commentateurs
n’ont pas manqué d’identifier. En particulier, le développement d’une économie fondée sur l’innovation
pourrait exiger des changements plus structurels et profonds que ceux préconisés par le rapport. Ce dernier
fournit néanmoins un aperçu utile des priorités stratégiques de Singapour, auxquelles la France devrait être
en mesure d’apporter sa contribution.
1. Le Comité sur l’économie du futur : répondre aux futurs défis socio-économiques
A la suite de sa réélection, en octobre 2015, le Premier ministre Lee Hsien Loong a lancé une large
consultation sur l’avenir économique de la cité-Etat. En décembre 2015, il a créé le Comité sur l’économie
du futur (Committee on the Future Economy, CFE), rassemblant des représentants des principaux ministères et
agences de l’Etat, ainsi que du secteur privé. Si les circonstances entourant la création de ce Comité sont
différentes de celles des précédents exercices de prospective (la cité-Etat étant désormais une économie
mature et ne traversant pas d’épisode de récession), son mandat reste identique : explorer les pistes pertinentes
qui assurent à Singapour une croissance durable lui permettant de satisfaire les différents besoins émanant de
son double statut de ville et d’Etat.
L’objectif principal du Comité est d’assurer à Singapour une croissance économique durable de 2
à 3% par an en moyenne sur les 10 prochaines années. A cette fin, le CFE a présenté sept axes stratégiques
clefs, se déclinant en 22 recommandations, résumées ici en trois grands axes :
a) Permettre à Singapour de trouver sa place dans un environnement technologique en constante
mutation.
L’objectif de croissance durable présenté par le CFE apparaît fortement tributaire des progrès de
la connaissance et de ses applications pour relever les défis auxquels la société singapourienne est
confrontée (vieillissement de la population, faible productivité, etc.). Ainsi, le rapport appelle les autorités à
prendre des mesures en vue de renforcer le niveau de qualification de l’ensemble de la population active. Pour
ce faire, le Comité recommande de s’appuyer sur l’initiative SkillsFuture, initiée fin 2014, qui donne accès à
une formation tout au long de la vie et permet d’acquérir de nouvelles compétences adaptées aux besoins du
marché de l’emploi. Parmi les mesures proposées, le Comité encourage le gouvernement à créer un site
internet qui fonctionnerait comme un portail unique permettant aux Singapouriens d’accéder à toute
l’information disponible concernant leurs possibilités de formations (académique et professionnelle) et offrant
en parallèle des solutions d’orientation professionnelle. Le développement de modules d’enseignements
utilisant les technologies de communication et d’information est également encouragé. De plus, le Comité
appelle les autorités à renforcer le lien existant entre l’acquisition et l’utilisation des compétences via le
développement de programmes de formation en alternance et d’offres de formations internes (i.e. réalisées

Ambassade de France à Singapour - Service économique régional de Singapour
directement par les entreprises) pour éviter aux travailleurs les plus âgés de perdre leur emploi. Ces
recommandations concernent notamment les sociétés de conseil en ingénierie, les cabinets juridiques et les
institutions financières. Le CFE encourage aussi les étudiants à participer à des programmes d’échange à
l’étranger pour développer leur compréhension de la région, les spécificités des différents marchés et leurs
compétences à l’étranger.
En parallèle, plusieurs recommandations visent à renforcer les capacités (technologiques et
financières) des entreprises locales. Selon le Comité, il est essentiel de stimuler l’investissement privé pour
accroître la valeur technologique de l’industrie afin d’assurer la compétitivité des entreprises locales. Cet
objectif doit passer par le soutien aux PME innovantes (notamment en matière d’exploitation des données, de
renforcement des outils de cyber sécurité, de parrainage avec des grands groupes et d’élaboration de stratégies
sur mesure pour le développement de chaque industrie) et le financement de l’innovation technologique par le
capital-risque. Ces initiatives de soutien et de développement industriel sont incluses dans des plans de
transformation de l’industrie (Industry Transformation Maps, ITM) spécifiques et adaptés à chaque secteur, en
lieu et place des orientations globales jusqu’à présent privilégiées. De façon générale, le rapport a une
approche beaucoup plus microéconomique que les précédents qui traitaient surtout des questions affectant
l’ensemble de l’économie, telles que le coût du travail, la fiscalité, ou encore la dépendance à la main d’œuvre
étrangère.
Le Comité appelle les autorités à assurer un environnement réglementaire propice à la prise de
risque, qui stimulerait l’innovation. Les organisations professionnelles et Chambres de commerce et de
métiers devraient jouer un rôle plus important de soutien au secteur privé. Les autorités devront quant à elles
développer des cadres réglementaires suffisamment incitatifs pour favoriser l’émergence de véritables champs
d’expérimentation des innovations en vue de leur possible valorisation et généralisation. Le Comité appelle
également le gouvernement à s’engager dans un effort de rationalisation de ses divers régimes d’aide et de
révision de son régime fiscal.
b) Résister à la recrudescence du protectionnisme en approfondissant et diversifiant les relations
économiques, commerciales et technologiques
Le Comité reconnaît que le modèle de croissance du pays reste basé sur les exportations et
l’ouverture au monde extérieur : il appelle les autorités à résister face à la recrudescence du
protectionnisme. Le rapport insiste donc sur la nécessité de favoriser la libéralisation des échanges et des
investissements et mentionne en ce sens l’implication de la cité-Etat au sein du Regional Comprehensive
Economic Partnership. Le Comité appelle les autorités à profiter de la présidence de l’ASEAN, que Singapour
assurera en 2018, pour faire avancer les questions de réduction des droits de douane et des barrières non
tarifaires dans la région.
Le Comité encourage le développement de systèmes de coopération entre universités, industrie,
centres de recherche et pouvoirs publics tant sur le territoire qu'avec le reste du monde, en vue
d’établir une Alliance mondiale pour l’innovation (Global Innovation Alliance - GIA) qui servirait de base
à la création d’accélérateurs et d’incubateurs de startups et encouragerait les entrepreneurs et leurs partenaires
à effectuer des voyages d’affaires réguliers à l’étranger. Ainsi, ils auraient un meilleur aperçu des
opportunités, enjeux et débouchés commerciaux sur les marchés étrangers.
c) Faire de Singapour une ville globale, dynamique et connectée, source d’opportunités
Le rapport insiste sur la nécessité de développer une ville connectée visant à attirer et provoquer de
nouvelles opportunités. Le Comité encourage ainsi les entreprises à partager des bureaux afin de favoriser le
transfert d’idées et réaliser des économies d’échelles (notamment lorsqu’il s’agit d’investir dans de nouvelles
infrastructures). Les politiques d’investissement dans les infrastructures de transport (aéroport de Changi et
port de Tuas) sont encouragées
1
.
Des travaux d’aménagement du territoire d’envergure pourraient être envisagés, le rapport faisant
mention de l’intérêt de former un plan directeur pour le développement des infrastructures souterraines. Le
Comité appelle également à une meilleure utilisation des terrains industriels (plan de rajeunissement de la
ville, amélioration de la planification des espaces etc.). Il souhaite également améliorer la diversité des
1
Le projet de ligne ferroviaire à grande vitesse entre Singapour et Kuala Lumpur est mentionné comme porteur de nombreux
avantages pour les deux pays.

Ambassade de France à Singapour - Service économique régional de Singapour
emplacements commerciaux, en assignant de nouveaux emplacements aux sièges d’entreprises et de nouvelles
industries, et offrir des espaces d'incubation pour les startups, les PME et les industries créatives. Le Comité a
aussi réfléchi à une meilleure occupation de l’espace, nécessairement restreint, de la cité-Etat (dont 20% sont
réservés à la défense nationale), en envisageant notamment la création d’un système d’optimisation de la
logistique urbaine pour réduire la congestion dans la ville. Le Comité souhaite que la préservation de
l’environnement ne soit pas sacrifiée sur l’autel du développement économique.
2. Que faut-il retenir des conclusions du rapport ?
Après des décennies de croissance économique rapide, caractéristique d’une économie en phase de
rattrapage, Singapour est confrontée depuis quelques années à un ralentissement de sa croissance, passée à 1-
2%. L’objectif affiché d’une croissance de 2-3%, s’il a le mérite d’être réaliste, peut néanmoins être
considéré comme modeste puisqu’il correspond à la croissance potentielle de Singapour. Cet objectif semble
suggérer que la perspective, encore évoquée il y a quelques années, d’une croissance de la population jusqu’à
10 millions d’habitants, est désormais écarté. La cité-Etat semble donc s’engager sur la voie de gains de
productivité générés par une meilleure utilisation des facteurs de production, et une croissance plus endogène
fondée sur l’innovation, les infrastructures et le capital humain.
Les réactions à la sortie du rapport ont été contrastées. Si certains saluent la couverture d’un large
spectre d’enjeux, le rappel de l’attachement au libre-échange ainsi que des contraintes liées à sa taille et à sa
dépendance vis-à-vis de l’extérieur, d’autres sont plus critiques.
Les critiques sur la forme sont les suivantes :
- Les recommandations sont très générales et sans doute insuffisamment précises et spécifiques.
- La plupart des axes stratégiques ne correspondent qu’à la poursuite ou à l’intensification de ceux
existants dans le plan de transformation économique lancé en 2010.
- Les cibles à atteindre, formulés en termes de taux de croissance du PIB, sont moins précises que celles
des précédents exercices de prospective, qui étaient formulées en termes de croissance annuelle de la
productivité du travail. Face à l’incapacité à atteindre cette cible ces dernières années, le Comité a fait
le choix de l’abandonner plutôt que de la réviser voire en discuter la pertinence. De façon plus
générale, les indicateurs qui permettraient de suivre la réalisation des recommandations du rapport
font défaut. Aussi existe-t-il un risque, certes assez classique dans ce type d’exercice, que les
recommandations ne fassent pas l’objet d’un suivi adapté et restent lettre morte.
- La méthode est également critiquée : l’approche planificatrice, centralisée et descendante qui consiste
à réunir un panel de haut niveau pour prescrire des mesures essentiellement portées par les pouvoirs
publics a certes permis à la cité-Etat d’atteindre des résultats impressionnants en 50 ans mais semble
désormais atteindre ses limites dans le contexte d’une économie mature et confrontée aux
technologies disruptives. Même si le caractère général des recommandations pourrait justement
s’expliquer par la prise de conscience des limites de la planification, une économie mature requiert
davantage d’innovation et donc d’initiative individuelle, de liberté d’entreprendre, ainsi qu’un état
d’esprit plus créatif que ce que le rapport semble suggérer.
Trois critiques sur le fond du rapport qui portent sur l’absence d’ancrage des recommandations
dans un diagnostic centré sur des contraintes et des risques clefs bien connus :
- S’il est nécessaire de se livrer à des exercices de prospective, aucun réel diagnostic de la situation
actuelle de l’économie singapourienne ne figure dans le rapport, sinon en filigrane. Ainsi, le rapport
ne remet pas en cause le modèle économique singapourien très largement fondé sur les exportations,
les capitaux étrangers (sous la forme d’implantations de firmes multinationales, à l’origine de 75%
des dépôts de brevets d’innovation dans la cité-Etat), et sur la main-d’œuvre étrangère à bas coût. Un
certain nombre de problèmes structurels ne sont pas traités : la perte de compétitivité prix notamment
(exemples : échec de la tentative de créer un hinterland à coûts plus faibles en Malaisie comme à
Iskandar en raison de la mainmise des développeurs immobiliers sur cette zone, rôle du secteur
immobilier dans la perte d’attractivité coût de l’économie singapourienne et dans l’effet d’éviction de
l’épargne privée détournée des investissements productifs et d’avenir), la vulnérabilité de la
prééminence de hub régional de Singapour, ou la difficulté à générer de l’innovation en dépit des
importants montants de dépense publique qui y sont consacrés. Or ce modèle, qui n’a notamment pas

Ambassade de France à Singapour - Service économique régional de Singapour
permis à Singapour de faire émerger des entrepreneurs locaux innovants, créatifs et compétitifs, n’est
pas explicitement interrogé, même si l’objectif de stimuler l’innovation est omniprésent dans le
rapport. A fortiori, le modèle économique envisagé par le Comité n’est pas précisément décrit.
- La contrainte démographique aurait mérité une attention particulière : 40% de la population active
(3,6 millions au total) est non-résidente et le taux d’emploi des résidents (citoyens et résidents
permanents) atteint le niveau record de 68,3%. La cité-Etat sera en Asie le pays où la proportion de
personnes âgées de 65 ans et plus augmentera le plus entre 2015 et 2030 pour dépasser 20% de la
population totale. Or les conséquences économiques, financières et sociales de la baisse relativement
rapide de la population active ne sont pas mentionnées (d’après le groupe bancaire DBS, à politique
migratoire inchangée, le rythme de baisse de la population active en glissement annuel sur la période
2016-21 se chiffrerait à 1,02 point de pourcentage, soit le plus élevé en Asie). Le fait que le CFE ne
signale même pas une seule fois la politique migratoire est révélateur de la sensibilité qu’elle revêt :
compte tenu du rôle central joué par le recours à la main d’œuvre étrangère, il est paradoxal que ce
thème soit omis.
- Le risque de hausse des inégalités
2
et de l’insuffisance des filets de protection sociale ne sont pas non
plus traités. Or, les effets redistributifs de la mondialisation (et les perdants qu’ils génèrent), s’ils ont
épargné jusqu’à présent Singapour, pourraient la toucher à l’avenir. En effet, l’innovation et les
nouvelles technologies contribuent à polariser le marché du travail, au détriment des moins qualifiés,
accroissant ainsi les inégalités. De même, le vieillissement rapide de la population singapourienne
devrait avoir un effet aggravant sur les inégalités. Une demande de protection et de redistribution
accrue pourrait par conséquent émerger.
***
Le rapport fournit néanmoins un aperçu utile des priorités stratégiques de Singapour, auxquelles
la France devrait être en mesure d’apporter sa contribution. Nous pouvons, dans ce contexte, promouvoir
notre modèle d’innovation fondé sur l’excellence scientifique et technologique, sur une créativité largement
reconnue et sur la prise en compte de la dimension sociale et solidaire de l’innovation. Ces caractéristiques
correspondent aux priorités du CFE. Le projet de création d’un French Tech Hub, actuellement porté par des
français installés à Singapour avec le soutien de l’Ambassade, participe de cette ambition, puisqu’il
permettrait de rendre plus visible et cohérente l’offre française sur le territoire de la cité-Etat et d’améliorer la
vision de la France comme un territoire d’innovation de référence auprès des singapouriens. En outre, le projet
de Global Innovation Alliance évoqué dans le rapport serait également cohérent avec les développements
récents de la relation franco-singapourienne, marquée par la multiplication des partenariats dans le domaine
académique, industriel, et de la recherche.
2
En 2016, le coefficient de Gini estimé à 0,458 est le plus bas depuis 2006 d’après l’agence gouvernementale SingStat, mais il est l’un
des plus élevés des pays de l’OCDE – quoi que cette comparaison soit rejetée par les autorités singapouriennes réaffirmant la
spécificité d’une cité-Etat de petite taille.
1
/
4
100%