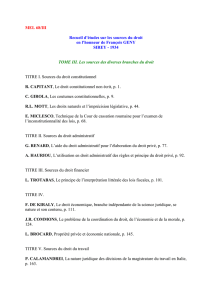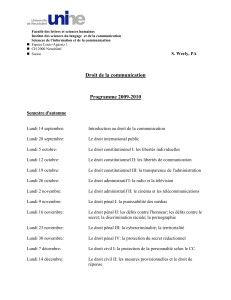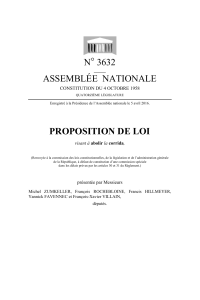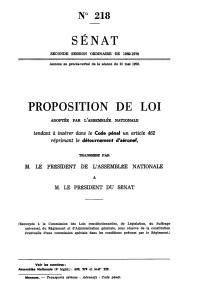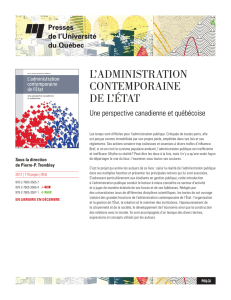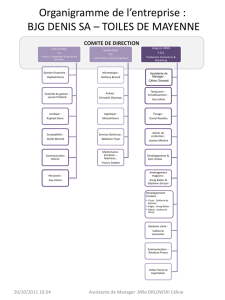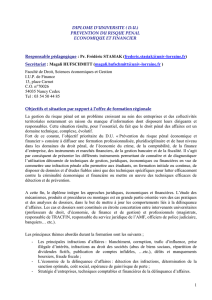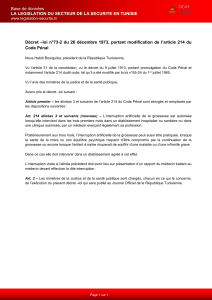La volonté de punir, Denis Salas (2005)

Amandine Bocco
L3 Lettres voie sciences politiques
Fiche de lecture
La volonté de punir,
Denis Salas (2005)

Pièce emblématique du théâtre de l’absurde, Le Rhinocéros dépeint une épidémie qui se propage dans une
ville imaginaire et transforme ses habitants en rhinocéros. Evoquée dans l’épilogue de l’ouvrage de Denis
Salas, l’apologue du dramaturge Eugène Ionesco illustre métaphoriquement l’infection qui affecte les états
démocratiques contemporains. L’auteur, magistrat et chercheur à l’Ecole nationale de la magistrature, nous
délivre sa réflexion personnelle sur les enjeux juridiques contemporains qui font se muter la justice pénale.
La thèse défendue dans La volonté de punir est celle de l’orientation quasi irréversible des sociétés
démocratiques vers un paradigme répressif qui structure les paysages politique et juridique : le « populisme
pénal ». Denis Salas s’emploie à démontrer que la pente sécuritaire est nocive pour nos démocraties et à
dévoiler les rouages du populisme pénal, en invoquant la responsabilité et la participation d’acteurs multiples
dans la construction de ce nouveau paradigme inquiétant. Pour poser les jalons spatio-temporels, nous
pouvons considérer que le début du cycle répressif peut être daté des années 1990. Le monde judiciaire est
soudain devenu le pôle de référence des sociétés démocratiques européennes dont les valeurs et les formes
traditionnelles d’autorité n’ont plus la même légitimité qu’auparavant. Le volontarisme législatif, comme le
nomme Denis Salas, qui s’exprime par une production démesurée de textes de loi majoritairement répressifs,
prétend pouvoir apporter une réponse à tous les maux sociétaux par le seul interdit juridique. Le propre du
droit est l’équilibre solide qu’il est capable de trouver entre répression et clémence, entre punition et
indulgence, entre devoir de condamner un crime et droit de tolérer une déviance. Il doit résister à la pression
populaire qui tend à exiger davantage de lui à une époque où l’on pense que seule la répression est garante de
la sécurité. Or « la démocratie est facilement otage des paniques morales qui se propagent dans une société
médiatisée » écrit l’auteur (p. 15). Dans ce cadre contemporain où les peurs collectives se cristallisent autour
de nouvelles formes de criminalité, quel est l’avenir d’un appareil judiciaire qui est de plus en plus sous le
joug des attentes collectives, de l’immédiateté d’un temps politique court, voire immédiat, là où le projet
juridique originel (celui fécond de l’après Deuxième Guerre mondiale), avait adopté une éthique de la
prudence et du doute nécessaire ? Plus que cela, quel serait l’avenir d’une démocratie ?
La prétention de cet ouvrage n’est pas de dénoncer une dérive sécuritaire, dont les dangers ont déjà été
décriés et continuent encore de l’être. Il ne s’agit pas non plus, selon l’auteur, de méconnaitre ou de
minimiser la nocivité des nouvelles formes de criminalité auxquelles le pouvoir politique et le pouvoir
judiciaire doivent bien entendu trouver une réponse. Ce livre porte sur « les excès de cette réponse qui en
ruinent toujours la légitimité et souvent l’efficacité. Il analyse un danger qui ne relève pas d’un mauvais
choix politique mais d’une transformation de la démocratie elle-même » [p. 14]. Bref, en étudiant les
dynamiques qui régissent le droit de punir, Denis Salas entend démontrer comment les mutations de
l’appareil judiciaire induisent une mutation de la démocratie. Après avoir retracé les grands axes dialectiques
de la réflexion offerte par Denis Salas (nous procéderons par une démarche thématique par souci de synthèse
et de concision), nous insisterons sur les limites rhétoriques de ce travail, qui malgré sa richesse et sa
pertinence certaines, peut être contesté sur certains points.
Le renforcement de l’autorité étatique est devenu une caractéristique de nos démocraties modernes. Les
2

lois d’exception tendent à devenir la norme, les prérogatives des forces de police ont été largement
consolidées tandis que la magistrature est de plus en plus assujettie aux attentes des hommes politiques
comme à celles de l’opinion. Si les moyens employés mobilisent un effort national et une implication des
différentes instances d’autorité, on peine encore paradoxalement à définir à qui doivent s’appliquer ces
dispositifs hors norme. Les médias et hommes politiques parlent d’un ennemi invisible et interne : il est
insaisissable mais son action nuisible est pourtant diffuse. L’identité de cet ennemi se décline en réalité en
fonction des crimes qui ont traumatisé la société civile depuis le début du XXIème siècle : pédophilie, petite
délinquance, crime organisé national ou transnational ; et plus dernièrement un délit qui cristallise toutes les
peurs et engendre une demande croissante de sécurité, le terrorisme.
Au tournant du XXème siècle, l’ordre international est totalement bouleversé : la période de la guerre froide
avait fédéré deux blocs qui se définissaient mutuellement comme une altérité négative et ennemie
(l’impérialisme occidental contre le totalitarisme communiste). Or, en 1991, à la chute inéluctable du pôle
soviétique, l’Europe occidentale prend la référence idéologique et politique à partir de laquelle elle avait
construit sa propre identité, comme son antagonisme. Le processus d’altération ne pouvant plus s’exprimer
collectivement et consensuellement contre une entité géographique et idéologique définie, finit par être
intériorisé : d’autres étiquettes sont apposées sur des menaces de tout ordre (l’immigration clandestine, la
nébuleuse insaisissable terroriste, le trafic de drogues et d’êtres humains). L’expérience de la globalisation et
le trauma du 11 Septembre 2001 deviennent le creuset de la psychose sécuritaire : le monde est plus fluide,
les frontières plus poreuses, la demande de sécurité se fait plus pressante et l’on a tendance à accepter avec
moins de résistance les dispositifs liberticides proposés par les politiques gouvernementales (le Patriot Act
en est l’exemple par définition). L’ennemi est un individu interne à la nation désormais. Il n’est ni
localisable, ni identifiable. La psychose est alors d’autant plus forte que les sociétés occidentales ont vu
naitre et grandir des individus formés et éduqués chez elles, qui en voudront à leur intégrité politique et
sociale.
Or, lorsque la figure du criminel change, l’action qui vise à éradiquer ce qu’il y a de déviant chez lui change
également. C’est dans ce cadre contextuel qu’un acteur nouveau intervient et son avis vaut comme argument
d’autorité : le droit de punir devient légitime comme réponse aux nouvelles formes de criminalités dans la
mesure où il suit les directives édictées par l’opinion publique. Les politiques gouvernementales se
précipitent dans le sillon du droit punitif et répressif car elles ne peuvent rester indifférentes aux attentes de
la société civile. Dans le discours politique postérieur aux attentats du World Trade Center, on voit se
conjuguer la rhétorique du droit de punir avec le vocable de la guerre : « militarisation du pénal et
criminalisation de la stratégie se croisent » nous dit Denis Salas (p. 51). La sécurité est érigée en droit
fondamental puisqu’elle serait « la condition de l’exercice des libertés individuelles et collectives » : ce droit
à la sécurité est entériné, en France, par les lois Pasqua (1995), Vaillant (2001) et Sarkozy (2003). Ainsi, la
loi pénale devient à la fin du XXème siècle le seul garant de la protection des individus qui se disent
émancipés et détachés du paternalisme d’état.
Face à une criminalité plus diffuse, l’opinion tend à faire porter le stigmate de « criminels » à certaines
populations défavorisées, concentrées dans les nœuds urbains sensibles et très souvent issues de
l’immigration. De ce fait, sur l’échelle nationale, non seulement les propos violents se font de plus en plus
communs à l’égard des immigrés, lesquels cristallisent ces menaces indéfinissables qui s’expriment
ponctuellement dans les conflits géopolitiques mondiaux ou nationaux ; mais ils deviennent également
audibles, c’est à dire moralement acceptables. Pour Denis Salas, le populisme démagogue des partis
d’extrême droite, dorénavant institutionnalisés, a jeté les bases du populisme pénal : « le populiste est un
polémiste (…) son appel au peuple est toujours un appel contre certains autres » écrit P. A. Taguieff_. Le
3

populisme et la démagogie lepénistes s’inscrivent effectivement dans un argumentaire guerrier fécond après
le 11 Septembre. En 2002, l’appropriation des lieux communs populistes par Jean Marie Le Pen a résulté en
une prise de conscience collective : le Front National a su faire bouger les lignes de force qui structuraient le
jeu démocratique, il a fortement questionné les discours tenus par les partis traditionnels ainsi que leur
légitimité démocratique. Dès lors, le discours populiste ne s’est plus cantonné aux représentants des
mouvements d’extrême droite : il s’est diffusé dans l’ensemble de la sphère politique, atteignant les factions
traditionnellement modérées. Il s’est imposé comme une composante presque inaliénable de la vie
démocratique.
Les acteurs principaux, ceux qui forment le noyau dur du populisme pénal sont l’opinion publique, les
hommes politiques et les médias. C’est à ces derniers que nous allons nous intéresser maintenant, et
notamment au récit produit par eux. En prenant l’exemple de l’enlèvement et de l’assassinat du jeune
Philippe Bertrand en 1976 qui fut à l’origine de la célèbre phrase détournée « la France a peur » de Roger
Gicquel sur TF1, Denis Salas montre que les affects du « peuple émotion » nourrissent le récit médiatique.
Celui-ci est formaté par « une pensée affective, des rôles stéréotypés, une représentation volontiers binaire
(le Bien et le Mal) qui appellent au jugement immédiat » (p. 58). Le meurtrier Patrick Henry voit alors son
identité figée dans la représentation d’un mal incurable : les téléspectateurs qui se feront juges par la suite de
cet homme, n’invoqueront plus que la douleur fictionnalisée de la victime et celle, dramatisée, de sa famille.
Plus aucun crédit ne sera accordé à la volonté réformatrice et morale d’un Patrick Henry dont le projet de
réinsertion était solide cependant. En utilisant ce célèbre exemple, Denis Salas entend montrer que le récit
médiatique se charge d’ériger des frontières normatives entre les individus en pointant du doigt celui qui a
porté atteinte à l’intégrité d’un individu et donc à la nation toute entière.
Ce qui change au XXème siècle, remarque Denis Salas, c’est que l’institution médiatique, par sa puissance
d’évocation et par l’impact qu’elle a sur l’imaginaire collectif, se substitue à une autre institution qui est,
elle, originellement chargée de juger : la justice. L’éventail d’émotions qui fonde les ressources narratives du
récit médiatique est très large et sert à construire les représentations des criminels en premier lieu. L’auteur
souligne que la capacité de glissement et la proximité entre les différentes émotions (compassion, pitié,
indignation, colère, esprit de vengeance) sont préoccupantes : « au prime des médias, la distribution des rôles
fluctue. Au jeu des identifications, les odieux coupables peuvent être attendrissants et les victimes les plus
innocentes deviennent douteuses » (p. 87). Le lecteur comprend alors que le pendant médiatique de cette
gamme plurielle d’émotions serait la construction d’un spectacle du malheur, la vue et la mise en scène de la
douleur qu’elle soit celle de la victime qui souffre injustement ou celle du criminel qui a fauté. Un théâtre où
les masques s’échangent au gré des jugements de valeurs co-construits dialectiquement par l’opinion et les
médias.
D’autre part, un glissement majeur s’opère dans le monde du droit et de la littérature juridique. Depuis les
commencements du droit pénal, la criminologie avait pour objectif premier d’étudier le criminel, son passé et
sa psychologie, à la fois pour mieux comprendre ses motivations criminelles et pour tenter d’élaborer une
stratégie préventive du crime. Au XXème siècle, parallèlement à l’avènement du populisme pénal, c’est
d’abord à la victime que l’on s’intéresse. Historiquement, les témoignages de la Shoah déclenchèrent la
reconnaissance de la victime et de sa douleur : la légitimité de la parole de la victime trouve un point
d’ancrage dans ces années d’après-guerre. Si l’éthique victimaire prend tant de place dans le droit pénal et
dans le récit médiatique, c’est que le discours compassionnel (à comprendre comme le récit sur le malheur de
la victime) vaut comme une nouvelle forme de solidarité qui vient retisser un semblant de cohésion sociale là
4

où les valeurs fédératrices connaissent une crise d’autorité sans précédent. A cet égard, la fin des grands
récits serait le creuset du populisme pénal. Le droit pénal tend à ne reconnaitre plus que la précarité de la
victime. De ce fait, le droit de punir entend davantage réparer l’injustice subie par la victime que de restaurer
l’ordre légal et la paix sociale (la fonction originelle et essentielle du droit). Pourtant, l’état semble vouloir
assurer cette directive pour ne jamais paraitre indifférent voire complice à l’égard de la criminalité. En
somme, l’idéologie victimaire est soutenue par l’Etat qui cherche une légitimité morale à la multiplication
des mesures sécuritaires et par les victimes, qui cherchent un sens à leur malheur.
Si Denis Salas revient à plusieurs reprises sur l’ampleur du discours victimaire et de sa représentation dans la
presse, c’est parce que ces deux faits trouvent une traduction politique tout à fait dangereuse, à son sens, pour
la démocratie. En effet, les hommes politiques se sont également appropriés la rhétorique compassionnelle :
face à un crime qui émeut les potentiels électeurs, les candidats politiques en liste se doivent de réagir de
manière consensuelle. Ce faisant, les hommes politiques instaurent un degré de connivence avec l’opinion
par le consensus émotionnel. Ils condamnent la criminalité et réaffirment les lignes normative et moralisante
qui séparent le « Bien » du « Mal ». Enfin, ils restaurent leur pleine puissance en demandant à ce que la
justice soit faite justement et promptement (replaçant les institutions juridiques et policières en position
d’infériorité). Tout cela n’a pour objectif, selon l’auteur, que de servir des velléités clientéliste et
électoraliste. De plus, la rhétorique de la pitié favorise les conditions conjoncturelles de l’effervescence
législative, c’est à dire la production improvisée et immédiate de textes de lois. En effet, les exigences
médiatiques dans lesquels s’ancrent les faits divers et crimes surmédiatisés, imposent un modèle de temps
court qui empêche une réflexion et une compréhension profonde de ce qu’est ce mal ordinaire. Denis Salas
écrit « faute de temps pour interpréter ce qui arrive, l’acteur politique s’épuise dans une vaine réactivité à
l’événement ». En réalité, la figure victimaire est autant sacralisée qu’instrumentalisée dans le populisme
pénal, mais dans les deux cas, elle donne lieu à des changements législatifs majeurs. Elle sert également
d’alibi aux politiques gouvernementales pour faire valoir la nécessité d’un cadre pénal plus répressif. Dans la
mesure où culture de la guerre et droit pénal renforcé se côtoient et se complètent dans nos sociétés
contemporaines, la démocratie en temps de guerre montre ses limites et la précarité de ses valeurs libérales
cardinales : « l’état replonge dans une violence originaire. Les croisades morales et populistes rompent
l’équilibre entre la force et la forme qui constituent l’état de droit » (p.115).
L’élan historique de 1945 et le texte constitutionnel de 1946 propulsent la démocratie dans une logique
égalitaire, distributive et solidaire. Si cette impulsion se traduit par des mesures éminemment sociales, elle
trouve un prolongement également dans l’esprit qui va envahir le champ juridique. D’une part, les peines ne
seront prononcées que si les crimes commis ne permettent d’envisager aucune autre sanction plus
indulgente ; d’autre part, l’incarcération a moins vocation à protéger la collectivité d’une nuisance que celle
de permettre un travail de réhabilitation par le condamné sur lui-même et un travail de pardon du côté de la
société. La prison doit préparer le condamné à la vie libre, elle est davantage un lieu de guérison où l’on
tente de faire reculer les frontières de l’inamendable, qu’un lieu d’exclusion où toute possibilité de
rédemption serait vaine. L’imaginaire collectif considère le déviant comme un semblable malgré son crime :
ce qui le définit n’est pas tant son crime que son humanité. Or l’élan humaniste de 1945 se confronte à une
première vague réactionnaire à l’occasion de la guerre d’Algérie où le corps civil français découvre la figure
d’un « ennemi de l’intérieur » et redécouvre l’inculpation de « terrorisme » tandis que l’internement
arbitraire et la peine de mort deviennent communs en territoire colonisé. A l’instar de Michel Foucault, un
courant d’intellectuels critiques outre mer et en Europe continentale produit une réflexion presque
consensuelle sur les échecs de la philosophie pénitentiaire. Malgré les réformes et mesures prises pour
réduire la criminalité, les tendances et les chiffres d’incarcération restent sensiblement les mêmes. La figure
du délinquant serait un produit de l’institution carcérale, qui permet aux instances institutionnelles des
5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%