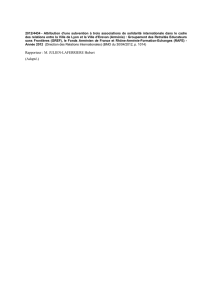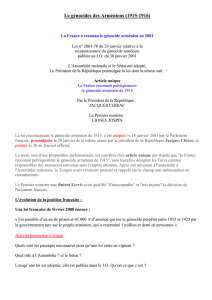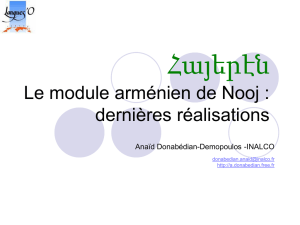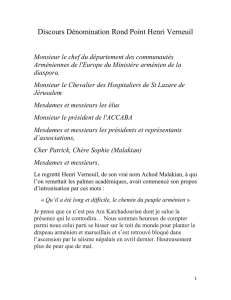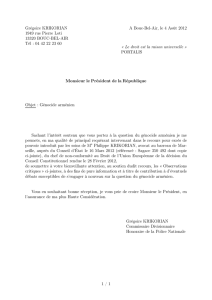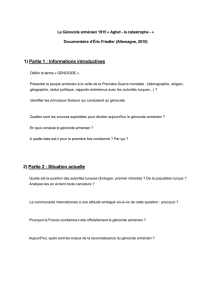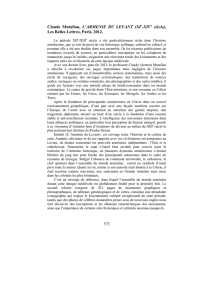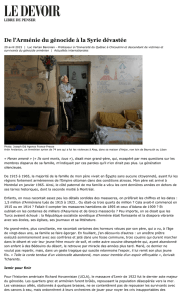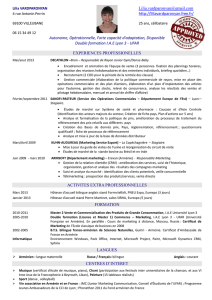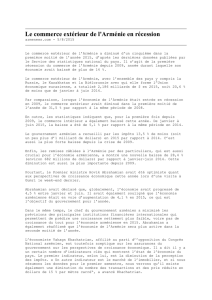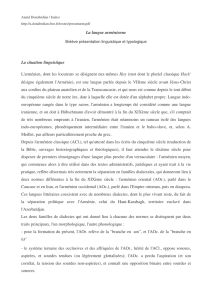typologie, ordre des mots et contact linguistique

DONABEDIAN, A., De l'arménien classique à l'arménien moderne: typologie, ordre des mots et contact
linguistique, Cahiers de Linguistique de l'INALCO 3/2000, 34-54.
Cahiers de Linguistique de l'Inalco, 2000, 1-3.
DE L’ARMENIEN CLASSIQUE A L’ARMENIEN MODERNE :
TYPOLOGIE, ORDRE DES MOTS ET CONTACT LINGUISTIQUE
Anaïd DONABEDIAN
INALCO, 2, rue de Lille, 75343, Paris Cedex 07
Cet article, comme un certain nombre de ceux qui constituent ce numéro,
s'inscrit dans une perspective diachronique, aréale et typologique. La question
à laquelle il s'agit de répondre ici se situe en effet au carrefour de ces trois
types de classification des langues, démontrant une fois de plus si besoin était
qu’ils constituent tout au plus des pistes de classification, des ingrédients qui
s’amalgament, et non des principes de classification absolus et étanches. Le
cas de l’arménien, langue indo-européenne souvent présentée comme
« conservatrice », mais qui a subi des changements typologiques importants
au cours de son développement, est une illustration particulièrement claire de
cette intrication des facteurs qui expliquent les différentes composantes d’un
système linguistique. Dans une approche qui sera inévitablement trop rapide
au regard de la quantité de données en jeu, nous tenterons de montrer
comment ces éléments s’intriquent à la manière d'un puzzle. Le mouvement
ainsi observé, et dans lequel l'ordre des mots joue un rôle primordial, relève à
la fois du changement diachronique, notamment dû au contact, et de la
réactivation, voire de la généralisation de tendances anciennes. L'ordre des
mots occupe une place importante dans les phénomènes décrits, mais ces
changements d'ordre des mots ne peuvent se comprendre sans appréhender
une série de phénomènes corrélés, ce qui vient confirmer, si besoin était, la
théorie des universaux implicationnels de Greenberg.
1. L’arménien classique1 : une langue indo-
européenne plutôt « conservatrice »
L'arménien classique présente un système conservateur dans son ensemble,
mais également une série de traits spécifiques atypiques.
1.1. La flexion
Les langues indo-européennes comportant une système flexionnel très
développé (comme par exemple aujourd'hui, le russe), sont considérées
comme particulièrement conservatrices. Au cinquième siècle de notre ère,
l'arménien se distingue toujours par une morphologie grammaticale très riche,
tant dans le domaine nominal que verbal.
1 On désigne sous ce terme la langue du Vième siècle de notre ère, époque où les premiers
témoignages écrits nous parviennent. Ce n'est qu'à partir du XIième siècle que des témoignages
écrits nous parviennent dans une langue qui semble être un vernaculaire largement distinct.

A. DONABEDIAN
2
Du côté du nom, comme le rappelle Meillet (1962 (1897-98) : 53), la
langue a conservé la déclinaison avec une fidélité presque unique. La flexion
nominale de l'arménien classique est en effet constituée de 5 types de
déclinaison nominale distinguant chacun sept2 cas. L'arménien a notamment
conservé l’ablatif, contrairement à bon nombre de ses parentes. Certes, on ne
dispose pas de sept morphèmes casuels différents pour chaque type de
déclinaison, mais les syncrétismes, différents pour chaque type (et bien
souvent au singulier et au pluriel), permettent de considérer que la langue
distingue sept cas.
La flexion verbale est riche également de cinq modèles, auxquels il faut
ajouter les verbes irréguliers et les oppositions de voix
1.2. Divers traits conservateurs
A côté de la flexion, d'autres traits apparaissent comme parfaitement
cohérents avec ce que l'on peut attendre d'une langue indo-européenne à cette
époque : c'est le cas des relateurs du nom, qui sont essentiellement des
prépositions, et du déictique à trois degrés.
La subordination s'opère exclusivement au moyen de conjonctions
introduisant des complétives, relatives et circonstancielles, fonctionnement là
encore assez typique des systèmes indo-européens.
1.3. Traits atypiques
Pourtant, certains traits de l’arménien classique, dès le cinquième siècle,
apparaissent comme largement atypiques au regard du fonds indo-européen :
a. L'arménien ne connaît pas et ne semble porter aucune trace décelable
d'une opposition de genre grammatical. Ce dernier n'est en effet jamais attesté
à l’époque historique, et ce, en aucun point du système, y compris les
pronoms. Seule la distinction personnel/non personnel – qui/quoi existe dans
la langue, étant entendu que les dérivations de noms de personnes de sexe
féminin à partir d'un masculin ne suffisent pas à fonder un genre grammatical
absent en tous autres points du système, ces dérivés n'étant pas susceptibles
d'entraîner un phénomène d'accord ou de cooccurrence (pronoms,
anaphoriques, etc.) notamment pour les pronoms. Pour Meillet, les trois
degrés de démonstratifs (ays, ayd, ayn), susceptibles, eux, de cooccurrence,
compensent l'absence de genre grammatical dans sa fonction
désambiguïsante, en fournissant une autre possibilité de cooccurrence, tout
aussi riche. Charles de Lamberterie suggère d'ailleurs, compte tenu de cette
"anomalie", d'envisager sous un autre angle la riche flexion de l'arménien
classique : elle pourrait s'être développée au contact du hourro-ourartéen après
avoir perdu les finales indo-européennes. La richesse de la flexion de
2 Nominatif, accusatif, génitif, datif, ablatif, locatif, instrumental.

DE L'ARMENIEN CLASSIQUE A L'ARMENIEN MODERNE 3
l'arménien classique ne serait donc que secondaire, et interviendrait après un
premier appauvrissement.3
b. Par ailleurs, et les deux faits sont très probablement corrélés, il n’y a
aucun phénomène d’accord obligatoire en arménien, que ce soit au sein du SN
ou dans le cas d’une anaphore. En réalité, les phénomènes d’accord sont très
modulés en arménien classique : les règles en semblent difficiles à déterminer
et Meillet (1962 : 39) les qualifie de "complexes et fuyantes". Au sein du SN,
l’épithète qualificative, si elle est placée après le nom, est généralement
accordée en cas et en nombre. L’ordre nom / adjectif est plus fréquent dans les
traductions (peut-être sous l'influence du texte original). Dans les textes
originaux arméniens, l’ordre adjectif / nom est préféré, et l'adjectif est alors
généralement invariable. L’ordre nom / adjectif, qui reste possible, est jugé
« emphatique » et suppose l’accord. On voit donc que si l’adjectif précède le
nom, il est en général invariable, et c'est ce modèle qui s’est par la suite
généralisé en arménien moderne, avec la tendance à la mise en facteur
commun des marqueurs. L’adjectif est fléchi si « l’attention est appelée sur
lui »
(1) i hingetasanerord-i am-i
dans quinzième-LOC année-LOC
Dans la quinzième année
Notons cependant les cas particuliers des monosyllabiques qui s’accordent
souvent (ce qui concourt à expliquer l’absence d’accord par une usure de
finales du fait de l’accentuation), ainsi que l'accord en cas mais pas en
nombre, comme en (2) :
(2) mecaw zarmanawk`
grand-INST.SG étonnement-INST.PL.
Mais dans ce cas particulier, comme nous le verrons au prochain alinéa,
l'attention doit être attirée sur la nature spécifique du –k` de pluriel.
Enfin, la marque de nombre présente une certaine indépendance qui se
manifeste lorsque la présence d'un numéral supérieur à un n'entraîne pas la
présence d'un substantif au pluriel4.
3 "Si le système verbal résulte d'une série d'innovations qui sont allées dans le sens d'une
simplification, l'arménien a, en revanche, gardé une riche flexion nominale, avec sept cas, ce
qui est surprenant pour une langue qui dans sa préhistoire a perdu les finales indo-
européennes. Ce maintien d'une structure archaïque est peut-être dû à l'influence des langues
environnantes, notamment celles du Caucase du Sud, qui ont une riche déclinaison; ce qui
invite à chercher dans ce sens, c'est que l'arménien ignore tout autant que ces langues le
genre grammatical, trait qui, pour une langue indo-européenne, représente évidemment une
innovation." Charles de Lamberterie, (1994:155).
4 D'après Meillet, ce fonctionnement existe en géorgien et en pehlevi, mais nous savons
que c'est également celui du turc, ce qui semble dessiner une Sprachbund relativement
cohérente.

A. DONABEDIAN
4
c. De plus, le système flexionnel présente quelques traces troublantes de
fonctionnement agglutinant. Comparons :
ban ban-k`
parole parole-PL
ban-iw ban-iw-k`
parole-INST parole-INST-PL
sir-em sir-em-k`
aimer-1SG aimer-1SG-PL
On voit que dans ces trois cas, qui sont stables dans tous les modèles
flexionnels, les désinences de pluriel sont susceptibles d'être analysées en
désinence singulier + k‛, ce qui est caractéristique de l'agglutination, et
contraire au fonctionnement flexionnel. Certes, ce phénomène ne s'étend pas à
l'ensemble du système en arménien classique, mais ce phénomène est toujours
observable au nominatif et à l'instrumental des noms, ainsi qu'aux premières
personnes singulier et pluriel des verbes. Le fait qu'il traverse l'opposition
verbe/nom est en outre particulièrement frappant.
1.4. L'ordre des constituants : un système voué à se
transformer
L’ordre dominant des constituants semble être, en arménien classique,
SVO, ce qu’il faudrait plutôt reformuler en SP, le groupe VO étant lui-même
à ordre libre5. La place de l’adjectif est relativement libre, tout comme les
possessifs, relatifs et interrogatifs. Cependant, bien qu'on ne dispose d'aucune
étude systématique sur corpus concernant l'ordre des mots en arménien
classique, des tendances fortes ont été mises à jour : dans le SN,
habituellement, l’adjectif précède le nom, et est alors le plus souvent
invariable. Il n'est certes pas anodin qu'une corrélation existe entre l’ordre des
mots et l’accord. En réalité, tous deux sont significatifs du statut du nom dans
le système. Dans l'évolution vers l'arménien moderne, c'est l'ordre déterminant
/ déterminé qui va se fixer, en même temps que l'accord disparaîtra. Le
substantif final portant seul les désinences grammaticales, ces dernières se
trouvent mises "en facteur commun" et valent pour l'ensemble du syntagme.
On verra que ce choix est également cohérent avec la fixation de l'ordre OV,
avec possibilité d'objet semi-incorporé.
1.5. Diathèse et actance : voix et marquage de l’objet
Benveniste a bien attiré l'attention sur la syntaxe très particulière du parfait
passif arménien. En effet, au parfait, le participe en –eal est intransitif et
passif. Cependant, dans le cas d'un verbe transitif, le sujet est au génitif
(Benveniste Etre et avoir, PLG 1 p. 202).
(3) e
д
r nora hraman ar
ж
eal
était lui-GEN ordre faire-PFT
5 Ce qui rappelle le latin et le grec ancien.

DE L'ARMENIEN CLASSIQUE A L'ARMENIEN MODERNE 5
Il avait donné l'ordre de…
Benveniste analyse cette « anomalie » de l’arménien comme une
manifestation de l’opposition entre être et avoir ou encore de l’opposition
entre état et possession, ce qui explique la présence du génitif. Cette
interprétation ne résout cependant pas la question du statut de l’objet. En
effet, c’est la présence de la marque d'accusatif préposée z- qui dans de
nombreux exemples permet de faire la différence entre parfait transitif et
intransitif
(4) ed i gerezman-i (z-)or e
д
r p‛oreal i vim-e
д
mit dans tombeau (z-)qui était creusé dans pierre-Abl
Avec z-, cet énoncé a une interprétation active "Il le mit dans le tombeau
qu'on avait creusé dans la pierre", et sans z-, le verbe est passif "… qui était
creusé dans la pierre". (PLG1 : 202).
Selon la description traditionnelle de l'arménien classique, la préposition z-
(nota accusativi) marque l’accusatif défini. Au singulier, s’il n’est pas défini6
et marqué par z-, l’objet n’a pas de différence formelle avec le sujet. Mais,
comme le dit Meillet (1962 : 29) "Un nom ne reçoit pas l’article par le fait
seul qu’il est déterminé ; on en a la preuve par ceci que beaucoup
d’accusatifs pourvus de la préposition z- qui est préfixée seulement aux
accusatifs déterminés ne sont pas accompagnés de l’article". En réalité, on
voit bien ici qu'il s'agit d'une définition circulaire : elle souligne d’une part le
fait que l’article n’est pas nécessaire pour marquer la détermination, et précise
par ailleurs que z- marque l’objet déterminé alors même qu’il n’est pas
toujours pourvu de l’article : on se demande ce que signifie "déterminé" dans
ce cas. On peut penser que la notion de détermination confond la
détermination qualitative et référentielle :
(5) or z-inc
‘ asic‘e
д
jez arasj
ik‘
que z-quoi demander-SUBJ-3SG vous-DAT faire-IMP-2PL
Ce qu'il vous demandera, faites-le. (cf. Jean II,5, cité par Meillet p.34)
Pour Meillet, ici, "l’auteur insiste sur l’indétermination". on peut proposer
une analyse différente : dans cet exemple, le pronom indéterminé est marqué
par z- non pas parce qu'il est déterminé ou indéterminé, mais parce qu'il
renvoie à un élément présent dans le contexte (anaphore de or).
Le rôle de z-, renvoie donc plus au statut du nom qu'à une quelconque
détermination. En position objet (dépendant du verbe), pour pouvoir être
autonome, le nom requiert un marquage de type prépositionnel, qui renvoie en
quelque sorte l’objet dans la sphère des compléments indirects, ce qui se
6 Il est surprenant que dans une langue casuelle, l'accusatif (défini) soit marqué par une
préposition. Sur ce point, voir Danon-Boileau et Donabédian (1995).
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
1
/
19
100%