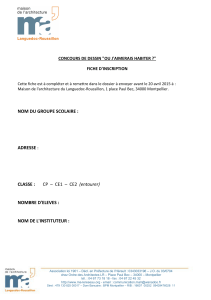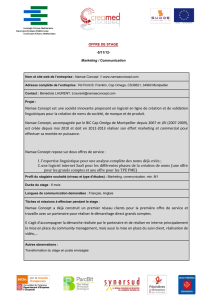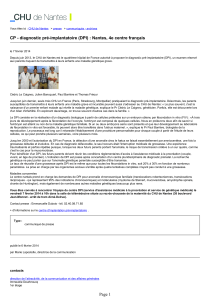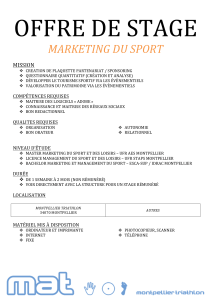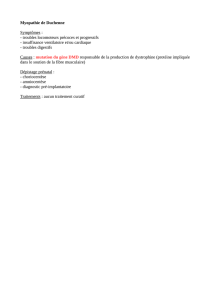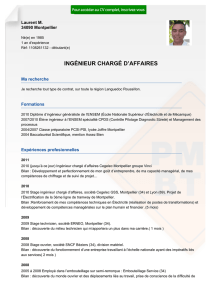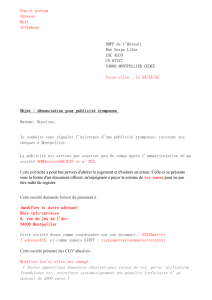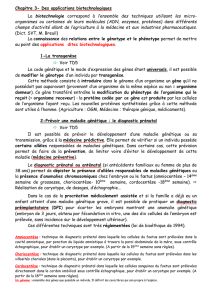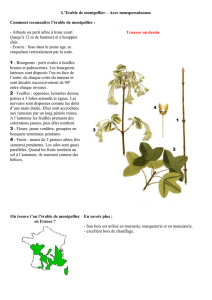Diagnostic prénatal, diagnostic préimplantatoire

7èmes Assises de Génétique Humaine et Médicale – Bordeaux, 23, 30 et 31 janvier 2014 – Recueil Posters
7èmes Assises de Génétique Humaine et Médicale
110
l’échographie. Une IMG a été réalisée au terme de 32 SA. L’autopsie
n’a pas été souhaitée par les parents.
Ce cas illustre l’intérêt du diagnostic chromosomique prénatal par
micropuces à ADN mais montre aussi les difficultés d’interprétation de
certains microremaniements malgré une taille proche de 1 Mb.
Mots-clefs : 6q23, ACPA et DPN, translocation apparemment équilibrée
Diagnostic prénatal, diagnostic
préimplantatoire
B055/#477
Anneau du chromosome 21 diagnostiqué en
prénatal suite à un retard de croissance intra-
utérin : Cas et revue de la littérature.
Fatma Abdelhedi (1), Laïla El Khattabi (1), Aurélie Ménard (1), Vassilis Tsatsaris
(2), Patricia Hornoy (2), Aziza Lebbar (1), Jean-Michel Dupont (1)
1. Laboratoire de Cytogénétique, APHP, Hôpitaux universitaires Paris Centre,
Paris, France
2. Service de Gynécologie Obstétrique, APHP, Hôpitaux universitaires Paris
Centre, Paris, France
Auteur correspondant : ABDELHEDI Fatma (abdelhedi_f@yahoo.fr)
Le chromosome en anneau est une anomalie cytogénétique rare qui
peut survenir pour tous les chromosomes. Les patients qui en sont
porteurs présentent presque tous un retard de croissance intra-utérin
(RCIU) et postnatal d’où la qualification de « ring syndrome » par
certains auteurs. L’anneau du chromosome 21, r(21), a été décrit chez
des patients présentant un phénotype clinique variable, allant d’un
phénotype normal à la déficience intellectuelle associée à une
dysmorphie faciale, une épilepsie et des malformations congénitales.
Cinq cas de r(21) diagnostiqués en prénatal ont été rapportés à ce
jour. Dans trois cas seulement une analyse chromosomique sur puce
à ADN (ACPA) a été réalisée.
Nous rapportons le premier cas d’un anneau du 21 homogène
diagnostiqué en prénatal. Il s’agit d’une femme de 25 ans sans
antécédents pathologiques particuliers et dont la grossesse a été peu
suivie. L’échographie réalisée à 22 SA a montré un BIP au 3e
percentile. Elle a objectivé à 32 SA un RCIU sévère, une
microcéphalie à -4DS et une dilatation modérée des troisième et
quatrième ventricules. L’IRM cérébrale a confirmé la dilatation
ventriculaire et a révélé une gyration simplifiée ainsi que des petits
lobes frontaux. Une amniocentèse est effectuée à 33 SA et le
caryotype fœtal montre la présence d’un r(21) homogène. Les
caryotypes parentaux sont normaux. L’ACPA a mis en évidence une
délétion terminale de 13 Mb (hg18 : 33.933.673 à 46.915.771) en
21q22.11-q22.3 qui emporte la région critique du Down Syndrome
(DSCR). Une interruption thérapeutique de la grossesse a été réalisée
à 36 SA. L’examen fœtopathologique a été refusé par le couple.
L‘anneau du 21 est une anomalie très rare en prénatal. Sa découverte
est le plus souvent fortuite. L’analyse des données de la littérature
montre que l’absence de signes échographiques serait associée à des
délétions terminales de petite taille et inversement. Parmi les cinq
patients précédemment rapportés, un seul présentait un signe d’appel
échographique à savoir un RCIU, comme chez notre patient. Notre
fœtus est le seul à avoir des malformations cérébrales. En comparant
ces différentes observations, il apparaît que la délétion de la région
DSCR (hg18 : 36.000.000-40.500.000 pb environ) qui contient
notamment le gène DYRK1A pourrait être responsable des anomalies
cérébrales. La caractérisation moléculaire par ACPA de cet anneau
permet un début de corrélation génotype-phénotype qui reste à affiner
avec d’autres cas.
Mots-clefs : Anneau du chromosome 21, diagnostic prénatal, ACPA
Diagnostic prénatal, diagnostic
préimplantatoire
B056/#510
Fonctionnement et prise en charge des patients
dans le centre de diagnostic pré-implantatoire
de Montpellier
Aliya Ishmukhametova (1), Stéphanie Plaza (1), Florielle Saguet (1), Garance
Verrières (1), Victoria Viart (1), Marjolaine Willems (2), Christine Coubes (2),
Isabelle Coupier (3), Emmanuelle Haquet (2), Cécile Teissier (4), Sophie
Bringer-Deutsch (4), Tal Anahory (4), Mireille Claustres (1), Anne Girardet (1)
1. Laboratoire de Génétique Moléculaire, INSERM U 827, CHRU de Montpellier,
Montpellier, France
2. Service de Génétique Médicale, Hôpital Arnaud de Villeneuve, Montpellier,
France
3. Service d’Oncogénétique, Hôpital Arnaud de Villeneuve, Montpellier, France
4. Pôle mère-enfant, Hôpital Arnaud de Villeneuve, Montpellier, France
Auteur correspondant : Ishmukhametova Aliya
(aliya.ishmukhametova@inserm.fr)
Le diagnostic génétique pré-implantatoire (DPI) est pratiqué en France
dans 4 centres pluridisciplinaires autorisés par l’Agence de la
Biomédecine.
Nous présentons ici le fonctionnement du centre de DPI de
Montpellier, dont l’activité a débuté en 2002, ainsi que les modalités de
prise en charge des couples.
Les demandes de DPI nous sont adressées par courrier, soit par un
médecin –le plus souvent généticien-, soit par les couples eux-mêmes.
Toutes les demandes sont examinées une fois par mois lors d’un staff
pluridisciplinaire, réunissant généticiens et cytogénéticiens
molécularistes et cliniciens, gynécologues, spécialistes de la biologie
de la reproduction, psychologue et sage-femme coordinatrice.
Chaque demande est discutée au cas par cas, en tenant compte de la
pathologie, de l’histoire familiale, du type de mutation etc & et une
décision est prise quant à l’acceptation de la demande a priori, c’est-à-
dire avant toute étude de faisabilité génétique et gynécologique. Une
réponse écrite est faite à l’issue de chaque staff et tous les dossiers
sont examinés par le Centre Pluridisciplinaire Diagnostic Pré-Natal
(CPDPN) du CHRU de Montpellier.
Un bilan de réserve ovarienne est ensuite réalisé ; si ce bilan est
validé par les gynécologues du centre de DPI de Montpellier, l’étude
de faisabilité génétique pré-DPI peut débuter, à partir de prélèvements
sanguins et/ou d’ADN de la famille sollicitant le DPI. Cette étape est
plus ou moins longue : l’analyse est plus rapide pour des maladies
fréquentes tels que la mucoviscidose, la maladie de Huntington etc &
et elle peut être beaucoup plus longue lorsqu’un protocole individuel
doit être développé pour un couple ou qu’un diagnostic à l’échelle
unicellulaire doit être mis au point pour une maladie non encore
étudiée dans le laboratoire. A l’issue de cette étude de faisabilité
génétique, les différents intervenants du centre de DPI sont informés
et le couple est alors convoqué à une réunion pluridisciplinaire sur
Montpellier. La date approximative de la première tentative de DPI est
communiquée au couple à ce moment-là. La stimulation ovarienne,
dont le protocole est défini par les gynécologues de notre centre, peut
débuter à distance, puis le couple se rend à Montpellier pour la
récupération du sperme et des ovocytes et la réalisation de la
fécondation in vitro par injection intra-cytoplasmique de spermatozoïde
(ICSI). Au stade 8 cellules (le troisième jour du développement), les
embryons sont biopsiés (un ou deux blastomères sont prélevés) pour
l’analyse génétique et les résultats sont communiqués au couple sous
24h. Les embryons indemnes de la maladie recherchée peuvent être
transférés (le 4ème jour du développement). En cas de succès de
cette tentative, l’évolution de la grossesse est suivie par le
gynécologue du couple. Après la naissance du ou des enfants issus
du DPI, le couple a la possibilité de redemander une nouvelle prise en
charge. Chaque nouvelle demande est réévaluée par notre centre.
Mots-clefs : centre de diagnostic pré-implantatoire de Montpellier, prise en
charge des patients, fonctionnement du centre de DPI
1
/
1
100%