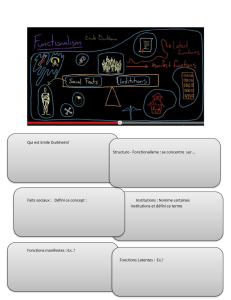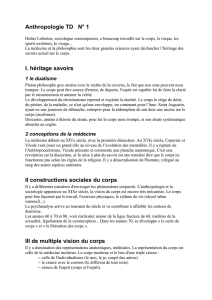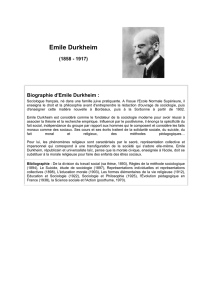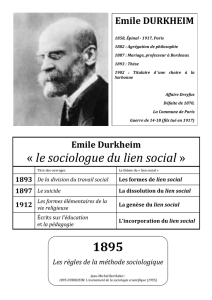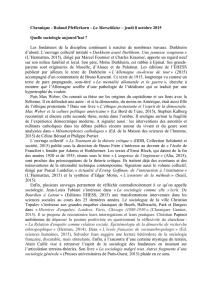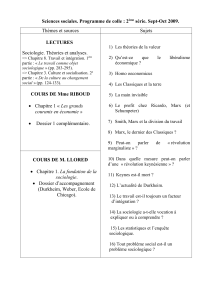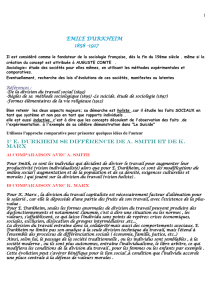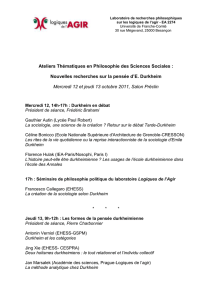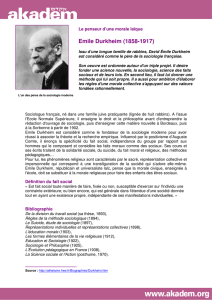ÉMILE DURKHEIM ET MARCEL MAUSS Étude d`épistémologie

DOMINIQUE MORIN
ÉMILE DURKHEIM ET MARCEL MAUSS
Étude d’épistémologie historique sur l’émergence de la tradition
de recherche des sciences contemporaines
Mémoire présenté
à la Faculté des études supérieures de l'Université Laval
pour l’obtention du grade de maître ès arts (M.A.)
Département de sociologie
FACULTÉ DES SCIENCES SOCIALES
UNIVERSITÉ LAVAL
QUÉBEC
OCTOBRE 2003
© Dominique Morin, 2003

Résumé
Entre la fin du XIXe siècle et la seconde guerre mondiale, les sciences ont été bouleversées
par la critique de la logique expérimentale du progrès et par la remise en question du
déterminisme qui structuraient et justifiaient la recherche des lois de la nature. Ces
événements ont marqué et catalysé un mouvement général de réorganisation de la
recherche, de révision de ses visées de connaissances, de ses méthodes, des intentions
pratiques de la science et de ses significations. Ce mémoire apprécie l’apport de cet épisode
de l’histoire des sciences à travers les transformations de la sociologie de Émile Durkheim
et Marcel Mauss, héritiers de la tradition des sciences modernes ayant contribué à
l’élaboration des cadres actuels de la recherche. Rapprochée d’autres entreprises savantes,
l’étude de ce cas alimente des discussions plus générales sur le progrès des sciences et la
vocation morale de la recherche contemporaine.

Abstract
Between the end of the nineteenth century and the Second World War, science has been
shaken by criticism which aimed at experimental logic and determinism. Both principles
structured and justified research on the laws of nature. These events have provoked a
general movement in the reorganisation of research, in the revision of its objectives and its
methods, as well as the practical intentions of science and its meaning. This study evaluates
the contribution of this episode in the history of science through the changes in the
sociology of Émile Durkheim and Marcel Mauss. While taking into consideration other
scientific projects, this case study provides more general reflections on the progress of
science and the moral purpose of contemporary research.

Remerciements
C’est au dépôt du mémoire que s’apprécie le mieux le plaisir qu’on a eu à s’y consacrer et
l’apport des détours qu’on avait considérés comme des égarements. L’événement met un
terme à ce qui aura été jusqu’ici le plus sinueux, le plus atypique, mais aussi le plus riche
de mes cycles d’étude. Plusieurs personnes ont facilité l’accomplissement de ce projet et je
leur en suis reconnaissant.
Dès mon entrée à l’université, M. Olivier Clain s’est imposé à mes yeux comme un modèle
de libre-penseur discutant sans prétention des questions qui ont tourmenté les monuments
de la philosophie, de la psychologie et des sciences sociales. En peu de temps, il est devenu
un conseiller rassurant pour mes lectures et mes études, ainsi qu’un critique honnête et
respectueux de mes travaux. Pour ce mémoire, j’ai eu l’honneur de sa direction rigoureuse
et érudite, non dogmatique et délicate. Interlocuteur agréable et de haut calibre, il a été
présent lorsqu’il le fallait, pour le mémoire et pour les à côtés. Le soutien d’un directeur
estimé fut le meilleur antidote aux doutes du thésard ; son intérêt, sa confiance et ses
attentes élevées, une motivation supplémentaire à donner ma mesure.
Sans le séminaire de Mme Sylvie Lacombe, mon jeune esprit porté vers la théorie ne se
serait peut-être jamais arrêté sérieusement à l’œuvre de Marcel Mauss. En plus de la
découverte du terrain de ce mémoire, je lui dois une saine conversion à une sociologie qui
apprécie la complexité des faits sans abandonner l’ambition d’une compréhension générale.
L’intérêt qu’elle a porté aux premières esquisses de ce projet suffisait pour contrer un
éventuel essoufflement. J’ai fait d’elle un des principaux destinataires de ce mémoire
qu’elle a généreusement accepté d’évaluer malgré son mois de septembre chargé et
l’urgence de mon dépôt final : bourse doctorale oblige. J’espère que ce qu’elle y trouvera
lui rendra un peu de ce que je lui dois.
Également très occupé, M. Alain Caillé a aussi accepté d’évaluer ce mémoire. Nous
n’avons pas eu l’occasion de faire connaissance, mais ses travaux sur l’apport de la

REMERCIEMENTS iv
sociologie maussienne et ceux qu’il a dirigés ont été des sources d’inspiration. J’aurai la
chance de profiter de sa co-direction au doctorat à Paris.
Bien qu’il n’en soit nulle part question dans le texte, deux expériences de travail ont
alimenté mes réflexions sur les sciences contemporaines et ont contribué à accroître la
profondeur et à améliorer la présentation de ce mémoire. Ayant participé pendant deux ans
au projet de recherche La banlieue revisitée de Mmes Andrée Fortin, Carole Després et
Geneviève Vachon, j’ai eu l’occasion de baigner dans un groupe de recherche où
sociologues, architectes, psychologues, géographes et urbanistes cuisinent ensemble.
C’était une auberge espagnole dans laquelle tous mettaient en commun leurs
questionnements, leurs préoccupations, leurs expertises, leurs découvertes et où étaient
régulièrement invités ceux qui font la banlieue : des représentants des municipalités, des
paliers de gouvernements, des comités de citoyen, du service de transport en commun, des
médias, etc. La transdisciplinarité et la conjugaison des soucis de comprendre et d’être utile
n’y étaient pas des abstractions. Traitant leurs assistants comme de véritables chercheurs,
moins expérimentés il va de soi, Mmes Fortin, Després et Vachon ont eu l’amabilité de
m’initier aux colloques et à l’art des communications et de la publication. Ce n’est pas peu
de chose pour quelqu’un qui commence et je leur suis reconnaissant.
Par la suite, M. Denys Delâge m’a donné l’occasion de gérer avec lui le Laboratoire de
recherche en sociologie, l’équivalent de quatre cours normaux du premier cycle où les
étudiants font l’expérience d’une enquête en commandite. L’enseignement de la recherche
me permettait de poursuivre mes réflexions en compagnie d’un mentor m’encourageant à
tout faire vite et bien pour « ne pas gaspiller ma belle jeunesse ». L’aventure du
Laboratoire s’est poursuivie l’année suivante en complicité avec M. Jean-Jacques Simard
qui m’a invité à être bachelier dans l’atelier d’un maître artisan exigeant et convaincu des
vertus de l’apprentissage sur le métier. Son enseignement posant la théorie, la
méthodologie, la technique, l’esthétisme et la morale professionnelle comme des
dimensions inextricables de la recherche n’a pas été sans influence sur l’esprit dans lequel
j’ai rédigé ce mémoire. Soucieux de la réussite de mes travaux personnels, et plus
largement de ma formation, il m’a offert de commenter mes ébauches, s’informait
périodiquement de l’avancement du projet, et ne ménageait ses encouragements et ses
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
 174
174
 175
175
 176
176
 177
177
 178
178
 179
179
 180
180
 181
181
 182
182
 183
183
 184
184
 185
185
 186
186
 187
187
 188
188
 189
189
 190
190
 191
191
 192
192
 193
193
 194
194
 195
195
 196
196
 197
197
 198
198
 199
199
 200
200
 201
201
 202
202
 203
203
 204
204
 205
205
 206
206
 207
207
 208
208
 209
209
 210
210
 211
211
 212
212
 213
213
 214
214
 215
215
 216
216
 217
217
 218
218
 219
219
 220
220
 221
221
 222
222
 223
223
 224
224
 225
225
 226
226
 227
227
 228
228
 229
229
 230
230
 231
231
 232
232
 233
233
 234
234
 235
235
 236
236
 237
237
 238
238
 239
239
 240
240
 241
241
 242
242
 243
243
 244
244
 245
245
 246
246
 247
247
 248
248
 249
249
 250
250
 251
251
 252
252
 253
253
 254
254
 255
255
 256
256
 257
257
 258
258
 259
259
 260
260
 261
261
 262
262
 263
263
 264
264
 265
265
 266
266
 267
267
 268
268
 269
269
 270
270
 271
271
 272
272
 273
273
 274
274
 275
275
 276
276
 277
277
 278
278
 279
279
 280
280
 281
281
 282
282
 283
283
 284
284
 285
285
 286
286
 287
287
 288
288
 289
289
 290
290
 291
291
 292
292
 293
293
 294
294
 295
295
 296
296
 297
297
 298
298
 299
299
 300
300
 301
301
 302
302
 303
303
 304
304
 305
305
 306
306
 307
307
1
/
307
100%