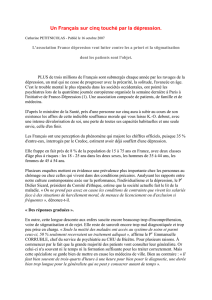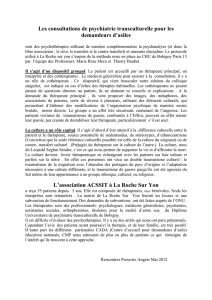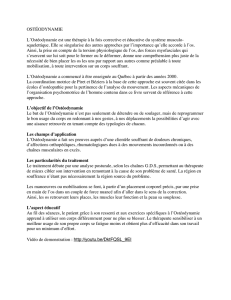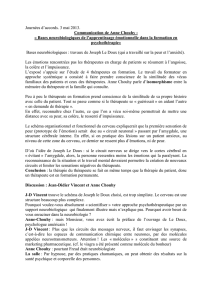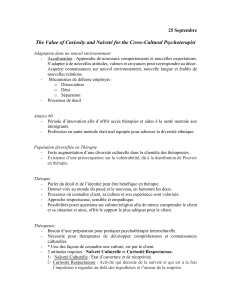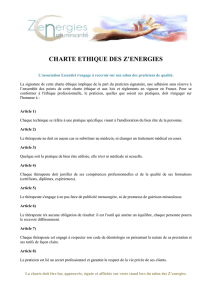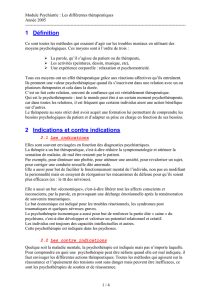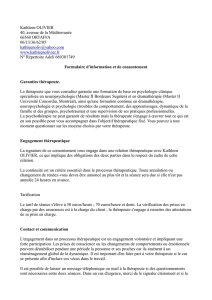La barrière au traitement comme facteur de sévérité de

© L’Encéphale, Paris, 2009. Tous droits réservés.
L’Encéphale (2009) Supplément 7, S314–S318
Disponible en lignesur www.sciencedirect.com
journalhomepage: www.elsevier.com/locate/encep
La barrière au traitement comme facteur
de sévérité de dépression
The treatment barrier as a severity factor in depression
L. Schmitt(a), E. Bui(b)
(a)(b) Service universitaire de psychiatrie et de psychologie médicale de Toulouse, hôpital de Casselardit Purpan
31059 Toulouse cedex
Résumé La barrière au traitement qualifie des obstacles au processus thérapeutique. Ces obstacles
concernent le patient ; il peut exister des cryptes mélancoliques lors de traumatismes enkystés ; on peut
retrouver un lien figé à une personne décédée sous la forme d’un cramponnement à l’objet interne ; il
existe différentes formes de masochisme moral.
Les barrières liées au thérapeute peuvent se retrouver chez les thérapeutes ayant une position
dogmatique ; le thérapeute doit percevoir ces contre-attitudes et ces mouvements d’impatience ou
d’irritation.
Dans l’interaction patient-médecin, la compréhension des échecs thérapeutiques antérieurs et du style
de relation noué avec les autres thérapeutes joue un rôle important ; la notion de réaction thérapeutique
négative où tout progrès clinique entraîne en retour une aggravation doit également faire l’objet d’une
investigation.
* Auteur correspondant.
E-mail : [email protected]
L’auteur n’a pas signalé de conits d’intérêts.
MOT CLES
Barrière au
traitement ;
Deuil ;
Masochisme ;
Contre-transfert ;
Réaction
thérapeutique
négative
KEYWORDS
Treatment barrier ;
Sorrow ;
Masochism ;
Counter-transfer ;
Negative therapeutic
reaction
Summary The term treatment barrier describes obstacles to the treatment process. These obstacles
affect the patient: there may be melancholic crypts in encysted trauma ; there may be a link rooted to
a dead person in the form of attachment to the internal object: there are different forms of moral
masochism.
Barriers relating to the therapist may be seen in therapists who take a dogmatic position: the therapist
must realise these counter-attitudes and their impatience or irritation movements.
In the patient doctor-interaction, understanding previous treatment failures and the relationship style
developed with other therapists plays an important role. The concept of the negative therapeutic
reaction in which any clinical progress returns to aggravation must also be investigated

La barrière au traitement comme facteur de sévérité de dépression S315
Plusieurs patients résistent au traitement biologique et
psychothérapeutique de la dépression. Cette résistance se
traduit par une amélioration partielle des symptômes ou
par des rechutes fréquentes. Alors que des traitements
pharmacologiques ont été bien conduits (avec des posolo-
gies d’antidépresseurs à doses efcaces pendant des durées
sufsantes, la pratique d’ECT, d’une vérication de l’obser-
vance médicamenteuse) le gain thérapeutique reste incom-
plet. Même lorsque l’on a repéré des traits de personnalité
comme l’impulsivité ou la présence de certains mécanis-
mes de défense immatures, cette identication n’aboutit
pas toujours à une amélioration thérapeutique.
Certains facteurs contribuent à créer des impasses thé-
rapeutiques dénies par une phase d’aggravation succé-
dant à de discrètes améliorations ou à des progrès minimes.
Cette situation a été dénommée par Scott [17,18] : la
« barrière au traitement » pour qualier les obstacles au
processus thérapeutique en lien avec les représentations
culturelles de la maladie mentale. Ce concept reste tou-
jours utilisé pour rendre compte d’oppositions au traite-
ment dans des contextes culturels particuliers [14], de
psychiatrie militaire [11], ou des situations pathologiques
particulières comme le cancer.
En matière de dépression sévère, l’idée d’une opposition
à l’amélioration clinique ou au soin réunit des aspects liés au
fonctionnement psychique du patient, des éléments issus de
son histoire antérieure tels que des traumatismes ou des suc-
cessions de thérapies, des éléments directement issus des
symptômes du patient tels le ralentissement et l’angoisse.
Enn, le contexte de l’interaction entre le patient et le thé-
rapeute peut entraîner des réactions thérapeutiques négati-
ves, sources de stagnation et de chronicité. Les classications
actuelles opèrent par dimensions et catégories ; elles laissent
de côté les aspects plus narratifs, contextuels ou imagés, qui
sont souvent utiles dans la compréhension et l’évolution de
certains cas sévères. Parce qu’elles relèvent plus de la méta-
phore, d’un scénario et d’un fonctionnement analogique, ces
approches sont difciles à objectiver et n’ont pas trouvé
place dans le DSM ou la CIM, à l’instar des névroses d’échec
et de destinée. Or, le repérage de ces constellations reste
indispensable pour comprendre des facteurs de résistance et
de chronicité et permettre de les aborder, même si leur trai-
tement demeure difcile, notamment en soin primaire [16].
La barrière thérapeutique liée au patient
« La crypte mélancolique »
Sous le terme de crypte mélancolique, Abraham et Torok [1],
ont décrit des traumatismes anciens, parfois durables, n’ayant
jamais fait l’objet d’une élaboration ou d’une prise en charge.
Ces traumatismes restent enkystés, comme une vésicule, dans
ce qui a été appelé une crypte mélancolique. Le contenu de
ces cryptes renferme souvent des traumatismes sexuels, des
attouchements ou des viols [19]. Il peut s’agir de traumatis-
mes physiques, de sévices, de coups. Enn, des éléments de
culpabilité pour des fautes réelles ou fantasmées, peuvent
également se retrouver. Ces traumatismes sont généralement
liés à des sentiments de honte, des vécus de faute, des per-
ceptions de culpabilité. Dans certains cas, ils ont été efeu-
rés. Le patient les a mentionnés mais de façon incidente, sans
les développer, leur approfondissement n’ayant pas été réa-
lisé. Dans d’autres cas, ils ont été soigneusement cachés, tus.
De manière formelle, on sait que des événements traumati-
ques sévères et cumulatifs favorisent les troubles de la
personnalité, au premier plan desquels les personnalités état-
limite. Lors de la prise en charge, il apparaît indispensable de
reprendre les circonstances des événements traumatiques,
leur vécu et leur retentissement à court et moyen termes.
Certaines cryptes restent si étroitement « défendues » qu’el-
les n’apparaissent que cachées derrière un premier souvenir
écran traumatique.
Gérard a fait la guerre d’Algérie ; il en a très peu parlé.
Lors de la guerre du Golfe, où il assiste aux images de
guerre dans le désert sur sa télévision, il débute une
dépression mélancolique résistant partiellement aux anti-
dépresseurs et à l’électro convulsivothérapie. Parmi les
événements de vie difciles qu’il décrit, on retrouve l’ar-
rachage d’une vigne plantée par son père et le sentiment
d’une culpabilité vis-à-vis de l’image de ce père décédé.
Ce n’est que tardivement que Gérard fera état d’actes de
torture, de sévices physiques qu’il a pu exercer sous ordre
de ses supérieurs quand il était militaire en Algérie et qui
ont parfois entraîné la mort. Il n’en a jamais parlé ; il en a
honte ; des images l’ont hanté. Ce souvenir reste caché
derrière les aspects de relation à son père.
« Le cramponnement à un objet interne »
Lorsque le processus de deuil se bloque, s’enraye, ceci
représente un facteur fréquent de dépression chronique ;
cet aspect a fait l’objet d’une relecture par Gédance [9],
depuis l’article initial de Freud sur le deuil dans la mélanco-
lie [7]. Le deuil concerne à l’origine une personne disparue
et, par un déplacement, une perte de fonction, de position
professionnelle, de richesse. Ces aspects sont source de
tristesse et de souffrance, de par la frustration, la décep-
tion et le sentiment d’abandon voire de rage qu’ils entraî-
nent chez celui qui les a perdus. La tristesse chronique,
l’idée de mort s’expliquent, le sujet ne se sent plus utile,
voire il se considère comme un « rien » en l’absence de ces
éléments. S’il accepte de renoncer à ces objets, au sens
large, il a l’impression d’être vide, creux, inexistant. Ces
liens de cramponnement à l’objet, prennent la place de son
être, de son moi. Ils ont une qualité narcissique qui donne
de l’énergie au sujet et qui domine les qualités propres de
la personne disparue ou de la situation. Ce lien à une per-
sonne qui l’a abandonné en mourant, à l’instar d’images
parentales, d’une relation sentimentale interrompue, d’une
situation professionnelle ou d’un conit, représente des
investissements narcissiques essentiels pour la personne.
Aude est une avocate reconnue dans son métier en
dépression sévère depuis le décès de son père, 3 ans aupa-
ravant. Ce père, pilote durant la guerre, héros de la résis-
tance a été fortement idéalisé. Aude et son frère cohabitent
dans la grande maison du père disparu. La succession
s’avère impossible du fait d’un conit sur le partage de la
maison entre son frère et elle. Ce conit réveille la riva-

L. Schmitt, E. BuiS316
lité frère-sœur mais il est surtout un garant de la persis-
tance des liens au père : tant qu’il n’est pas résolu, la
maison de famille reste invendable, le deuil du père ne
peut se réaliser, l’objet est maintenu dans le psychisme.
Ce cramponnement à l’objet relève à la fois d’une idéa-
lisation de celui-ci mais également d’aspects du narcis-
sisme. En effet, la place importante qu’à pris cet objet rend
compte d’un sentiment d’insufsance de sa valeur de base
et de difcultés pour trouver du plaisir à vivre en l’absence
d’un objet au sens large, vivre simplement pour soi. Plusieurs
psychothérapeutes s’attachent à approfondir et à dévelop-
per cette capacité à transformer en objet affectivement
attractif et revalorisant des personnes, des animaux, toutes
sortes d’activités ou de distractions culturelles. Ceci pour
contre-balancer et nuancer la dévitalisation induite par la
perte d’objet, source de vide et de perte de plaisir dans le
monde intérieur et extérieur. Dans une étude sur les prols
psycho-dynamiques de patients déprimés, Charitat et al.
[5], ont pu montrer des fortes perturbations de l’item
dépendance et séparation chez des patients déprimés hos-
pitalisés. Les patients ont du mal à avoir d’autres relations
que des relations anaclitiques de dépendance.
« Le masochisme moral »
Cette forme de masochisme est directement liée à un senti-
ment de culpabilité inconscient obligeant le sujet à renoncer à
toute forme de plaisir. Le masochisme est un phénomène à
plusieurs composantes dans lequel les patients semblent
excessivement prédisposés à la souffrance selon Nacht [13].
Cette prédisposition peut être liée à des exigences internes
trop sévères inhibant le patient dans sa quête du plaisir, de la
sexualité ou de gratications simples de l’existence : « les
petits riens de la vie ». Ces tendances masochistes compren-
nent un vécu chronique de honte ou de culpabilité mais aussi
une tendance à répéter des situations douloureuses, selon A.
Green [10]. Souvent l’observateur extérieur s’interroge devant
cette répétition de difcultés, de malchance ou de malheur
comme si un destin hostile avait maudit ces patients.
Françoise a été victime de coups et des colères mons-
trueuses et terriantes de son père jusqu’à l’âge de 10 ans.
Alors qu’elle allait se marier à l’âge de 22 ans, son futur
conjoint décède d’un accident d’automobile. Cinq ans plus
tard, Françoise choisit un compagnon sans domicile xe,
alcoolique qui la frappe et dont elle a un enfant âgé de
2 ans. Lorsque ce compagnon la quitte, alors qu’on la pen-
serait soulagée, elle installe une dépression profonde,
résistante à toute thérapeutique. L’évolution de Françoise
a longtemps stagné tant que les sentiments de culpabilité
dans le divorce de ses parents et dans la mort de son pre-
mier amour n’ont pu être évoqués.
Les barrières thérapeutiques liées
au thérapeute
« Les idéologues du soin »
Les idéologues du soin médicamenteux n’attribuent à la psy-
chothérapie qu’une place marginale ou résiduelle. Ils con-
nent la psychothérapie au champ de la psycho-éducation ou
de la psychothérapie de soutien. Quant aux idéologues de la
psychothérapie, ils considèrent les médicaments comme une
voie de guérison « rapide et supercielle ». La prise médica-
menteuse ferait l’économie de la compréhension de soi-
même, de ses interactions aux autres et de l’explication de
son vécu dépressif. Ces deux positions caricaturales, de
moins en moins retrouvées de nos jours, tiennent peu compte
de toutes les études du groupe de Pittsburgh dont celles de
Frank Kupfer et al. [6] qui ont montré que l’association trai-
tement antidépresseur et psychothérapie était toujours
supérieure à une stratégie unique.
On choisit deux exemples diamétralement opposés.
Devant un ralentissement, une insomnie matinale, un amai-
grissement, certains verront dans ces symptômes la certi-
tude d’un épisode dépressif majeur à caractère endogène
Ils penseront que seul un traitement antidépresseur aura
une réelle efcacité. Un deuil, une rupture sentimentale
inviteront d’autres thérapeutes à se centrer sur la dimen-
sion de perte d’objet, à travailler l’évolution du deuil ou
des pensées dysfonctionnelles, dichotomiques ou d’abs-
traction sélective. En un mot, ces idéologues du soin peu-
vent autant méconnaître les symptômes résiduels des
dépressions dont on sait qu’ils font le lit de la récidive ou
des aspects de psychogénèse manifeste. Cette idéologie du
soin peut être transposée au niveau institutionnel, les éta-
blissements hospitaliers ou les cliniques qui délibérément
rejettent une option thérapeutique ou une autre. À ne pas
vouloir considérer l’ensemble des facettes de la dépres-
sion, des formes d’interaction de soins se simplient à l’ex-
trême et méconnaissent la complexité clinique des troubles
de l’humeur ; ceci découle des travaux pionniers d’Andréoli
[3].
« Les contre-attitudes et les aspects contre-
transférentiels ».
Certaines personnalités histrioniques suscitent des réac-
tions défensives ou d’irritation chez les thérapeutes, au
point de mettre sur le compte de troubles ou traits de la
personnalité une symptomatologie dépressive sévère et
persistante. De façon analogue, certaines plaintes hypo-
chondriaques limitées à la seule souffrance corporelle ou à
la demande d’examens complémentaires peuvent occulter
une symptomatologie dépressive sous-jacente. Ces patients,
avec leur présentation de fatigue, de douleurs chroniques,
ou de focalisation sur leur transit digestif masquent incons-
ciemment des symptômes dépressifs. Le thérapeute res-
sent, devant cette plainte répétitive, un sentiment
d’irritation, d’ennui voire une forme d’agression. Il en va
de même pour des patients qui afrment ne pas être dépri-
més mais témoignent d’une pauvreté dans leur imaginaire.
Ils éprouvent des difcultés dans les liens entre les émo-
tions et les vécus, ils manifestent un intérêt prédominant
pour les faits, le concret, la réalité. Ce type de fonctionne-
ment, qualié d’opératoire à la suite de P. Marty et al.
[12], peut s’accompagner d’une symptomatologie dépres-
sive à plusieurs facettes. On a pu parler de double dépres-
sion pour évoquer une dépression essentielle ou une

La barrière au traitement comme facteur de sévérité de dépression S317
personnalité dépressive avec des symptômes dépressifs
surajoutés [15]. L’écoute de ces patients fait parfois surgir
une impression d’ennui tant leurs propos demeurent dans
une banalité et des dimensions concrètes.
« L’indisponibilité du thérapeute »
Lorsque plusieurs options médicamenteuses ou psychothé-
rapeutiques ont été épuisées, le thérapeute peut se laisser
envahir par l’idée que la situation clinique reste sans issue.
L’écoute du patient peut se relâcher, les capacités associa-
tives se tarissent, l’impression que le « patient dit toujours
la même chose et que l’on tourne en rond » s’étoffe. Dans
ces circonstances, selon les cas la discussion entre un autre
avis clinique ou une supervision de pratique mérite d’être
évoquée. La fréquence des rendez-vous tend à s’espacer, le
psychiatre redoute ce patient qui va toujours mal. Il peut
s’en défendre en passant la main.
La barrière dans l’interaction
patient-médecin
L’anamnèse des échecs thérapeutiques antérieurs.
Certains patients ont expérimenté plusieurs thérapeutes.
Lorsqu’on leur demande leur opinion, celle-ci témoigne du
type d’interaction noué avec ces thérapeutes : « trop silen-
cieux… il ne m’écoutait pas… il semblait un peu paterna-
liste… ne faisait que m’encourager… il m’a fait des avances…
il n’allait pas au fond de mes difcultés… ». Lorsqu’aucun
thérapeute n’a trouvé grâce aux yeux d’un patient, on peut
légitimement se poser la question d’un trouble de la per-
sonnalité et de mécanismes de défense à caractère narcis-
sique ou interprétatifs. Des mécanismes projectifs ou
faisant intervenir l’agressivité passive peuvent se rencon-
trer. Certains patients expriment leur souffrance au travers
d’une passivité ou dans des propos de disqualication ou de
thèmes désabusés. Dans les aspects de projection, ils
redoutent une dépendance vis-à-vis de leur thérapeute ou
de leur thérapeutique. À ce titre, ils ne lui font pas
conance ou ne prennent qu’en partie leur traitement.
Cette question de la dépendance à une relation thérapeu-
tique ou à un médicament prend un relief tout particulier
chez des sujets dont l’éducation a valorisé l’autonomie ou
bien dont les relations familiales ont été empreintes d’auto-
rité.
La réaction thérapeutique négative.
Elle dénit une résistance à la guérison ou une situation où
chaque amélioration suscite une aggravation. Elle à fait
l’objet d’une description par Freud [8] dans Le moi et le
ça : « toute résolution partielle qui devrait avoir pour
conséquences – et qui l’a réellement chez d’autres – une
amélioration ou une disparition passagère des symptômes,
provoque un renforcement momentané de leur souffrance ;
leur état s’aggrave au cours du traitement au lieu de s’amé-
liorer. » Il semble que la maladie fonctionne comme un
bénéce au service de réactions de culpabilité. Ces contex-
tes de réactions thérapeutiques négatives comportent un
attachement à un statut de victime, un sentiment d’être
une exception, une crainte de la dépendance ou de soumis-
sion à une instance thérapeutique rappelant celle des
parents. Parmi les conséquences de ces réactions théra-
peutiques négatives, il faut citer les abandons inopinés des
traitements médicamenteux et des rendez-vous ou bien le
développement en cours de traitement de conduites néfas-
tes allant de la prise de risque aux alcoolisations à des pri-
ses de toxiques.
Le repérage de ces aspects de barrière thérapeutique
passe par l’existence de capacités d’empathie du théra-
peute. Cette empathie autorise la prise en compte des élé-
ments narcissiques sans être par trop blessé ou atteint par
les éléments hostiles qu’exprime le patient. L’expression
de sentiments profonds parfois déniés par le patient, le
dégagement de celui-ci de positions masochiques ou se
maintient sa douleur, l’acceptation de compromis réalistes
lui permettra de jouir d’éléments plus simples de l’exis-
tence [2].
En conclusion :
La barrière au traitement se révèle un phénomène virtuel,
éminemment inter-subjectif puisque ces composantes tien-
nent au patient, au thérapeute et à l’interaction des deux.
Dans les dépressions sévères, cela se traduit par un com-
plexe de résistance au soin, au changement ou à l’amélio-
ration et par des réactions thérapeutiques négatives. Cette
barrière au traitement relève d’un système à forte entro-
pie tendant à se maintenir à l’identique selon Andreoli [3].
Mais en repérer certaines des facettes permet de réduire et
de limiter certains facteurs de chronicisation ou de répéti-
tion symptomatique à l’origine de la sévérité des états
dépressifs.
Bibliographie
[1] Abraham N, Torok M. L’écorce et le noyau Paris : Flammarion ;
1987.
[2] Ambresin G, De Coulon N, De Roten Y et al. Psychothérapie
psychodynamique brève de la dépression pour patients hospi-
talisés. Psychothérapies 2009 ; 19 n° 2 : 75- 84.
[3] Andréoli A. Un point de vue psychanalytique sur le rôle de la
psychothérapie en situation de crise. Psychothérapies 2001 ;
21 n° 2 : 75-87.
[4] Busch N, Ruden M, Shapiro T. Psychodynamic treatment of
depression. American Psychiatric Publishing, Inc 2004.
[5] Charitat H, Bloch-jacquot F, Veisblat et al. Profils psychody-
namiques de patients déprimés. L’Encéphale 1999 ; sp 1 : 17
–21.
[6] Frank. E, Novick. D, Kupfer D.J. Antidepressants and psycho-
therapy : a clinical research review. Dialogues clin Neurosci
2005 ; 7 (3) : 263-272.
[7] Freud S. Deuil et mélancolie (1915) Métapsychologie. Paris :
Gallimard idées.
[8] Freud S. Le moi et le ça (1923). Essais de psychanalyse. Paris :
Collection Prismes Payot ; 1987.
[9] Gédance D. Le travail psychanalytique dans les dépressions.
Psychothérapies 2007 ; 27 n° 4 : 221-230.
[10] Green A. Narcissisme de vie, Narcissisme de mort. Collection
critique. Paris : Les Éditions de Minuit ; 1983.

L. Schmitt, E. BuiS318
[11] Hoge CW, Castro CA, Messer SC et al. Combat duty in Irak and
Afganistan, Mental Health Problems and barrier to care. New
England Journal of. Med. 2004 ; 351, 1 : 13-22.
[12] Marty P, de M’Uzan M. « La pensée opératoire ». Revue Fran-
çaise de Psychanalyse 1963 ; 27 n° spécial : 345–356.
[13] Nacht S. Le masochisme moral in : Le masochisme Petite bib-
liothèque. Paris : Payot ; 71 : 73-110.
[14] Nasir LS, Al Qutob R. Barriers to the diagnosis and treatment
of depression in Jordan. À nationwide qualitative study. J Am
Board Fam Pract 2005 ; 18 : 125-131.
[15] Philipps KA, Gunderson J.G, Hirschfeld RM.A et al. A review of
the depressive personality. Am J Psychiatry 1990 ; 147 :
830-837.
[16] Schwenk TL, Evans D.L, Laden S.K et al. Treatment outcome
and physician patient communication in primary care patients
with chronic recurrent depression. Am J Psychiatry 2004 ;
161 : 1892-1901.
[17] Scott RD. The treatment barrier. Part 1. Br. J. Med. Psychol.
1973 ; 46 : 45-55.
[18] Scott RD. The treatment barrier Part 2 - The patient as an
unrecognized agent. Br. J. Med. Psychol., 1973 ; 46 : 57-67
[19] Vitriol V G, Ballesteros S.T, Florenzano R.U et al. Evaluation
of an outpatient intervention for women with severe depres-
sion and a history of childhood trauma. Psychiatric services
2009 ; 60 : 936-942.
1
/
5
100%