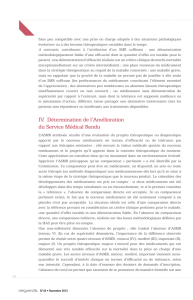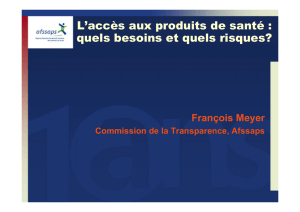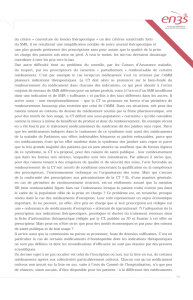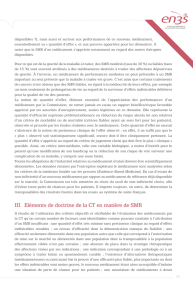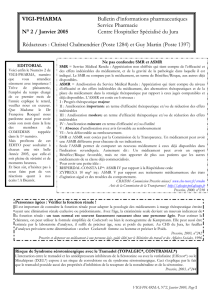Révision des critères d`évaluation des produits de santé en vue de

Inspection générale
des affaires sociales
Muriel DAHAN
Conseillère générale des
établissements de santé
Révision des critères d'évaluation des produits
de santé en vue de leur prise en charge par
l'assurance maladie
Analyse de l'Index thérapeutique relatif (ITR)
proposé par la HAS
Mission d'appui à la Direction de la sécurité sociale
Établi par
RAPPORT
- Octobre 2013-
2013-099R

2 IGAS, RAPPORT N°2013-099R

IGAS, RAPPORT N°2013-099R 3
SYNTHESE
Le médicament et les dispositifs médicaux ont fait l’objet ces dernières années de nombreux
débats et réflexions ayant conduit à reconsidérer les fondements de leur parcours de mise sur le
marché, au niveau national autant qu’européen. En particulier, l’exigence d’études comparatives
s’impose dorénavant pour tous les médicaments susceptibles de représenter un progrès
thérapeutique, dans un contexte général de recherche d’efficience. Les critères d’évaluation des
médicaments en vue de leur prise en charge par les organismes d’assurance maladie, en France
comme dans d’autres pays, doivent ainsi évoluer vers une approche d’emblée comparative. La
dualité des actuelles cotations nationales « service médical rendu » (SMR) et « amélioration du
service médical rendu » (ASMR) réalisées par la commission de la transparence (CT) de la Haute
autorité de santé (HAS) a été récemment réinterrogée afin de mieux suivre ces nécessaires
évolutions, en simplifier la compréhension et en améliorer la reproductibilité et la prédictibilité.
La HAS a construit un projet d’indicateur unique, baptisé « Index Thérapeutique Relatif »
(ITR), pour répondre à ces objectifs et prendre en compte les expériences de ses homologues
européens, ainsi que les travaux communs en cours dont elle pilote certains volets. Afin
d’envisager l’opportunité et les conditions d’un éventuel changement de critère, la ministre des
affaires sociales et de la santé à demandé au chef de l’IGAS de mandater une courte mission
d’appui à la Direction de la sécurité sociale. Muriel DAHAN, désignée pour cette mission, a
consulté les experts et institutions intervenant dans le processus et a organisé, avec des membres de
la commission de la transparence et des représentants du ministère, un séminaire d’application
pratique de l’ITR sur une liste de médicaments établie selon des critères définis. Le résultat a été
soumis au Comité économique des produits de santé (CEPS). Les caisses d’assurance maladie et
les industriels ont été invités à débattre également sur le sujet. L’application aux dispositifs
médicaux s’est révélée prématurée et devra faire l’objet de travaux ultérieurs.
Le principal enseignement à tirer de cette enquête est qu’une réforme est nécessaire,
mais qu’elle n’est pas urgente et ne doit surtout pas être brutale.
Elle est nécessaire pour les principales raisons suivantes :
Les critères actuels SMR et ASMR s’avèrent bien maîtrisés par la CT, mais leur signification
respective n’est pas toujours claire en aval, pour les prescripteurs, dispensateurs et patients.
La place de l’intérêt de santé publique est confuse et le lien avec la médico-économie peu
précis. L’ASMR apparait plus clairement significatif de progrès thérapeutique, mais les
critères de son évaluation ne sont pas clairement énoncés. De plus, le SMR semble
aujourd’hui peu discriminant, la gravité de la pathologie étant souvent le critère le plus
décisif, en particulier pour orienter l’UNCAM vers une décision de taux de prise en charge ;
L’exigence d’approche comparative a conduit d’une part l’Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé (ANSM) à évoluer dans ce sens pour l’évaluation et la
réévaluation du rapport bénéfices-risques en vue de l’autorisation de mise sur le marché,
d’autre part la CT à élaborer et mettre en œuvre une doctrine tendant à placer l’ensemble de
son évaluation dans une mise en perspective de l’existant. Dès lors, les critères du SMR
peuvent être réattribués et l’ASMR « enrichi » pour devenir un critère unique, plus clair et
compréhensible ;
Le travail réalisé par la HAS pour construire l’ITR permet de s’orienter vers des critères
rigoureux, reproductibles, s’approchant de ceux qu’utilisent les homologues européens,
affichant les mêmes exigences pour le développement des médicaments et les preuves à
apporter pour justifier l’amélioration thérapeutique revendiquée.

4 IGAS, RAPPORT N°2013-099R
Elle n’est pas urgente et ne doit pas être brutale car :
La démarche ITR doit encore être affinée pour devenir moins rigide, laissant plus de place à
la nécessaire modulation en fonction de l’alchimie propre à chaque produit, qui rend non
pertinente une démarche trop technique et nécessite les débats d’experts que conduit
aujourd’hui la commission de la transparence ;
Elle doit pouvoir s’appliquer à tous les médicaments, ce qui n’est pas le cas ;
Elle doit s’enrichir de critères que pour l’heure elle n’intègre pas clairement, en particulier la
place dans la stratégie thérapeutique et la qualité de vie ;
La réforme doit être placée dans le cadre d’une réflexion plus globale sur le panier et les
parcours de soins, qui n’était pas l’objet de la mission ;
Elle ne peut en tout état de cause être mise en œuvre du jour au lendemain. Elle nécessite une
période de transition suffisamment longue pour que le « stock » des anciens produits fasse
l’objet d’une réévaluation selon la méthode ITR et que le « flux » des nouveaux aient été
évalués selon les mêmes critères, afin que les comparaisons soient pertinentes et non
contestables.
Compte tenu de ces constats, la mission formule 5 recommandations :
1) Dessiner dès l’installation de la nouvelle commission de la transparence une trajectoire
de réforme visant, en tirant parti des travaux de la HAS sur l’ITR, à enrichir et affiner le
concept et le contenu d’un critère unique, pour lequel la mission formule trois
propositions d’appellations : Intérêt Thérapeutique Relatif (maintien de l’acronyme
proposé par la HAS) ou Valeur Thérapeutique Ajoutée (VTA, utilisée au niveau
européen) ou Amélioration Thérapeutique Relative (ATR). L’avis rendu détaillant, selon
un modèle-type à élaborer, tous les sous-critères sera indissociable de la cotation,
progressive de 1 à 5 (5 étant la « meilleure » note). Le caractère habituel de gravité de la
pathologie et/ou la sévérité des symptômes visés par le médicament soumis permettra
une orientation vers une décision de taux de remboursement. La mission propose un
schéma, bien sûr perfectible, tirant les enseignements des améliorations à apporter à la
démarche ITR actuellement formulée.
2) Adapter la méthodologie aux situations pour lesquelles elle n’est pas à ce stade
applicable (au moins orphelins, stades avancés, pédiatrie, gériatrie, génériques et
biosimilaires, médicaments associés à un dispositif médical).
3) Prévoir une mesure législative, dans le PLFSS pour 2016, prévoyant une période de
transition d’au minimum 2 ans.
La mission propose un échéancier de mise en œuvre, qui devra bien sûr être adapté en
fonction de l’avancée des travaux de la CT.
4) Redonner à l’intérêt de santé publique son sens premier : ne pas l’appliquer à tous les
médicaments et distinguer l’impact sur les politiques de santé publique de celui sur
l’organisation des soins. La mission propose d’en confier à la DGS un volet précis : pour
les primo-inscriptions, sélectionner les médicaments relevant d’une évaluation de leur
impact éventuel sur les politiques et plans de santé publique, et piloter cette évaluation
associant la DSS, la DGOS, le HCSP et des experts en tant que de besoin, en vue d’un
éclairage sur ce champ de la décision ministre. Trois conditions sont cependant à poser :
que le processus soit centré sur certains médicaments, que l’investissement de la DGS
soit réel et que la décision soit rapide et n’ajoute pas de délai supplémentaire.
D’autre part, la Commission d’évaluation économique et de santé publique (CEESP) de
la HAS sera chargée d’évaluer, en primo-inscription l’impact sur l’organisation des
soins, puis de réévaluer l’ISP après une période d’utilisation en vie réelle.

IGAS, RAPPORT N°2013-099R 5
5) Donner plus de visibilité, en particulier pour les membres de la CT et de la CEESP, aux
possibilités ouvertes par « l’article 56 » (article L.162-17-2-1 du code de la sécurité
sociale), dont il faut à nouveau confier la maîtrise à la HAS, et les recommandations
temporaires d’utilisation RTU pour moduler le remboursement et le prix d’un
médicament, en particulier dans des indications concernant des populations restreintes.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
1
/
53
100%