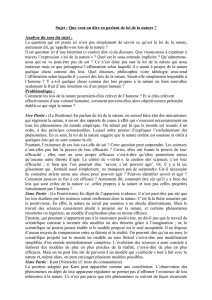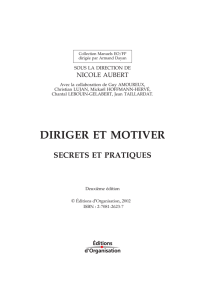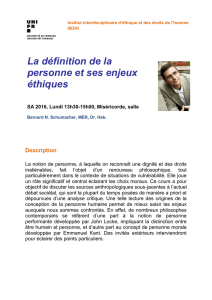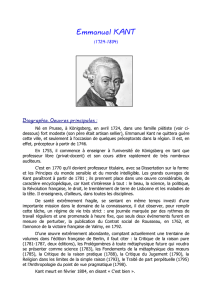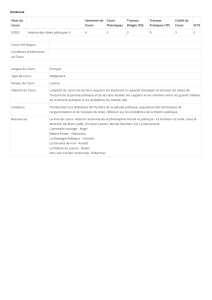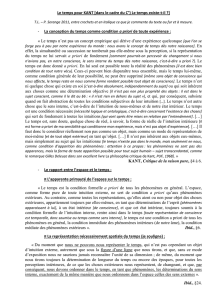Origine/ Fondement

Origine/
Fondement
I. Définitions
•
Origine
• Du Latin originis: « apparition », « naissance ». Principe, raison
d’être de quelque chose.
• Commencement, cause ou raison d'un processus, réalité
antérieure dont dérive un objet par transformation.
• Fondement
• Ensemble des éléments qui assure la consistance, la validité et,
par suite la pérennité d'une oeuvre ou d'un concept.
II. Pour Approfondir
• L'origine, c'est le point de départ chronologique d'un processus ; le
fondement, c'est le point de départ logique. Le fondement aide à
déterminer la source de l'existence ou/et de l'essence. Alors que
l'origine permet d'expliquer un phénomène en se référant à sa
genèse (historique).
• Le fondement a un double sens : il est à la fois commencement
logique est instance de légitimation. On utilise donc cette distinction
notamment dans le domaine de la connaissance (qu'est-ce qui
fonde telle connaissance, tel raisonnement ?).
• L’origine de la connaissance
!"En théorie de la connaissance, la question de l’origine est centrale
tout au long de la période classique. À partir du moment où la
connaissance fut considérée comme l'œuvre d'un sujet, comme le
produit de l'esprit (de l'«entendement») humain, la question de
l'origine du savoir fut placée au centre des investigations
philosophiques. Deux conceptions majeures s'opposent dans ce
domaine : celle des empiristes (Locke) et celle des rationalistes
(Leibniz).
!"Dans son Essai sur l'entendement humain, Locke soutient la thèse
selon laquelle l'esprit connaissant est initialement une «table rase»
(un tableau vierge sur lequel rien n'est encore écrit) et qu'il est
informé exclusivement par l'expérience sensuelle: l'impact des
objets sur le corps. Ainsi, la sensation est à l'origine de toutes les
idées simples ou abstraites et la réflexion de l'esprit sur ses propres
opérations intervient seulement comme une source de
connaissances secondaire.
!"L'existence des connaissances innées est réaffirmée par Leibniz qui
s'oppose à Locke dans les Nouveaux Essais sur l'entendement
humain. Sans nier le rôle de l'expérience, il affirme cependant que
celle-ci ne peut jamais fournir une justification au caractère
nécessaire et universel reconnu par chacun aux principes logiques
ou aux vérités fondamentales de l'arithmétique. De même, la
sensation ne peut rendre compte de la capacité de l'homme à
penser des notions purement abstraites, immatérielles. Toutefois,
les idées «innées», que l'esprit tire en quelque sorte de lui-même, ne
sont pas définies par Leibniz comme des connaissances
préexistantes et achevées, mais comme des règles qui
prédéterminent l'acquisition du savoir. L'inné apparaît donc comme
une virtualité et une forme, comparable à une programmation dans
le domaine de l'informatique. Au demeurant, la conception moderne
d'un code génétique est tout à fait leibnizienne dans son esprit.
•
Le fondement de la connaissance
!"La théorie de la connaissance de Kant : L'œuvre de Kant (Critique
de la raison pure) marque le passage à l'autonomie de la théorie de
la connaissance. Il distingue soigneusement le commencement et le
fondement en ce qui concerne nos connaissances: elles
commencent avec l'expérience mais elles n'en dérivent pas toutes
(«Toute connaissance commence avec l’expérience, cela ne
soulève aucun doute »). Tout en retenant le raisonnement de
Leibniz, selon lequel l'expérience est insuffisante à légitimer les
connaissances universelles et nécessaires, Kant récuse la notion
métaphysique d'innéité (selon Descartes, Dieu est le seul auteur
des idées innées déposées dans l'esprit humain et des lois du
monde objectif), à laquelle il substitue celle d'a priori : une
connaissance qui ne provient pas de l'expérience, mais qui la rend
possible. Ainsi sont a priori la notion d'espace (indispensable pour
penser la rectitude dans la géométrie élémentaire) et la notion de
temps (requise pour saisir le mouvement dans la mécanique
rationnelle), tout comme les concepts que Kant appelle catégories
(quantité, qualité, relation et modalité). C'est donc dans le savoir
scientifique que le philosophe isole les éléments a priori, qui font
partie de la structure de la raison et rendent possible la
connaissance en ordonnant les données empiriques (a posteriori).
!"Fondement transcendantal de la connaissance : Pour Kant, le
fondement de la connaissance n'est ni métaphysique
(transcendant), ni empirique (génétique), mais transcendantal (ce
terme désigne la connaissance qui porte sur elle-même, c'est-à-dire
sur les méthodes a priori qui rendent possible toute connaissance.
Dans sa théorie, l'entendement ne peut rien connaître qui ne lui soit
d'abord apporté par l'intuition sensible. Mais puisque celle-ci ne
permet de représenter dans les formes spatio-temporelles que les
objets singuliers, l'homme connaît seulement les objets de
l'expérience: les phénomènes, c'est-à-dire les choses telles qu'elles
apparaissent à l'esprit humain, et non pas telles qu'elles sont en soi.
Car l'a priori étant seulement la condition de l'expérience, il ne peut
en aucun cas donner accès à un monde intelligible
Editeur : MemoPage.com SA ©/2006/Auteur : Mathilde Crépineaud/Expert : Julie Poulain
1
/
1
100%