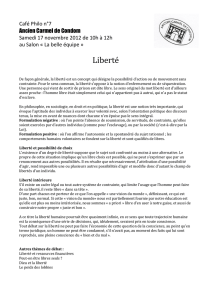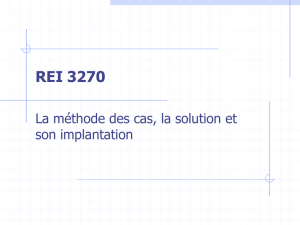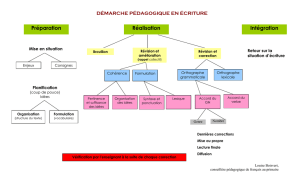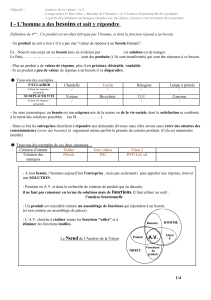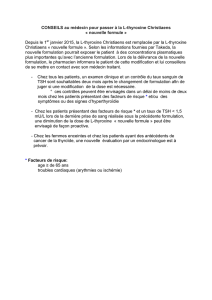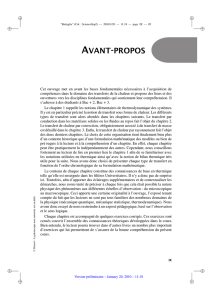La définition comme procédé stratégique

Working Paper no. 2015/2
La définition comme procédé
stratégique
Stefan Goltzberg
Working Paper no. 2015/6

Working Paper no. 2015/2
La définition comme procédé stratégique
1
Stefan Goltzberg
Chargé de Recherches au Fonds National de la Recherche Scientifique,
Centre Perelman de philosophie du droit, Université Libre de Bruxelles
Publié initialement dans Lefebvre (dir.), DICODEX. Réflexions sur les définitions juridiques codifiées,
Ceprisca, Coll. « Colloques », pp. 141-155.
Imaginez quelqu’un qui est poursuivi pour s’être produit nu dans l’espace publique. Il
invoquerait pour sa défense la définition légale de la nudité : « Est nu, aux fins du présent article,
quiconque est vêtu de façon à offenser la décence ou l’ordre public. » À présent, admettons que
l’auteur des faits dise que comme il était nu, totalement nu, son état ne tombe pas sous la définition
de la nudité, puisque est nu « quiconque est vêtu de façon à offenser la décence ou l’ordre public ».
Plusieurs réactions sont envisageables face à une telle argumentation. Premièrement, vous pourriez
vous dire que ce cas est une pure fiction – à tort, puisque ce cas est directement inspiré d’un cas
réel, l’arrêt R. contre Verrette, sur lequel Mathieu Devinat a attiré notre attention. Ensuite, vous
pourriez considérer que déduire une absence de nudité du fait que l’on n’est pas nu au regard de la
loi, relève d’une argumentation inadmissible, immorale. Nous nous garderons bien de juger ainsi
cette utilisation de la définition légale : au contraire, nous allons montrer combien ce cas – tout
effarant qu’il paraisse – illustre en réalité particulièrement bien un des aspects de l’argumentation
juridique, le rapport stratégique au texte. Nous reviendrons plus bas à cet exemple. Il importe de
souligner que les définitions abondent en droit – comme le montre à l’envi le projet DICODEX,
qui a identifié plus de 6 000 définitions dans les codes français.
1
Je tiens à remercier Jennifer Nigri d’avoir relu ce texte.

Working Paper no. 2015/2
D’une part les sources législatives contiennent de nombreuses définitions de termes aussi variés
que « tracteur agricole
2
», « animal mordeur
3
», ou « nuit
4
». D’autre part, des définitions
proviennent d’autres sources, que ce soit la jurisprudence ou la doctrine. À ces deux types de
définitions juridiques s’ajoutent les définitions du dictionnaire, auxquelles recourent parfois les
tribunaux.
Outre le nombre impressionnant des définitions, on peut relever le fait que ces définitions ne sont
pas toujours utilisées avec vraisemblance ; elles sont exploitées parfois au détriment du bon sens
ou du moins de ce que l’on aurait pu raisonnablement prévoir. Il faut se rendre à l’évidence :
produire des définitions, qui plus est au sein de la loi, c’est faire le pari que les définitions
engendreront les effets souhaités. C’est toujours également courir le risque de voir ces définitions
détournées de leur finalité : définir, pour le législateur, c’est confier à la définition une mission, qui
consiste notamment à assurer une prévisibilité juridique, tout en sachant que le producteur de la
définition ne peut jamais tout prévoir de la vie et du parcours de cette définition. D’une manière
générale, ce qui est vrai des définitions l’est des règles juridiques : elles captent de nombreux cas,
mais comme le législateur ne saurait tout prévoir, on sait à l’avance qu’il y aura des « ratés », des
situations qui tomberont dans la définition alors que manifestement le législateur, s’il était présent,
les en aurait exclues. Inversement, les définitions ne capturent pas toutes les réalités que le
législateur, s’il était présent, aurait incluses dans la définition (Schauer 1991 : 131-132).
Nous aborderons la question de la définition en droit en deux temps. Premièrement, il sera
question du déclin supposé du modèle antique de la définition, celui d’Aristote. Ce déclin sera décrit
d’un point de vue général, puis plus particulièrement dans le monde du droit. Deuxièmement,
nous nous risquerons à une réhabilitation de la définition, y compris de son modèle aristotélicien
modifié. À cette fin, nous scruterons la nature du discours juridique et son incidence sur la nature
et le fonctionnement de la définition en droit, puis nous poserons des limites aux limites de la
définition.
2
Tracteur agricole : « véhicule [agricole] à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux et une vitesse
maximale par construction égale ou supérieure à 6 km/h, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance
de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains équipements
interchangeables destinés à des usages agricoles ou tracter des véhicules remorqués agricoles », art. R. 311-1 du
code de la route.
3
Animal mordeur : « tout animal sensible à la rage qui :
(a) En quelque lieu que ce soit, a mordu […] une personne ;
(b) Ou dans un département officiellement déclaré infecté de rage, a mordu […] soit un animal domestique, soit un
animal sauvage apprivoisé ou tenu en captivité ;
(c) Ou dans un département indemne de rage, a mordu […] soit un animal domestique, soit un animal apprivoisé
ou tenu en captivité, et provient depuis une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de
l’agriculture, d’un département officiellement déclaré infecté de rage, ou d’un pays atteint d’enzootie rabique »,
art. R. 223-25 du code rural et de la pêche maritime.
4
Nuit : « temps qui commence une heure après le coucher du soleil et finit une heure avant son lever », art. L. 429-
19 du code de l’environnement.

Working Paper no. 2015/2
Section I – Déclin du prestige de la définition
Aristote a forgé un modèle de la définition très articulé, nuancé et prudent. Toutefois, ce modèle
souvent caricaturé a été battu en brèche par des générations de penseurs. Cette érosion gagne à
être étudiée en elle-même puis au regard du droit.
§ 1 : Érosion du modèle aristotélicien
Aristote a légué une théorie de la définition plutôt forte, que l’on peut résumer par les dix traits
suivants, que nous expliciterons ensuite : la définition est structurée en genre prochain et
différence spécifique, elle est unique, universelle, essentielle, brève, littérale, non circulaire,
composée de termes antérieurs et plus clairs, elle permet la substitution salva veritate et contient les
conditions nécessaires et suffisantes. La définition était pour lui le socle sur lequel s’élaborait toute
science. Or, l’histoire des théories de la définition est constituée des notes en bas de pages à l’œuvre
d’Aristote, pour paraphraser Whitehead, qui s’exprimait à propos de Platon. Chacune des dix
caractéristiques attribuées à la définition par Aristote a été remise en question par la tradition
philosophique. Le vingtième siècle voit même la définition devenir un objet de dérision, de mépris,
car elle n’aurait pas intégré les révolutions philosophiques ayant progressivement fait éclater tout
le cadre dont la notion même de définition était solidaire.
Sans se livrer à un historique exhaustif des avatars de la théorie aristotélicienne de la définition,
voici quelques-uns de ses moments marquants.
Exposons dans un premier temps la théorie aristotélicienne. La définition est structurée en genre
prochain et différence spécifique, dont l’exemple paradigmatique est L’humain est un animal politique.
« Animal » est le genre prochain, c’est-à-dire la catégorie directement supérieure. Si l’on avait défini
l’humain comme un être politique, « être » n’aurait pas possédé le caractère prochain du genre, car
trop éloigné. Idéalement, la définition serait unique, bien qu’Aristote lui-même semble avoir donné
plusieurs définitions de certains termes. La définition est universelle, plus précisément, elle est un
universel, c’est-à-dire qu’elle se dit de plusieurs. D’autres universels sont : le genre (par exemple
« l’humain est un animal »), le propre (« l’homme rit ») et l’accident (« Socrate est assis »). À l’inverse,
« Socrate » ne se dit pas de plusieurs, puisque, en tant que nom propre, il se dit d’un seul. La
définition est essentielle, elle ne vise pas n’importe quelle caractéristique, mais celles qui relèvent de
l’essence de la chose. Ainsi, bien que « bipède sans plume » soit une description sous laquelle
tombent les humains, elle ne vise que des aspects non essentiels, car ils ne disent pas la nature de
la chose définie. En outre, la définition doit être brève : il n’est aucunement question d’appeler
définition une description qui s’étendrait sur de nombreuses pages, quelles que soient sa précision
et son exactitude. La définition sera littérale et évitera, dans la mesure du possible les descriptions
métaphoriques. Il convient qu’elle soit dépourvue de circularité, c’est-à-dire que la définition ne
contienne pas le mot à définir (« l’humain est un animal humain »), sous peine de commettre une
pétition de principe. Elle sera composée de termes antérieurs et plus clairs : elle ne contiendra pas de
termes qui ne sont définissables que par elle ni de termes inutilement obscurs.

Working Paper no. 2015/2
La définition permettra la substitution salva veritate, c’est-à-dire que partout où le terme « humain »
apparaît, il devrait être possible de le remplacer par sa définition « animal politique » sans modifier
la vérité de l’énoncé (salva veritate). Si la vérité de l’énoncé devait s’en trouver modifiée, ce serait le
signe d’une définition erronée. Enfin, la définition contiendra les conditions nécessaires et suffisantes ;
si elle contenait des conditions nécessaires et non suffisantes, par exemple le genre prochain
(animal) sans la différence spécifique (politique) ou inversement, la définition serait trop large et
inclurait des éléments non voulus, comme la girafe, qui est un animal mais pas un animal politique.
Chacun de ces dix traits a fait l’objet d’une récusation, dont voici une synthèse.
1. Genre prochain et différence spécifique. Cette exigence est tributaire d’une cosmologie
aristotélicienne qui a fait long feu et où chaque espèce (humain) ne possède qu’un genre
prochain (animal). Or, pour plus d’une espèce tel n’est pas le cas. Plusieurs auteurs,
dont Rickert, ont considéré que le rejet de la cosmologie d’Aristote entraînait eo ipso
celui de sa théorie de la définition.
2. Unicité. Alors que classiquement, l’existence de plusieurs définitions signe la présence
d’une erreur, Aristote lui-même, suivi par Guillaume d’Occam, a accrédité l’idée que
certaines notions sont susceptibles de plusieurs définitions. Aujourd’hui, ce point fait,
semble-t-il, l’unanimité.
3. Universalité. La querelle des universaux (ce qui se dit de plusieurs) oppose notamment
les nominalistes selon lesquels les universaux ne sont que des noms renvoyant aux
individus et à nulle autre entité supra-individuelle – et les réalistes selon lesquels
l’universel renvoie en outre à une réalité supra-individuelle. Aristote retient quatre
universaux (genre, propre, définition et accident). Son commentateur Porphyre (234-
310) modifiera cette liste, supprimant la définition. Une autre décision (le maintien de
la définition dans la liste) aurait sans doute consolidé le rôle de la définition dans
l’histoire des idées.
4. Essence. L’essence est une notion très chargée, qui suppose quelque chose de sous-
jacent, de préexistant, voire d’éternel. Il n’est guère étonnant que cet aspect de la vision
d’Aristote ait été remis en question par de nombreux auteurs, notamment Al-Kindi,
Isidore de Séville, Occam, Bacon, Hobbes et Popper.
5. Brièveté. Selon Cicéron et Mill, il est légitime que la définition n’obéisse pas à une
exigence de brièveté.
6. Littéralité. Ce n’est pas seulement la définition mais tout le langage dont plusieurs
auteurs ont entendu montrer qu’il ne pouvait pas atteindre la littéralité. Celle-ci serait,
selon Vico, Rousseau et Nietzsche le résultat de métaphores usées, endormies, dont le
sens métaphorique aurait pâli. Il en résulterait que nous appelons littérales uniquement
les expressions dont nous avons perdu la signification d’origine, nécessairement
métaphorique.
7. Non-circularité. Le principe d’après lequel le cercle est une erreur d’argumentation est
tempéré par cette idée astucieuse d’après laquelle il y aurait, au côté de la circularité
vicieuse, une circularité vertueuse. Heidegger, Gadamer et d’autres théoriciens inspirés
par l’œuvre de Schleiermacher affirmeront la nécessité d’un cercle herméneutique.
8. Termes antérieurs et plus clairs. L’impossibilité ou du moins l’extrême difficulté de s’en
tenir à cette exigence de clarté et d’antériorité des termes a été mise en lumière
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%