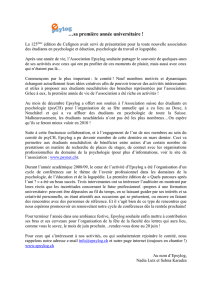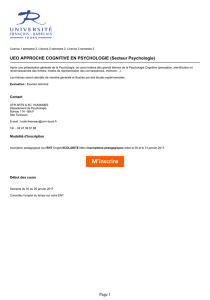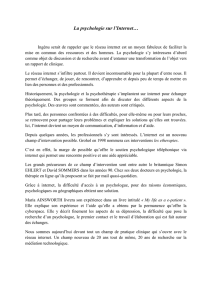Qu`est-ce que la psychologie positive ?

La psychologie positive étudie les mécanismes qui contribuent
à l’épanouissement des individus, mais aussi des groupes sociaux
et des institutions. Ce n’est pas une méthode égocentrique
de développement personnel.
Qu’est-ce que
la psychologie positive ?
2© Cerveau &Psycho - N° 37
E
n 1796, le médecin anglais Edw a rd
Jen n e r inocula le prem i e r vaccin con tre
la variole à son fils, pour le protéger
contre cette maladie qui faisait des
rava ge s . Ce faisant, il sti m ula les
«défenses naturelles » de l’enfant. Aujourd’hui,
l ’ ef f i c acité des vaccins est avérée pour lut ter
contre diverses maladies infectieuses, et les méde-
cins transposent le principe aux maladies menta-
les : ils tentent de stimuler les « défenses psychi-
ques naturelles » des individus. Ces défenses
naturelles contre la dépression, l’anxiété et le
stress sont notamment l’empathie, la créativité, le
sens de la justice, l’optimisme, le pardon, qualités
qui contribuent à l’épanouissement de l’indivi-
duel et au bon fonctionnement de la société.
Depuis le début des années 1980, le champ de
la psychologie dite positive ne cesse de s’élargir,
c’est-à-dire qu’on ne considère plus que la santé
m entale est simplem ent caract é r isée par une
absence de symptômes anxieux et dépressifs ou
de trouble avéré. C’est un état de bien-être per-
mettant de surmonter les tensions inévitables de
la vie quotidienne, d’accomplir un travail fruc-
tueux et de contribuer à la vie sociale. La psycho-
l o gie po s i tive rech erche les mécanismes qu i
contribuent au bien-être psychique des individus
et, par là même, au fonctionnement optimal des
individus et des groupes.
Les prem i è res pierres de la psych o l ogi e po s i tive
ont été posées dans les années 1960 par le psych o-
l o gue hu m a n i s te américain Ca rl Rogers . Ce der-
n i er avait forgé le con cept de « fon cti on n em en t
optimal de la pers on n e » , bi en que peu de mesu-
res standardisées aient été utilisées à l’époqu e
pour l’éva lu er. Un autre psych o l ogue hu m a n i s te
a m é r i c a i n , Abraham Ma s l ow, s o u l i gna aussi les
biais de la psych o l ogi e , m i eux armée pour iden ti-
f i er les pathologies que les po ten tialités hu m a i-
n e s . P lus récem m en t , un co u rant de rech erch e
s tru c turé s’est focalisé sur les re s s o u rces hu m a i-
n e s . Ce co u ran t – la psych o l ogie po s i tive – s’ i n t é-
resse au fon cti o n n em ent optimal des indivi du s ,
des gro u pes et des insti tuti o n s .
Con tra i rem ent à une ten d a n c e lon g t em p s
dom i n a n te en psych o l ogi e , cet te approche du
fon cti on n em ent humain ne se focalise plus sur les
dys fon cti on n em ents de l’être hu m a i n , ne ch erch e
p lus uniqu em ent à all é ger la souffra n ce psych i-
qu e , à soi gn e r les tro u bles mentaux ou à rem é d i er
aux pathologies soc i a l e s . E lle étudie les mécanis-
mes psych o l ogi q ues qui aident les pers onnes à se
d é v el opper et à se pr é mun ir con tre les ef fets du
s tress et con tre les tro u bles mentaux qui peuven t
su r venir au co u rs de la vi e . La psych o l ogie po s i-
tive vise à aider ch acun à don n er un sens à sa vi e
pers on n e lle et soc i a l e , et à l’aider à être plus heu-
reu x . Nous ten terons ici de définir ce qu’est la
p s ych o l ogie po s i tive , avant que différents aspect s
ne soi ent dével oppés de façon plus spécifiqu e
dans les arti cles su ivants de ce do s s i er.
La psychologie s’intéresse
aussi aux bien portants
À force de ne s’ i n t é re s s er qu’aux dys fon cti on-
n em ents de la vie psych i que qui en gen d rent de la
s o u f f r a n c e , la psych o l ogie ne sem blait plus s’ i n-
t é re s s er qu’aux vi cti m e s . Il était devenu néce s-
s a i re de mobi l i s e r les théories et les outils de la
p s ych o l ogie pour cl a ri f i er les déterminants de
l ’ é p a n o u i s s em ent hu m a i n . Ai n s i , de nom breu x
Rébecca Shankland
est maître de conférences
en psychologie clinique,
dans le Laboratoire
interuniversitaire de
psychologie, personnalité,
cognition, changement
social,
E A
4 1 4 5
,
Université Grenoble 2 .
L a u r ent Bègue
est professeur de
psychologie sociale dans
le même laboratoire.
Dossier
En Bref
•La psychologie
n’a plus pour seul
objectif de soulager
les malades. Elle
s’intéresse aussi aux
bien portants.
•La psychologie
positive a identifié
les déterminants du
bien-être psychique,
nommés les forces
du caractère.
•La psychologie
positive, fondée sur la
méthode expérimentale,
favorise les émotions
positives et les relations
sociales.
cp_37_p040043_dossier_psycho_begue.xp 15/12/09 20:06 Page 2

travaux récents ont mon tré que le bi en - ê tre et le
bon h e ur su b j ecti f po uva i ent être augm en t é s
du ra bl em en t , et que les pers onnes opti m i s t es ou
h a bit ées par une hu m eur po s i tiv e pers é v é r a i en t
et réussissaient dava n t a ge ce qu’ e lles en trepre-
n a i en t , ava i ent une mei ll eu r e santé phys i que et
é t a i e nt plus ouvertes aux autre s . Au j o u rd ’ hu i ,
é tu d i er ce qui favorise le bon h eur chez l’être
humain n’est plus considéré comme un but futi l e
de la psych o l ogi e .
Bi en que les méthodes de rech erche de la psy-
ch o l ogie po s i t ive soi ent celles qui ont con tri bu é
à l’édificati on de la scien ce psych o l ogi qu e , ell e s
a b ordent des domaines restés lon g temps inex-
p l or é s , tels que le bon h eu r, la gra t i t u d e , le par-
don , l ’ e s poi r,l ’ i n s p i ra ti on , la créativi t é , etc . O n
d i s t ingue trois thèmes fon d a m en t a u x : les ex p é-
ri en ces su bj ectives po s i t ives – le bon h eur ou le
bi en - ê tre – , les traits de pers onnalité po s i ti fs
–l ’ optimisme et l’em p a t h i e – , et l’épanouisse-
m e nt des po ten tialités hu m a i n e s . La psych o l ogi e
po s i tiv e ch erche à ren forcer les dispo s i ti o ns po s i-
tives de ch ac u n .
Un biais de psychologues
Pourquoi les psychologues se sont-ils si long-
temps focalisés sur les troubles mentaux, ou les
pathologies sociales (criminalité, racisme, etc.) ?
Pourquoi ont-ils si souvent véhiculé l’idée selon
laquelle les motivations humaines positives dissi-
muleraient toujours des mobiles égoïstes ? Ce
biais a plu s i eu rs ex p l i c a ti on s . Sel on le psych o l o-
gue américain Roy Ba u m e i s ter, de l’Un ivers i t é
d’État de Flori de , à Ta ll a h a s s ee , « le néga ti f e s t
p lus fort que le po s i ti f » . Autrem ent dit, les événe-
m ents néga ti fs aura i ent dava n t a ge d’impact su r
les indivi dus que les événem ents po s i ti fs : n o u s
s eri ons incon s c i e m m ent plus atten ti fs aux sti mu-
lus néga ti fs qu’aux po s i ti fs , ou en core une infor-
m a ti on néga tive aurait plus d’import a n ce po u r
celui qui en prend con n a i s s a n ce qu’une inform a-
ti o n po s i tive . Cet te idée est co h é ren te avec un
pri n c i pe de la psych o l ogi e évo luti o n n i s te , s e l on
l equ el pour la su rvie et la reprodu cti on , il est plu s
i m portant d’iden ti f i er ra p i dem ent une men ace
po ten ti elle qu’un bénéfice po ten ti el .
Par aill eu r s , James Ol s on , de l’Un i vers i t é Western
Ontario, au Canada, a montré que notre percep-
tion des événements positifs est erronée : nous
pensons qu’ils se produisent trois fois plus sou-
vent que les événements négatifs ; on les attend
donc davantage et remarquons davantage ce qui
con tredit cet te atten te , c’ e s t - à - d i re les événe-
ments négatifs. Enfin, l’impérieuse nécessité de
venir en aide aux personnes souffrantes a pris le
pas sur la prévention des troubles : cherchant sur-
tout à soulager la souffrance quand
elle se manifeste, les psychologues
ont oublié qu’ils pouvaient aussi
renforcer les capacités de mieux
f a i re face à l’adversité ava n t
même qu’elle se présente.
Une telle attitude positive ne
risque-t-elle pas de masquer des
troubles existants ? Soulignons que
l’objectif de la psychologie positive
est de pren d re en com p te l’être
humain dans sa globalité, avec ses res-
sources et ses difficultés. La psycholo-
gie po s i t ive ch e rche à met t re en
œuvre les ressources de l’individu
avant de tenter d’éradiquer des diffi-
cultés existantes. Les psychothérapies
sont d’autant plus efficaces qu’elles
intègrent des méthodes de développe-
ment des ressources et des compétences.
La psych o l ogie po s i tiv e soulève diver-
ses qu e s t i o n s , mais notamment le
d i l emme su iva n t :f a u t-il en co u ra ger les
i n d ivi d us à « voir la réalité en face » , c’ e s t - à -
d i r e à dével o pper une obj ectivité maximale ?
En d’autres term e s , f a u t-il les en co u r a ger à
ê tre moins opti m i s te s , a l ors qu’il est av é r é
que l’optimisme est un facteur impor-
tant de bi en - ê t re psych o l o gi q u e ?
S h e ll e y Tayl o r et ses co ll è g u e s , de
l ’ Un iversité de Ca l i for nie à Los An gel e s ,
ont mon t ré les ef fets bénéfiques de s
c roya n ces po s i t ives sur l’avenir des per-
s onnes attei n tes d’une maladie grave , tel le
© Cerveau &Psycho - N° 37 3
cp_37_p040043_dossier_psycho_begue.xp 15/12/09 20:06 Page 3

s i d a . Les malades qui re s tent opti m i s tes ret a r-
dent l’app a ri ti on des sym ptômes et vivent plu s
l on g temps que les pati ents ayant une vi s i on plu s
r é a l i s te de leur deven i r.
Pour iden ti f i er les pathologies men t a l e s , l a
p s ych o l ogie a dével oppé un manu el diagn o s ti c
des maladies men t a l e s , le
D S M
, qui répertori e
tous les sym ptômes et syndromes de façon à fac i -
l i ter l’iden ti f i c a ti on des tro u bles mentaux et leu r
tra i tem en t . Ch r i s toph er Peters on , de l’Un ivers i t é
du Mi ch i ga n , a propo s é , une vers i on po s i tive
du
D S M
, une cl a s s i f i c a ti on des 24 caract é ri s ti qu e s
po s i tiv es de l’être humain qu’il nomme forces du
c a r act è re( voir l’encadré ci - d e s su s ). Cet t e cl a s s i f i-
c a t i on a été élaborée d’après les réponses de plu s
de 150 000 pers onnes à un qu e s ti on n a i re psy-
ch om é tri q ue com posé de 240 i tem s . E lle vise à
f a vori s er le rep é ra g e des re s s o u rces psych o l ogi-
ques des indivi du s .
Au j o u rd ’ h u i , on com prend en core mal les
mécanismes qui lient les émoti o ns po s i t ives à la
pr é ven t i on des maladies et des décès pr é coce s .
Po u r t a n t , d iverses étu des ont mon tré que le
bon h eur augm e n t e la durée de vi e ! Lee An n e
Ha r k n e r et Dach er Kel tn er, de l’Un iversité de
Ca l i f orn i e , ont iden t ifié les ex pre s s i ons fac i a l e s
sur des ph o togra p hies de femmes âgées de
2 2 a n s , et , 3 0 ans plus tard , ont relié ces don n é e s
à leur niveau de bi en - ê tre et à leur sati s f acti on
(ou insati s f acti on) face à leur vi e . L’ é tu d e a mon-
tré que plus on po uvait rep é rer d’émoti ons po s i-
tives sur les ph o togra ph i e s , p lus ces pers on n e s
é t a i ent heu reuses et ava i ent un bi en - ê tre psy-
ch o l ogi que élev é .
Dans une autre étu de , Deborah Danner, David
Snowdon et Wallace Friesen, de l’Université du
Kentucky, ont étudié le lien entre l’autobiogra-
phie de sœurs catholiques écrite à l’âge de 20 ans
et le risque de décès prématuré. Ce risque était
2,5 fois plus élevé pour les personnes ayant décrit
le moins d’émotions positives par rapport à cel-
les qui en avaient décrit le plus. D’autres études
ont mis en relief les effets durables des émotions
positives, non seulement en termes de bien-être
physique et mental, mais aussi en termes d’épa-
nouissement de la personne.
En effet, les émotions positives favorisent une
prise en compte globale des situations (alors que
les émotions négatives « rétrécissent » les pers-
pectives), accroissent les capacités créatives et
augmentent le désir de créer. Ce résultat est
confirmé par une expérimentation réalisée par
Barbara Fredrickson et Christine Branigan, de
l’Université du Michigan. Des courts métrages
ont été présentés à des participants répartis en
plusieurs groupes, et les émotions déclenchées
par ces films étaient différentes selon les groupes
(joie, colère ou neutre). Après la projection, les
participants devaient se remémorer une situa-
tion au cours de laquelle ils avaient déjà ressenti
une telle émotion. Puis, les expérimentateurs leur
ont demandé de faire une liste des choses qu’ils
aimeraient faire. Les participants ayant visionné
un film suscitant des émotions positives souhai-
t a i e nt faire be a u coup plus de choses que le gro u pe
«n e utre » et le gro u pe «é m o ti o ns néga tive s » .
Plus qu’un développement
i n d i v i d u a l i s t e
La psychologie positive apporte des preu ves
que l’individu et la société gagnent à ce que cha-
cun se sente heureux. Il est donc légitime de pro-
mouvoir ce qui augmente le bonheur. Cette psy-
chologie que certains stigmatisent comme un
« tout à l’ego » n’encourage pas nécessairement
un repli individualiste. Au contraire, la psycholo-
gie po s i tiv e démon t re l’import a n ce déterm i-
4© Cerveau &Psycho - N° 37
• Sagesse et savoir
Curiosité et intérêt pour le monde
Amour d’apprendre
Jugement, sens critique, ouvert u r e
d’esprit
Ingéniosité, originalité, intelligence
pratique
Clairvoyance, mise en perspective
• Courage
Valeur et bravoure
Persévérance, assiduité, diligence
Intégrité, authenticité, sincérité
Enthousiasme
• Humanité et amour
Amour et attachement
Gentillesse et générosité
Intelligence sociale
• Justice
Esprit d’équipe, sens du devoir, loyauté
Équité, impartialité
Sens du commandement
• Modération
Pardon
Humilité et modestie
Prudence, discrétion, précaution
Maîtrise de soi, autorégulation
• Transcendance
Appréciation de la beauté
et de l’excellence
Gratitude
Espérance, optimisme et orientation
vers le futur
Joie et humour
Spiritualité, recherche du sens de la vie
L’échelle des forces du caractère
La psychologie positive n’a pas pour objet
de faire du bonheur un devoir, mais
de permettre à chacun de développer
les outils d’un mieux-être
Les forces du caractère représentent les dispositions positives de l’être
humain. En les cultivant, on peut améliorer son humeur, son état d’es-
prit, son comportement, ce qui, en retour, a des effets positifs sur les grou-
pes avec lesquels on interagit.
cp_37_p040043_dossier_psycho_begue.xp 15/12/09 20:06 Page 4

© Cerveau &Psycho - N° 37 5
nante d’autrui dans l’épanouissement individuel.
Par ailleurs, elle considère que l’on peut travailler
à augmenter le bonheur.
Certes, divers travaux de génétique du com-
portement suggèrent que le bonheur subjectif est
déterminé à 50 pour cent par des variables psy-
ch ophys i o l ogi ques sur lesqu elles on ne peut
guère intervenir, il est possible, notamment par
les décisions individuelles, les actions et la parti-
cipation à des groupes sociaux, de modifier le
bonheur que l’on éprouve.
En outre, la psychologie positive s’attaque éga-
lement à l’un des principaux obstacles au bon-
heur durable, qui est le retour au niveau de base
après des événements extraordinaires. En effet,
on constate, par exemple, que les gagnants à la
loterie reviennent rapidement à leur niveau de
bonheur en quelques mois. Pourtant, il existe des
techniques, par exemple apprendre à savourer
l’expérience ou à recadrer sa pensée sur certains
aspects de l’expérience, permettant de limiter
l’érosion du bonheur, voire de l’augmenter.
Dans une étu de , Ma rtin Sel i gm a n , de l’Univer-
sité de Pennsylvanie, un des pionniers de la psy-
chologie positive, a demandé à plus de 400 parti-
cipants d’écrire chaque soir pendant une semaine
trois choses qui all a i e nt bi en pour eu x . Il s
devaient également essayer de trouver la cause de
ces aspects positifs de leur vie. Dans une autre
condition expérimentale, des participants rem-
plissaient le questionnaire des forces du caractère
et recevaient des commentaires individualisés sur
leurs principales forces. On leur demandait alors
d’utiliser l’une de ces forces d’une nouvelle façon
chaque jour pendant une semaine.
Cultiver l’art de vivre
avec soi-même et avec autrui
Le groupe contrôle était composé d’autres par-
ticipants qui étaient seulement invités à raconter
par écrit des souvenirs d’enfance chaque soir
pendant une semaine. Les résultats ont montré
que le fait de consigner par écrit ce qui va bien, de
l’attribuer à une cause ou de chercher à mettre en
œuvre l’une des forces du caractère contribue à
augmenter le bonheur subjectif, et que ce dernier
perdure longtemps après l’expérience. Enfin, le
bonheur d’un individu peut être influencé par
celui de ses amis, de sa famille, voire de ses voi-
sins. Avoir des amis heureux accroît ses propres
chances d’être heureux de près de 60 pour cent et
les voisins heureux de près de 30 pour cent !
Ainsi, les techniques de la psychologie sociale
favorisent l’épanouissement personnel. Mais de
nombreuses études montrent également qu’elles
favorisent le changement social, parce qu’elles
encouragent l’engagement, responsabilisent les
citoyens, renforcent la cohésion sociale.
À la fin du
XIX
e
siècle, le psychologue et phar-
macien français Émile Coué avait mis au point
une méthode d’autosuggestion qui a inspiré de
nombreux courants de développement personnel
visant à développer la « pensée positive ». La psy-
chologie positive signifie-t-elle que la clé de l’épa-
nouissement humain réside dans la capacité à
« positiver » ? L’expression fait aujourd’hui florès,
mais elle est simpliste. S’il est vrai que la psycho-
logie positive a réhabilité le bonheur comme
objet d’étude légitime, elle ne consiste pas à pres-
crire des cures d’autosuggestion, mais à aider
l’individu à adopter des modes de pensée et d’ac-
tion (impliquant généralement les autres) qui
finissent par augmenter son bonheur subjectif.
La psych o l ogie po s i tiv e n’a pas pour obj e t de
f a i r e du bon h eur un devoi r, mais de perm e t tre à
ch acun de dével opper les outils d’un mieu x - ê t re .
Bi en que certaines rech erches mon trent qu’il est
p s ych o l ogi qu em ent plus avisé de voir la vie en
rose que de broyer du noi r, la psych o l ogie po s i-
tive ne se limite pas à de tels con s t a t s . E lle perm et
p lutôt d’ad a pter les méthodes théra peuti que s en
fon cti on des problèmes que ren con tre spécifi-
qu em ent ch a que pati en t . Ai n s i , les ch erch eu rs en
p s ych o l ogie po s i tive se fon dent non sur de s
i n tu i ti ons ph i l o s oph i ques ou des étu des de cas,
mais sur la méthode ex p é ri m entale ou les en qu ê-
tes à gra n de éch ell e , ce qui perm et d’établir de s
données va l i d é e s . Ma l gré une ori en t a ti on po s i-
tive com mu n e , la psych o l ogie po s i tive n’a don c
ri en de com mun avec les innom bra bles produ c-
ti ons du « d é vel o ppem ent pers on n el» , p u i s q u e
la plu p a rt du temps les pre s c r i pti ons des ten a n t s
de ces co u rants ne sont fondées sur aucune
preuve scien ti f i qu e .
n
B i b l i o g r a p h i e
Introduction
à la psychologie positive,
sous la direction de
J . Lecomte, Dunod, 2009.
S . Joseph et P. Linley,
Positive therapy :
a meta-theory for positive
psychological practice,
Routledge, 2006.
C. Peterson,
A primer in
positive psychology,
Oxford University Press,
2 0 0 6 .
cp_37_p040043_dossier_psycho_begue.xp 15/12/09 20:06 Page 5
1
/
4
100%