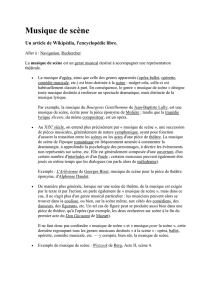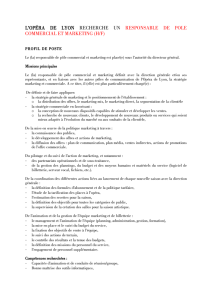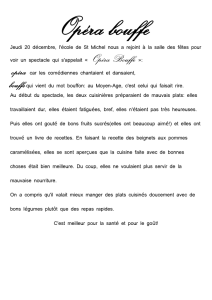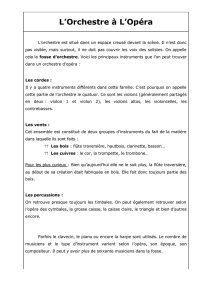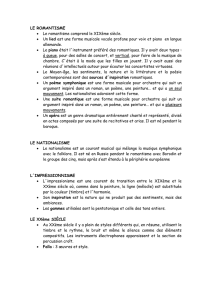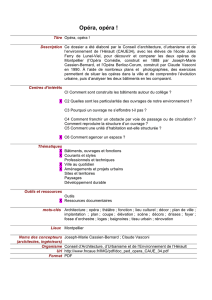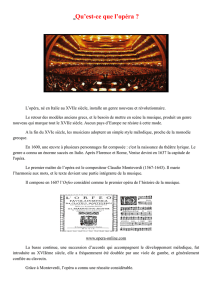CommuniCation / médias

Pierre Collet / William Chatrier
Tél. +33 (0) 1 40 26 35 26
Fax +33 (0) 1 40 28 02 27
collet@aec-imagine.com
chatrier@aec-imagine.com
Anastasie Tsangary-Payen
Tél. +33 (0) 4 72 00 45 82
Fax +33 (0) 4 72 00 45 39
atsangary@opera-lyon.com
COMMUNICATION / MÉDIAS

Une opérette n’est rien d’autre qu’un petit opéra du genre gai et beaucoup d’œuvres classiques sont ainsi intitulées.
Ce genre ne saurait être tenu pour responsable de ce que des œuvres sans valeur musicale aient été ainsi récemment
baptisées de ce nom. Celle du défunt maître Johann Strauss les surpasse à tous égards, notamment en ce qui concerne
l’excellente diction musicale, et c’est pourquoi la direction a décidé de l’inscrire au répertoire de l’Opéra. Vous-même,
cher Monsieur Schrödter, avez chanté déjà plusieurs fois des ouvrages qui n’ont aucunement la valeur musicale de La
Chauve-Souris…
Extrait d’une lettre du directeur de l’Opéra de Vienne au ténor Fritz Schrödter.
Citée par Henry-Louis de la Grange dans Gustav Mahler, tome 1. © Fayard 1979

Direction musicale
Emmanuel Krivine
Mise en scène
Peter Langdal
Scénographie
Mia Stensgaard
Costumes
Pernille Egeskov
Lumières
Jesper Kongshaug
Chorégraphie
Niklas Bendixen
Orchestre et Chœurs
de l’Opéra de Lyon
Enregistré par France Musique
Production du Royal Danish Opera
Einsenstein
Dietrich Henschel
Rosalinde
Nicola Beller Carbone
Adele
Olga Peretyatko
Prince Orlofsky
Stéphanie Houtzeel
Alfred
Bernhard Berchtold
Dr Falke
Otto Katzameier
Blind
Eberhard Francesco Lorenz
Frank
Andreas Macco
Frosch
Timo Dierkes
Tarifs :
De 5 à 88e
(sauf 31/12 de 5 à 97e)
Durée
Environ 3h20
DÉCEMBRE 2008
ME 17 19H30
VE 19 19H30
DI 21 16H00*
MA 23 19H30
VE 26 19H30
DI 28 16H00
LU 29 19H30
ME 31 19H30
JANVIER 2009
JE 1ER 19H30
*Atelier pour enfants
1

L’Exposition Universelle de Vienne, en 1873, battait son
plein depuis huit jours lorsque le krach financier monumental,
le fameux «Vendredi noir» du 9 mai 1873, s’abattit sur la
ville. La banqueroute qui s’ensuivit, le déficit de l’Exposition
qui dut prématurément fermer ses portes le 8 novembre,
tout cela créa une atmosphère peu propice, dont la ville
n’était pas encore remise quand apparut, le 5 avril 1874,
à l’An der Wien, la nouvelle opérette de Strauss, écrite en
collaboration avec Karl Haffner et Richard Genée (1823 -
1895) La Chauve-Souris. Signalons que Genée était connu
à la fois comme librettiste et comme musicien. On lui doit
plusieurs opérettes, avant sa collaboration avec Strauss (et
après) et de nombreux livrets dont ceux de Suppé, Fatinitza
et Boccace. On sait que les librettistes de La Chauve-Souris
s’étaient inspirés du Réveillon, un vaudeville de Meilhac et
Halévy joué en 1872 au Palais-Royal à Paris. L’impresario
de Meilhac et Halévy, cherchant à négocier les droits du
Réveillon pour l’étranger, fit affaire avec Gustav Lewy,
l’éditeur et ami viennois de Strauss.
Naturellement, cette Chauve-Souris, qui n’était plus une
parodie en costumes, mettait en scène pour la première
fois, comme dans La vie parisienne (son pendant)
d’Offenbach, des personnages contemporains se moquant
d’eux-mêmes. Pourtant il est permis de se demander si,
après tout, Strauss, comme Offenbach, était sur le moment
vraiment conscient de la portée sociale de sa pièce…
(Mais ceci est un autre débat). Dans le contexte de la crise,
cette satire des mœurs bourgeoises parut soudainement
du plus mauvais goût aux Viennois qui, encore sous le
choc, n’avaient guère envie de rire.
Il fallut le succès de la pièce à Berlin, à Hambourg, et
surtout à Paris, pour la consacrer et assurer son envol. La
Chauve-Souris s’était portée sur la scène du Théâtre de la
Renaissance le 30 octobre 1877, avec un livret entièrement
refait, en accord avec Strauss, par Victor Wilder et
Delacour, car la tradition de ce théâtre ne voulait que des
personnages en costumes. C’est donc sous le titre de La
Tzigane que la pièce fut jouée à Paris, avec Zulma Bouffar
dans le rôle de Madame Gaillardin (Caroline).
Avec un livret nouveau de Paul Ferrier, et pour la première
fois son titre original, le chef-d’œuvre de Johann Strauss
fut repris le 22 avril 1904 aux Variétés, cette fois-ci sans
Zulma Bouffar, (qui venait d’entrer à Pont-aux-Dames…).
Une version nouvelle de Nino fut jouée dès novembre
1933, au Théâtre Pigalle, avec une musique «arrangée»
par Korngold, une mise en scène de Max Reinhardt, et
une distribution fabuleuse (….). Gustav Malher avait dirigé
La Chauve-Souris à l’Opéra de Vienne en 1894. Tous les
opéras du monde l’avaient accueillie. (…).
L’Avant-Scène Opéra
L’ŒUVRE
2

Pour Vienne, l’opérette a d’abord été un produit d’impor-
tation française. Entre 1861 et 1864, Offenbach fait
fureur dans la capitale des Habsbourg : c’est même à
l’intention de l’Opéra de Vienne qu’il compose ses Rhein-
nixen que Marc Minkowski a dirigé à l’Opéra de Lyon et
c’est d’ailleurs dans la foulée de ces succès que Franz von
Suppé connaît ses premiers triomphes avec La belle Ga-
lathée et Cavalerie légère. Johann Strauss, qui est déjà le
maître incontesté de la valse, n’écrira sa première opé-
rette, Indigo qu’en 1871. Die Fledermaus (La Chauve-
Souris) suivra deux ans plus tard. Et ici encore, l’influence
française est prépondérante car le livret de Haffner et
Richard Genée s’inspire bel et bien d’un vaudeville pari-
sien de Meilhac et Halévy intitulé Le Réveillon.
On se demande d’ailleurs comment le récit plutôt libertin
de cette opérette a pu être accepté dans l’Autriche collet
monté, héritée de Metternich. Ce serait oublier un peu
vite que les années 70 à Vienne montrent un relâchement
apparent des mœurs sous des travers officiels toujours très
stricts. Les messieurs fréquentent régulièrement les danseu-
ses du demi-monde et les soirées masquées permettent
aux servantes de se faire passer pour leurs patronnes et à
ces dernières de s’encanailler gentiment. Le décor de la
Chauve-Souris est planté.
Le Dr Falke est bien décidé à se payer la tête de son ami
Eisenstein qui l’a récemment ridiculisé. Il l’emmène à une
soirée mondaine chez le prince Orlovsky où se retrouvent
Adèle, sa servante et une intrigante comtesse hongroise
qui n’est autre que sa femme Rosalinde. Tout ce petit mon-
de se retrouve au 3e acte dans la prison où Eisenstein
doit purger une peine : on passe dans le royaume de
Frosch, un geôlier solidement éméché qui avec son savou-
reux accent patoisant se fait le chansonnier de l’actualité
viennoise. Mais tout le monde finit par se réconcilier dans
une enthousiaste louange au…champagne ! C’est gai,
léger, superficiel.
Au fil des années, la Chauve-Souris est ainsi devenue l’éta-
lon idéal de l’insouciance viennoise, d’une bourgeoisie
futile et dépensière, d’une société qui danse sur les bords
d’un volcan. Il faut dire que l’opérette de Strauss est d’une
incroyable efficacité : l’élan de ses danses, la verve de ses
mélodies, son rythme théâtral presque frénétique exigent
des interprètes survoltés. Pas facile en effet à distribuer
cette pièce dont on ne sait si elle est destinée à de grands
chanteurs capables de jouer à fond la comédie ou de
solides acteurs qui disposeraient d’un grand métier vocal.
Sans parler de l’entrain même de la musique qui exige un
vrai chef et non un simple batteur de mesure.
Pas facile non plus de lui donner une vraie liberté théâ-
trale qui fasse fi de la superficialité amusée du propos.
Mais aller trop loin, c’est souvent sombrer dans la dé-
nonciation contestataire primaire. Tous ont encore dans
les oreilles l’insupportable charabia de la production de
Hans Neuenfels en 2001 à Salzbourg quand l’opérette
de Strauss servit de faire-valoir poussif pour la dénon-
ciation de la sottise prétentieuse de la bourgeoisie vien-
noise dans l’Autriche de Jörg Haider. Le regard de Peter
Langdal se veut moins revendicateur mais pas moins inci-
sif. La fête a ses plaisirs et ses fantasmes, ses déboires et
ses relents. Mais après tout, notre société ne danse-t-elle
pas aujourd’hui au bord d’un gouffre ?
Serge Martin
LA CHAUVE-SOURIS, UN MOMENT INSOUCIANT
DE VIENNE QUI DONNE À RÉFLÉCHIR
3
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%