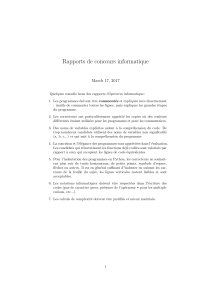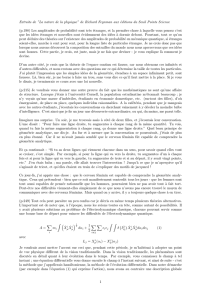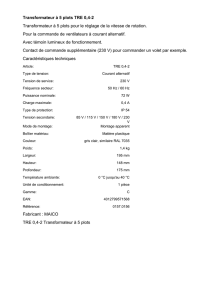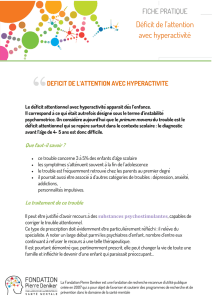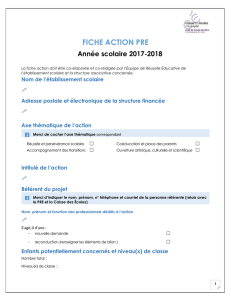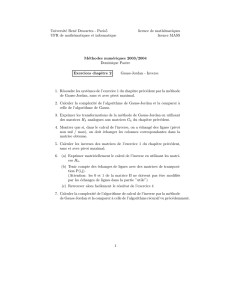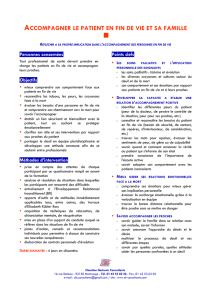Lire la suite…

La philosophie peut-elle jouer un rˆole dans
l’accompagnement du malade ?
Eric Delassus
Aujourd’hui pour aider tous ceux de nos semblables qui traversent une ´epreuve p´e-
nible et sont plong´es soudainement dans un malheur qui peut leur paraˆıtre tout aussi
absolu qu’absurde, le recours `a la psychologie est devenu une pratique courante et, il est
vrai, apportant le plus souvent un soutien non n´egligeables aux personnes ayant subi un
traumatisme important ou vivant une situation dont le caract`ere traumatisant s’inscrit
dans la dur´ee, ce qui est le cas de celui qui est atteint d’une maladie grave, pouvant ˆetre
handicapante et dont l’issue peut-ˆetre incertaine voire fatale.
Cependant si un soutien psychologique peut ind´eniablement aider le malade `a mieux
supporter sa condition et `a mieux lutter contre l’affection dont il est victime, ne serait-il
pas envisageable ´egalement d’apporter au patient un soutien par la philosophie ?
En effet la souffrance morale `a laquelle est confront´e le malade rel`eve-t-elle toujours
d’une r´eelle pathologie pouvant donner lieu `a une d´emarche psychoth´erapeutique ?
Alors que la psychologie aide le malade `a mieux se situer et `a mieux comprendre
sa mani`ere de r´eagir par rapport `a son histoire particuli`ere, la philosophie ne pourrait-
elle pas lui permettre de mieux appr´ehender sa condition du point de vue de l’universel,
afin de mieux affronter la question du sens d’une existence dont le caract`ere fragile vient
soudain s’imposer en mettant le sujet, de mani`ere souvent brutale, en face de la finitude
de l’existence humaine ?
Le recours `a la philosophie dans le cadre d’un soutien aux malades ne peut cependant
ˆetre envisag´e sans qu’auparavant ait ´et´e d´evelopp´ee une r´eflexion sur le sens mˆeme de la
philosophie et sur la place qu’occupe l’´eventualit´e de la maladie dans la condition humaine
en g´en´eral.
La philosophie contemporaine se pr´esente en effet de plus en plus comme une dis-
cipline d’intellectuels orient´ee vers la recherche d’un savoir pouvant parfois apparaˆıtre
comme abstrait et d´esincarn´e, cependant comme le fait tr`es justement remarquer Marcel
Conche il n’en n’a pas toujours ´et´e ainsi1, il rejoint d’ailleurs ici Pierre Hadot qui en r´ef´e-
1«Une doctrine ou th´eorie philosophique, ou n’est rien, ou n’est finalement rien d’autre qu’une pra-
tique, et les possibilit´es philosophiques ne sont, prises dans leur v´erit´e, que des possibilit´es de vie. La
v´erit´e de la philosophie est la sagesse, et le sage est le philosophe dont la vie sert de preuve. »Marcel
1

rence `a la tradition de l’antiquit´e grecque d´efinit la philosophie comme ´etant avant tout
«un mode de vie »2.
On pourrait par exemple pour illustrer cette conception de la philosophie se r´ef´erer `a
la pens´ee et `a la morale sto¨
ıcienne qui se donne pr´ecis´ement pour tˆache de permettre aux
hommes de mieux vivre et surtout d’ˆetre en mesure de mieux appr´ehender les ´ev´enements
de notre existence que nous percevons comme tragiques.
Le discours que tient d’ailleurs sur la mort le philosophe Epict`ete dans un passage
c´el`ebre de son Manuel peut certainement nous aider `a mieux penser le rapport qu’il peut
y avoir entre la pens´ee et la vie, entre la philosophie et l’existence :
«Ce qui tourmente les hommes, ce n’est pas la r´ealit´e mais les opinions
qu’ils s’en font. Ainsi, la mort n’a rien de redoutable - Socrate lui-mˆeme ´etait
de cet avis : la chose `a craindre, c’est l’opinion que la mort est redoutable.
Donc, lorsque quelque chose nous contrarie, nous tourmente ou nous chagrine,
n’en accusons personne d’autre que nous-mˆemes : c’est-`a-dire nos opinions.
C’est la marque d’un petit esprit de s’en prendre `a autrui lorsqu’il ´echoue dans
ce qu’il a entrepris ; celui qui exerce sur soi un travail spirituel s’en prendra `a
soi-mˆeme ; celui qui ach`evera ce travail ne s’en prendra ni `a soi ni aux autres. »3
Ainsi la le¸con que l’on peut tirer du sto¨
ıcisme d’Epict`ete c’est que la pens´ee peut nous
aider `a mieux appr´ehender les perspectives les plus angoissantes de l’existence, modifions
nos jugements (puisque ce sont eux qui d´ependent nous) et nous pourrons alors affronter
tous les ´ev´enements impr´evisibles (qui eux ne d´ependent pas de nous)4.
«La maladie est une gˆene pour le corps ; pas pour la libert´e de choisir,
`a moins qu’on ne l’abdique soi-mˆeme. Avoir un pied trop court est une gˆene
pour le corps, pas pour la libert´e de choisir. Aie cette r´eponse `a l’esprit en
toute occasion : tu verras que la gˆene est pour les choses ou pour les autres,
non pour toi. »5
N’y-a-t-il pas d’ailleurs une dimension r´eellement existentielle et philosophique de la ma-
ladie qui nous met face `a la r´ealit´e mˆeme de notre condition ?
Conche, Pyrrhon ou l’apparence, P.U.F. 1994.
M. Conche ajoute `a ce passage la note suivante : «Il en r´esulte qu’un philosophe est bien autre chose
qu’un intellectuel. Du reste, `a s’en tenir `a l’id´ee que l’on se fait aujourd’hui de l’intellectuel, il n’y avait
pas d’intellectuels en Gr`ece. »
2Pierre Hadot, Qu’est-ce que la philosophie antique, Gallimard, 1995.
3Epict`ete, Manuel, pens´ee V.
4«De toutes les choses du monde, les unes d´ependent de nous, les autres n’en d´ependent pas. Celles
qui en d´ependent sont nos opinions, nos mouvements, nos d´esirs, nos inclinations, nos aversions, en un
mot toutes nos actions. Celles qui ne d´ependent point de nous sont le corps, les biens, la r´eputation,
les dignit´es, en un mot toutes les choses qui ne sont pas du nombre de nos actions. »Epict`ete, Manuel,
pens´ee I.
5Epict`ete, Manuel, pens´ee IX
2

ˆ
Etre malade, c’est peut-ˆetre tout d’abord ˆetre affect´e au plus profond de son ˆetre,
d’ailleurs le langage ordinaire ne s’y trompe pas lorsqu’au lieu de dire que «l’on a une
maladie », il pr´ef`ere recourir `a l’expression «ˆetre malade », comme si la maladie venait
profond´ement modifier notre identit´e et faisait de nous un autre, un ˆetre alt´er´e par rapport
`a ce qu’il ´etait avant.
Apprendre que l’on est malade, ˆetre malade c’est tout d’abord ˆetre confront´e `a la
fragilit´e et `a l’absurdit´e de l’existence humaine, d’une existence qui se sent soudain em-
prisonn´ee dans un corps qu’elle ne contrˆole plus, un corps qui ne sait plus se faire oublier
qui est l`a, pr´esent mais qui a perdu de sa puissance.
Fragilit´e, en effet, car lorsque je m’aper¸cois que je suis malade, mˆeme si je ne souffre
pas en ressentant une insoutenable douleur, je me sens soudain plus faible, diminu´e dans
mon ˆetre et ma capacit´e d’agir, incapable souvent d’accomplir ce qui justement donnait
jusque l`a sens `a mon existence, et c’est pourquoi le poids de l’absurdit´e de l’existence se
fait alors sentir.
Absurdit´e qui se trouvera ensuite redoubl´ee lorsque la souffrance apparaˆıtra et parfois
avec elle la perspective de la mort ; qu’est-ce alors que cette vie qui n’est plus que passivit´e,
qui devient un fardeau qu’il faudra porter jusqu’au moment fatal o`u tout s’an´eantira ?
Il est d´ej`a difficile pour chacun d’entre nous de supporter le poids de sa condition
d’ˆetre mortel, mais finalement quand tout va bien la joie du pr´esent l’emporte le plus
souvent sur l’angoisse que suscite cette ind´etermination de l’avenir. Mais quand le pr´esent
devient lui-mˆeme pesant, la finitude de notre existence devient de plus en plus difficile `a
supporter, au point que souvent la tentation est grande de hˆater les choses et de mettre
fin `a une vie qui nous ´echappe d’autant plus que son sens nous fait d´efaut.
La question est donc de savoir ici si la philosophie peut nous aider `a restaurer ce sens
de l’existence ou sinon `a continuer de vivre malgr´e cette absence de sens.
Tenter de penser sa vie, cela peut-il nous aider `a mieux vivre ? Et ce mˆeme lorsque
la vie se sent ´ecras´ee par un corps dont elle se sent prisonni`ere, pour reprendre ici la
m´etaphore utilis´e par Platon dans le Ph´edon :
«Les amis de la science, dit-il, savent que, quand la philosophie a pris la
direction de leur ˆame, elle ´etait v´eritablement enchaˆın´ee et soud´ee `a leur corps
et forc´ee de consid´erer les r´ealit´es au travers des corps comme au travers des
barreaux d’un cachot , au lieu de le faire seule et par elle-mˆeme, et qu’elle
se vautrait dans une ignorance absolue. Et ce qu’il y a de terrible dans cet
emprisonnement, la philosophie l’a fort bien vu, c’est qu’il est l’oeuvre du
d´esir, en sorte que c’est le prisonnier qui contribue le plus `a serrer ses liens. »6
Le corps est ici pr´esent´e comme ´etant la cause de notre incapacit´e `a atteindre la pl´enitude
6Platon, Ph´edon, trad E. Chambry, 82c-83b, Garnier Flammarion, 1965.
3

de l’ˆetre et comme la raison de notre impuissance `a ˆetre nous-mˆemes en acc´edant `a la
contemplation du bien et du vrai :
«Le corps nous cause mille difficult´es par la n´ecessit´e o`u nous sommes de le
nourrir ; qu’avec cela des maladies surviennent, nous voil`a entrav´es dans notre
quˆete de l’ˆetre. Il nous remplit d’amours, de d´esirs, de craintes, de chim`eres de
toute sorte... Guerres, dissensions, batailles, c’est le corps seul et ses app´etits
qui en sont la cause ; car, on ne fait la guerre que pour amasser des richesses et
nous sommes forc´es d’en amasser `a cause du corps, dont le service nous tient
en esclavage. »7
En un certain sens et tr`es paradoxalement lorsque nous sommes malades, nous avons
l’impression de n’ˆetre plus ce corps avec lequel nous vivions jusque l`a dans une relative
harmonie, mais nous avons l’impression d’avoir un corps8que nous traˆınons avec nous
comme un boulet et qui nous empˆeche d’ˆetre nous-mˆemes, de nous ´epanouir et de r´ealiser
toutes les perfections qui sont en nous.
Et cela le plus souvent redouble notre souffrance, car non seulement nous souffrons,
mais, et c’est l`a le comble, nous souffrons de souffrir, nous imaginons tout ce que nous
pourrions faire si nous ´etions en meilleure sant´e, nous pestons contre le sort, Dieu ou la
Nature que nous accusons de notre malheur9, nous rageons de ne rien pouvoir faire pour
mettre fin `a cette situation, adoptant l’attitude que d´enonce Epict`ete et qui consiste `a
vouloir faire en sorte que les choses arrivent autrement qu’elles arrivent :
«Et il n’y a rien de plus absurde ni de plus d´eraisonnable que de vouloir
que les choses arrivent comme nous les avons pens´ees. De toutes les choses du
monde, les unes d´ependent de nous, les autres n’en d´ependent pas. Celles qui
en d´ependent sont nos opinions, nos mouvements, nos d´esirs, nos inclinations,
nos aversions, en un mot toutes nos actions. Celles qui ne d´ependent point de
nous sont le corps, les biens, la r´eputation, les dignit´es, en un mot toutes les
choses qui ne sont pas du nombre de nos actions. »10
En quoi la philosophie peut-elle donc nous aider `a mieux assumer la maladie ?
Peut-elle nous aider `a nous r´econcilier avec ce corps qui semble nous lˆacher et qui nous
fait souffrir, car le m´epris du corps auquel pourrait nous conduire une approche de type
7Platon, Ph´edon, trad E. Chambry, 66a-67a, Garnier Flammarion, 1965.
8L’expression «avoir un corps »ne signifie pas bien entendu ici que je per¸cois mon corps, comme un
objet qui me serait ext´erieur, ce qui serait pour le moins paradoxal au sujet de la maladie et encore plus
de la souffrance ; mais nous employons ici cette expression pour signifier que le corps n’est plus v´ecu dans
l’unit´e harmonieuse qui est la sienne lorsqu’il est en bonne sant´e, mais il devient un corps que je subis,
dont je pˆatis.
9Cette attitude est confirm´e par la psychologue H´el`ene Harel-Biraud : «Parfois il (le malade) se sent
agress´e par le destin, par Dieu et peut vivre un profond sentiment d’injustice. »Manuel de psychologie `a
l’usage des soignants, Masson, 1997.
10 ´
Epict`ete, 1, 35, in Les sto¨
ıciens, Textes choisis par Jean Brun, PUF p. 72.
4

platonicien ne conduirait ici `a rien, pr´ecis´ement parce qu’il est impossible d’ignorer ce
corps qui sans cesse se fait sentir. Et si maintenant il se fait sentir de fa¸con douloureuse,
je ne puis cependant oublier qu’il a ´et´e souvent auparavant source de joie et de bonheur
et quoi de plus l´egitime que de souhaiter qu’il le redevienne autant que faire se peut ?
Le malheur et la raison
Peut-on raisonnablement, l´egitimement raisonner au sujet du malheur humain ? Et
pour ce qui concerne notre propos, n’y-a-t-il pas quelque chose d’ind´ecent `a vouloir intel-
lectualiser la maladie et la souffrance et `a pr´etendre que la philosophie serait en mesure
d’aider le malade `a supporter son ´etat ?
Le ressenti de la maladie, le v´ecu de la souffrance rel`event d’une exp´erience ´eminem-
ment subjective, singuli`ere et incommunicable, peut-on `a leur sujet ´enoncer des principes
g´en´eraux qui seraient cens´es convenir `a tous ?
La raison peut-elle s´erieusement parler de la maladie sans paraˆıtre p´edante et pr´esomp-
tueuse, n’y-a-t-il pas en effet une pr´etention d´emesur´ee, voire mˆeme d´eplac´ee `a vouloir
dire l’indicible ?
Comme le fait tr`es justement remarquer Bertrand Vergely dans un de ses livres :
«Quand on souffre, on raisonne rarement sur sa souffrance. Et quand on
raisonne sur sa souffrance, c’est, en g´en´eral, que l’on souffre moins. Il y a de
ce fait un ´ecart entre la raison et la souffrance que la raison ne saurait r´eduire,
sauf `a nier la souffrance. D’o`u le paradoxe de tout discours sur la souffrance
consistant `a devoir faire comprendre que, si l’on veut pouvoir parler de celle-ci,
il importe de ne pas trop en parler afin de pas r´eduire la part d’indicible qui
se trouve en elle. »11
En cons´equence sans aller jusqu’`a renoncer de philosopher sur ces questions, il convient
en effet de faire preuve de beaucoup d’humilit´e et de retenue quant aux propos que l’on
tient `a ce sujet, il serait en effet pr´etentieux voire insolent de consid´erer que le philosophe
est en mesure de mieux savoir que le malade ce qui est bon pour lui et de lui donner de
le¸con sur la mani`ere d’appr´ehender ce dont il souffre.
Quelle peut donc ˆetre alors l’attitude que doit adopter le philosophe pour aider r´eel-
lement le malade ? En quoi la philosophie peut-elle r´eellement conduire `a mieux vivre,
malgr´e la maladie ?
´
Epicure dans la Lettre `a M´en´ec´ee nous dit qu’il n’y a pas d’ˆage pour philosopher car
il n’y a pas d’ˆage pour «travailler `a la sant´e de l’ˆame »et pour ˆetre heureux :
11Bertrand Vergely, La souffrance, Chap. 1, p. 28, Gallimard, folio/essai, 1997.
5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
1
/
18
100%