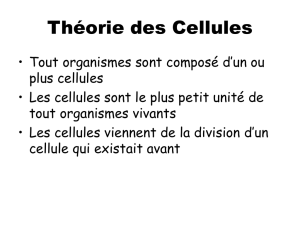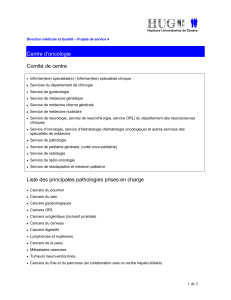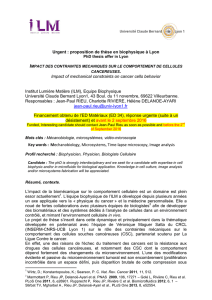adi_node_article_resumes - Cancéropôle du Grand-Est

2 & 3 FÉVRIER
CONGRÈS
ONCOTRANS
2017
Maison de l’Économie, CCI du Doubs, Besançon
5E ÉDITION
ÉVALUATION DE L’HÉTÉROGÉNÉITÉ TUMORALE :
IMPLICATION POUR L’ONCOLOGIE MOLÉCULAIRE
ET L’IMMUNOTHÉRAPIE DES CANCERS
RÉSUMÉS DES COMMUNICATIONS
www.oncotrans.fr

Maison de l’Économie, CCI du Doubs, Besançon
2 & 3 FÉVRIER
CONGRÈS
ONCOTRANS
2017
SOMMAIRE
JEUDI 2 FÉVRIER 2017
SESSION 1 .................................................................................................................P. 3
• P. 4 : Les Classicaons moléculaires dans les cancers du sein et applicaons cliniques,
Pr Pierre Fumoleau (Dijon, France)
• P. 6 : Étude des polymorphismes généques pangénomiques (GWAS) :
résultats de l’étude Signal, David G. Cox (Lyon, France)
• P. 7 : Nouvelle classicaon moléculaire et appréciaon moléculaire de l’hétérogénéité
tumorale dans les cancers du côlon, Dr Alain Thierry (Montpellier, France)
• P. 8 : Nouvelles classicaons moléculaires du cancer colorectal :
vers un traitement à la carte ? Pr Thierry André (Paris, France)
SESSION 2 .............................................................................................................. P. 10
Pare 1
• P. 11 : Nouveaux biomarqueurs pour la détecon et la stracaon des cancers
de la prostate : enjeux techniques et validaon clinique, Dr Pierre-Jean Lamy (Montpellier, France)
• P. 12 : Détecon et caractérisaon des cellules tumorales circulantes vivantes
comme biopsie liquide du cancer, Dr Catherine Alix-Panabières (Montpellier, France)
• P. 13 : Intérêt du proling moléculaire de l’hétérogénéité tumorale :
des CTC à l’ADN libre plasmaque, Dr François-Clément Bidard (Paris, France)
Pare 2
• P. 14 : Tumor-derived-exosomes: potenal in theranosc, Jessica Gobbo (Dijon, France)
• P. 15 : Ulizaon of circulang exosomal DNA for liquid biopsy, an update on current
knowledge and understanding, Dr David Guenat (Besançon, France & Stanford, États-Unis)
VENDREDI 3 FÉVRIER 2017
SESSION 3 .............................................................................................................. P. 16
• P. 17 : Immunothérapie en hématologie : état de l’art et actualités,
Pr Régis Costello (Marseille, France)
• P. 18 : Recherche translaonnelle en immuno-oncologie, Pr Christophe Borg (Besançon, France)
• P. 19 : Immunogenic cell death inducers trigger PD-L1 dependent adapve immune
resistance, Pr François Ghiringhelli (Dijon, France)
• P. 20 : How to enhance the ancancer eect of immunogenic chemotherapies?
Dr Lionel Apetoh (Dijon, France)
SESSION 4 .............................................................................................................. P. 21
Session GPCO
• P. 22 : Pharmacologie des ancorps : vers une standardisaon des techniques,
François Becher (Gif-sur-Yvee, France)
• P. 23 : Intérêt du suivi thérapeuque pharmacologique pour l’individualisaon posologique
Bayésienne des inhibiteurs des tyrosine kinases, Pr Chantal Csajka (Lausanne, Suisse)
• P. 24 : Actualités - PK/PD des biothérapies : prêt pour le STP ? Dr Joseph Ciccolini (Marseille, France)
Session SIRIC
• P. 25 : Biomarqueurs immunologiques intra-ssulaires pour la dénion
du pronosc, Pr Franck Pagès (Paris, France)
• P. 26 : Détecon des lymphocytes T antumoraux polyspéciques : biomarqueur
des immunothérapies ? Pr Marcello de Carvalho (Nancy, France)
• P. 27 : Monitoring des Innate Lymphoid Cells (ILCs) en cancérologie,
Dr Camilla Jandus (Lausanne, Suisse)
SESSION 5 .............................................................................................................. P. 28
• P. 29 : Le micro-environnement : une source d’ouls cliniques
pour le cancer du pancréas, Pr Richard Tomasini (Marseille, France)
• P. 30 : L’autophagie est-elle une cible thérapeuque ? Pr Michaël Boyer-Guiaut (Besançon, France)
• P. 31 : Du côté des phases I : les nouvelles molécules pour cibler le micro-environnement,
Dr Nicolas Isambert (Dijon, France)

JEUDI 2 FÉVRIER 2017
SESSION 1

JEUDI 2 FÉVRIER 2017 - SESSION 1
Les classificaons moléculaires
dans les cancers du sein et applicaons cliniques
Pr Pierre Fumoleau & Dr Sylvain Ladoire
Centre Georges-François Leclerc, Dijon, France
Avant les années 2000, l’hétérogénéité des cancers du sein était essenellement basée sur une classicaon anatomo-
pathologique de l’OMS avec 21 types de carcinomes inltrants. Cee classicaon morphologique où les carcinomes
canalaires inltrants sont prédominants (environ 80%) ne ent pas compte de la biologie et de ce fait a une ulité limitée
pour la prise en charge thérapeuque. Néanmoins l’expression des récepteurs hormonaux (RO & RP) et HER2 sont pris
en compte pour le choix thérapeuque (facteurs pronosques et prédicfs).
Le développement des analyses génomiques (analyses des niveaux d’expression des ARN complétées par les analyses
ADN pan génomiques) permet d’analyser simultanément l’expression de nombreux gènes, de faire un « portait » de chaque
tumeur et de mere ainsi en lumière l’hétérogénéité biologique des tumeurs du sein. Sorlie T et Perou CM (Gene expres-
sion paerns of breast carcinomas disnguish tumor subclasses with clinical implicaons PNAS 2001 ;98 :10869-74)
ont été les premiers, en 2001, à subdiviser les cancers du sein en foncon du prol d’expression génique et ainsi
décrire à parr d’une liste de gènes diérents exprimés entre les types tumoraux et nommée « signature intrinsèque » le
sous-type luminal A (25 à 40 % des cas) et B (20 à 25 % des cas), le sous-type HER2 (15 à 18 % des cas), le sous-type
basal-like (15 à 18 % des cas) et le sous-type normal-like, ce dernier sous type étant vraisemblablement un artéfact lié
à une forte contaminaon des premiers prols d’expression génique et n’ayant pas de réelle traducon en pathologie.
Les sous-types Claudin-low (Perou CM et al.), HER2-enriched (Prat A et al.) et apocrines (Farmer P et al.) ont été ensuite
individualisés. Cee signature intrinsèque en sous types apporte des informaons pernentes en termes de pronosc,
d’épidémiologie, de réponse à l’hormonothérapie et à la prédicon de réponse aux traitements ciblés an-HER2.
Luminal A ; ce sous-type est caractérisé par le niveau d’expression le plus élevé des RO et des gènes régulés par les RO
(GATA-3, FOX A1) et une faible expression des gènes liés à la proliféraon (expression de Ki-67 faible). La mutaon de
p53 est de l’ordre de 15 %. En praque clinique, il s’agit des carcinomes exprimant les récepteurs aux œstrogènes, de
grade I ou II et avec un index de proliféraon faible.
Luminal B ; ce sous-type est caractérisé par un niveau d’expression plus faible des RO & RP, des gènes régulés par les RO
et une forte expression des gènes liés à la proliféraon (expression de Ki-67 élevée). La mutaon de p53 est de l’ordre
de 65 %. En praque clinique, il s’agit des carcinomes exprimant les récepteurs aux œstrogènes, de grade II ou III et avec
un index de proliféraon élevé.
HER2 ; ce sous-type est caractérisé par une expression forte de l’amplicon de HER2, dont HER2 et GR7 avec une expres-
sion des RO (RO+) ou non RO-. Il existe le plus souvent une expression élevé des gènes liés à la proliféraon et une
mutaon de p53 de l’ordre de 70 %.
HER2-enriched ; ce sous-type décrit par Prat et al. (CCR 2014) avec RO- correspond à 45 % des tumeurs HER2+ et est
caractérisé par une expression élevée des protéines HER2/EGFR et phospho-(p)-HER2/p-EGRF. Ce sous-type est un
facteur prédicf important d’une réponse avec un double blocage an-HER2 en l’absence de chimiothérapie.
Claudin-low ; ce sous-type décrit par Pérou et al correspond à 5-10 % des cancers du sein, RO- RP- HER2- avec un
enrichissement important des marqueurs de la transion épithélio- mésenchymateuse, des gènes en rapport avec la
réponse immunitaire et des prols cellules souches.
4

JEUDI 2 FÉVRIER 2017 - SESSION 1
Basal-like ; ce sous-type est caractérisé par un très faible niveau d’expression des gènes des RO, HER2 associée à une
forte expression des gènes tels que les cytokéranes 5,6,17, EGFR, laminine, FAB7 et des gènes liés à la proliféraon tu-
morale. En complément sur le plan génomique, ces carcinomes basal-like présentent de nombreuses altéraons génom-
iques avec plusieurs gains et pertes de segments chromosomiques, des mutaons de p53 dans presque 100 % des cas
et très souvent une inacvaon somaque du gène BRCA1. Sur le plan morphologique, ils sont de type canalaire, le plus
souvent de grade III avec un index mitoque élevé. Sur le plan immunophénotypique, il s’agit le plus souvent de cancer
du sein dit triple négafs RO-, RP-, HER2- avec l’expression des cytokéranes de haut poids moléculaire CK 5,6,17 et/ou
EGFR. La majorité des carcinomes (environ 85%) survenant dans un contexte de mutaon constuonnelle héréditaire
BRCA1 partage les caractérisques moléculaires, morphologiques et immunophénotypiques de ce sous type basal-like.
Les carcinomes apocrines ; ce sous type RO-, RP- présent une signature avec acvaon de la voie de signalisaon des
récepteurs androgéniques (RA).
Les cancers du sein triple négafs RO-, RP-, HER2- ; il ne s’agit pas d’un sous type issu d’une classicaon molécu-
laire mais d’une individualisaon issue d’une dénion immuno phénotypique : l’absence de récepteurs hormonaux et
d’HER2. De plus les cancers basal-like ne sont pas à 100 % triple négafs et inversement tous les cancers triple négafs
ne sont pas tous du sous type-basal like.
Lehman BD et al ont proposé une classicaon moléculaire transcriptomique des cancers triple négafs avec 6 sous-
types et de potenelles implicaons cliniques.
Les mêmes auteurs ont eectué, à parr de 374 échanllons, une comparaison directe entre les sous types intrinsèque
PAM50 et cee classicaon moléculaire en sous type des cancers du sein triple négafs. Comme ancipé, la majorité
des cancers du sein triple négaf sont classé basal-like par le PAM50 (80,6 %). Cependant un nombre signicaf est
classé dans d’autres catégories : normal-like (14,6 %), luminal B (3,5 %), luminal A (1,1 %), et HER2 (0,2 %). À l’excepon
des sous types MSL et LAR, tous les autres sous types sont classé basal-like. Pour le sous-type MSL, environ, 50 % sont
basal-like, 27,8 % sont normal-like, 13,9 % sont luminal B, et le reste 8 % est HER2 et luminal A. Au contraire des autres
sous types, le sous type LAR est classé comme HER2 (74,3 %) et luminal B (14,3 %).
En conclusion, le consensus de St Gallen propose la classicaon suivante :
1/ Luminal A: RO et/ou RP posif, HER2-, Ki-67 bas ; hormonothérapie,
2/ Luminal B (HER2-): RO et/ou RP posif, HER2-, Ki-67 élevé ; hormonothérapie – chimiothérapie,
3/ Luminal (HER2+): RO et/ou RP posif, HER2+, Ki-67 bas/élevé ; an-HER2, chimiothérapie,
4/ HER2+ enriched (non luminal): RO et/ou RP négaf, HER2+ ; an-HER2 (double blocage), chimiothérapie,
5/ Triple négaf: RO et/ou RP négaf, HER2- ; chimiothérapie.
5
SOUS TYPE
Basal-like 1
BL1
Basal-like 1
BL2
Immunomodulatory
IM
Mesenchymal
M
Mesenchymal
MSL
Luminal androgen receptor
LAR
GÉNOMIQUE
Altéraon de la réparaon ADN
Proliféraon cellulaire
Signalisaon p53, EGFR, MET
Signalisaon immunologique
EMT, Wnt, TGFbéta, IFR1R, Notch
Proliféraon cellulaire
EMT, Wnt, TGFbéta, MAPK, PI3K, PDGF
Signalisaon AR, FOXA1, HER4
POTENTIELLES APPLICATIONS CLINIQUES
Sels de Plane, Inhibiteurs de PARP
Inhibiteurs de mTOR, de la transmission du signal
Sels de Plane, Inhibiteurs de PARP
PD-1, PDL-1 inhibiteurs
Inhibiteurs de mTOR, de la transmission du signal,
de Src
Inhibiteurs de mTOR, de la transmission du signal,
de PI3K et MEK
An Androgènes
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
1
/
86
100%
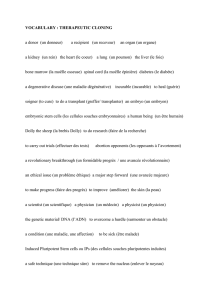
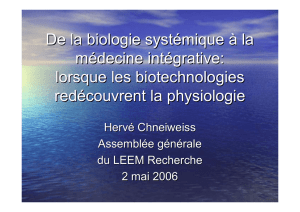

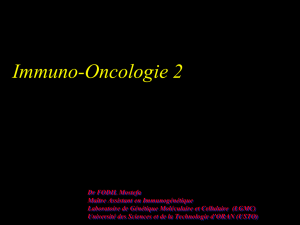
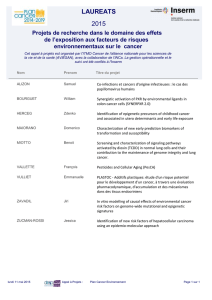
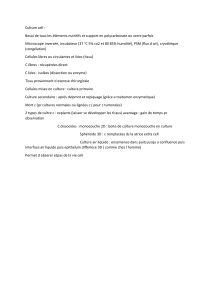
![Poster CIMNA journée CHOISIR [PPT - 8 Mo ]](http://s1.studylibfr.com/store/data/003496163_1-211ccc570e9e2c72f5d6b6c5d46b9530-300x300.png)