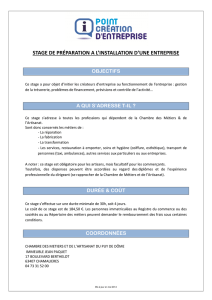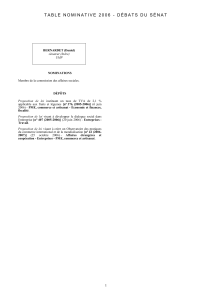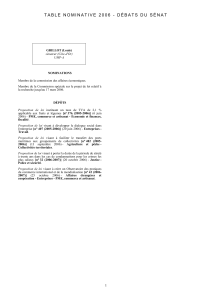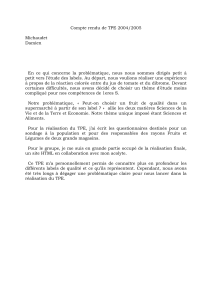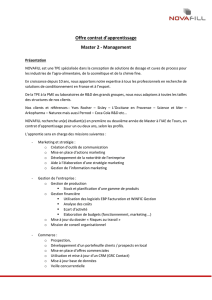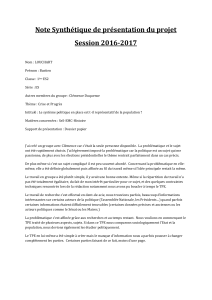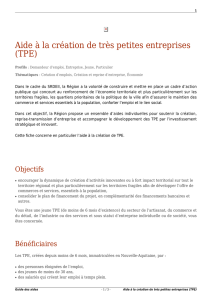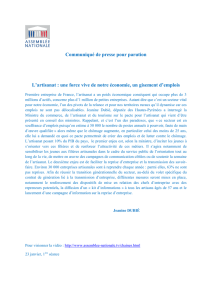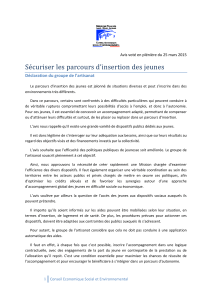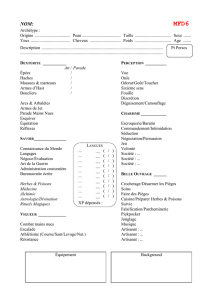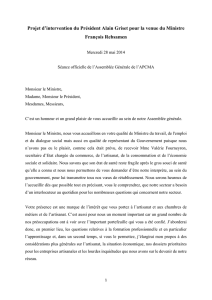2 DEUXIEME PARTIE : ANALYSE SECTORIELLE ET

Rapport Final – Etude sur la densité régionale des TPE–- DCASPL – GATE –ESiloe 2006 42
2 DEUXIEME PARTIE : ANALYSE SECTORIELLE ET LOCALISEE
Dans cette partie, l’analyse détaillera les 140 activités qui ont été retenues pour
l’approfondissement de l’étude. Le parti pris a été de les regrouper par secteur d’activité de
façon à constituer des ensembles et sous-ensembles présentant a priori une homogénéité
favorable à l’analyse. Ainsi, ils n’obéissent pas toujours aux regroupements habituels des
nomenclatures d’activité. Par exemple, on a constitué un ensemble des services rendus à
l’agriculture qui regroupe des activités relevant de l’artisanat, du commerce de gros et des
services aux entreprises ; ou bien des services de santé, des services liés à l’automobile,
etc. En outre, ces regroupements ont été organisés de façon à pouvoir appuyer l’analyse sur
des éléments d’explication issus de la littérature que nous avons pu exploiter. Ainsi de
l’artisanat, du commerce de détail, des services de santé.
Les regroupements d’activité étudiés sont les suivants :
- Artisanat alimentaire
- Artisanat du Bâtiment
- Artisanat de fabrication
- Artisanat de services et de réparation
- Services de Santé
- Activités liées à l’automobile
- Tabacs et débits de boisson
- Autres services aux particuliers
- Commerce de détail
- Commerce de gros
- Commerces et services à l’agriculture
- Services aux entreprises
La base systématique des analyses est constituée par la démographie départementalisée
des entreprises. On a vu que c’est l’indicateur qui marque le plus fortement la variation de
densité des TPE. Sa modulation par la taille des entreprises (indicateur de la valeur ajoutée)
est exploitée lorsqu’elle est apparue la plus significative, par exemple pour l’artisanat du
bâtiment et le commerce de détail.
La représentation cartographique des densités s’appuie sur la mise en exergue des déciles
supérieurs des départements présentant les plus fortes densités, souvent aussi du décile
inférieur, de façon à arrêter l’analyse sur les faits les plus saillants. Elle est précédée de la
présentation d’un certain nombre d’indicateurs concernant la démographie des entreprises
constituant l’ensemble étudié : les stocks, les flux et leur évolution ; la densité calculée par
écart inter-décile à la médiane, et son évolution.

Rapport Final – Etude sur la densité régionale des TPE–- DCASPL – GATE –ESiloe 2006 43
2.1 Chapitre 1 : Artisanat
L’artisanat est, le seul secteur des TPE qui ait fait l’objet d’une étude antérieure sur sa
répartition géographique nationale. L’étude de Paul Bachelard20, réalisée essentiellement à
partir des données du répertoire des métiers de 1980 et du recensement de la population de
1975 offre un point de comparaison précieux à partir d’une période où l’artisanat présente
encore des traits accusés de son ancrage dans des modes de production et des modes de
vie fortement ancrés dans la ruralité. Nous utiliserons donc ponctuellement ses observations,
tout en réservant ses hypothèses les plus globales pour la troisième partie de l’étude.
20 « L’artisanat dans l’espace rural », P. Bachelard, Masson, 1982.

Rapport Final – Etude sur la densité régionale des TPE–- DCASPL – GATE –ESiloe 2006 44
2.1.1 Artisanat alimentaire
Le % de croissance concerne l’évolution du nombre de TPE entre 1994 et 2002
L’artisanat alimentaire regroupe des activités dont la densité sur le territoire obéit à des
logiques distinctes. Malgré leur diminution, l’observation de Paul Bachelard reste largement
vraie : « le boucher forme avec le boulanger le noyau de base des services quotidiens », ces
activités présentant les plus faibles écarts de densité. Les charcutiers et poissonniers sont
traditionnellement inscrits dans une géographie plus étroite, les uns dans un axe qui va de la
Normandie au nord du Massif Central, les autres sur les côtés à proximité de la ressource.
Les terminaux de cuisson sont une activité nouvelle née dans le contexte particulier des
espaces les plus touristiques et très faiblement présents sur le reste du territoire.
Sur densités des TPEde l'artisanat alimentaire en 2002
Surdensités :
Boulangeries
et terminaux de cuisson
Charcuteries
Poissonneries
Boucheries
Surdensités :
Artisanat alimentaire
Boulangeries
et terminaux de cuisson
Charcuteries
Poissonneries
Boucheries
Départements classés dans le décile des plus fortes densités.
Données INSEE Sirene – DCASPL A1
Artisanat Alimentaire APEN Nb TPE
2002 % croissance
1994-2002 Cumul création
1994-2001 Cumul reprise
1994-2001
Densité TPE 2002
Ecart interdécile à la
médiane
Commerce de détail de poissons, 522E 2 554 -29,3% 1 069 953 3,3
Cuisson de produits de boulangerie 158B 4 787 294,6% 5 216 1 543 2,6
Pâtisserie 158D 5 007 -29,3% 747 1 926 1,4
Charcuterie 151F 7 876 -40,6% 1 338 2 126 1,2
Commerce de détail de viandes 522C 17 388 -19,6% 3 207 6 954 0,9
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie 158C 31 967 -6,0% 2 845 16 695 0,7
Moyenne 1,7

Rapport Final – Etude sur la densité régionale des TPE–- DCASPL – GATE –ESiloe 2006 45
Il est intéressant d’observer les dynamiques d’évolution de ces densités qui sont révélatrices
du jeu entre démographie des entreprises et territoires.
Evolution du nombre de TPE entre 1994 et 2002
Dans le 1er décile Dans le dernier décile
Boulangerie
Pâtisserie
Boucherie
Charcuterie
Poissonnerie
Terminaux
- 43
- 21
- 76
- 63
- 7
+ 20
- 8
- 24
- 11
- 37
- 26
+ 223
La boulangerie, la boucherie et la charcuterie connaissent des baisses de densité nettement
plus importantes dans les départements de plus forte densité du 1er décile. La baisse est
équivalente en pâtisserie. A l’inverse, les poissonneries se maintiennent mieux dans leurs
zones côtières de prédilection. Les terminaux de cuisson augmentent peu en densité dans
les départements qui les ont vu naître, mais leur taux de croissance est élevé là où ils
n’étaient que peu présents.
On peut en tirer quelques hypothèses généralisables : une tendance à l’homogénéisation
des densités pour des activités au départ très dispersées sur le territoire dont la baisse
affecte prioritairement les zones de plus forte densité ; une meilleure résistance des activités
« à places fortes » ; une tendance à l’essaimage de nouvelles activités en fort
développement à partir de leur territoire de naissance. La tendance dominante de ces
mouvements contradictoires confirme l’analyse du premier chapitre sur la résorption des
différentiels de densité.
Chiffre d’affaires moyen
des Boulangeries en 1967
210 et plus
190-210
160-190
130-160
moyenne 126
C
hiffre d'affaires des boulangeries
e
t pâtisseries par établissemen
t
(en milliers de F) en 1967
Source : Michel Coquery
* « Mutations et structure du commerce de détail en France, étude géographique », Michel Coquery, 1978
L’effet d’homogénéisation est confirmé
p
ar l’étude réalisée sur la base du
recensement de la distribution de 1967
p
ar Michel Coquery*. Elle montrait que,
au nord d’une ligne allant de la Haute-
N
ormandie au Jura, les chiffres d’affaires
de la boulangerie étaient sensiblement
p
lus élevés que dans le sud et ceci de
manière très homogène. On ne retrouve
p
lus cette opposition en 2002. Les
valeurs les plus importantes
n’apparaissent qu’à l’état de traces dans
l’Est et à Paris, mais se distribuent aussi
bien dans le Massif Central qu’en
Bretagne ou dans les Alpes. Les
p
olitiques professionnelles et meunières
ont déployé des modèles de plus en plus
nationaux qui tendent à calibrer les
boulangeries à la manière de la franchise.

Rapport Final – Etude sur la densité régionale des TPE–- DCASPL – GATE –ESiloe 2006 46
La monographie sur la boulangerie/pâtisserie/terminaux de cuisson21 permet d’approfondir
l’analyse. Elle invite notamment à quelques hypothèses pour mieux comprendre comment
joue le processus territorialisé de concurrence/complémentarité entre les terminaux de
cuisson et les activités de l’artisanat alimentaire traditionnel.
La surdensité des terminaux de cuisson dans les départements de la façade
méditerranéenne est nette. Elle va jusqu’à 3,21 entre terminaux de cuisson pour 10.000
habitants dans les Pyrénées Orientales. Dans l’ensemble des départements du Languedoc-
Roussillon, on compte en 2002 en moyenne un terminal de cuisson pour deux boulangeries.
Les départements de la Bretagne maritime se distinguent aussi. A l’inverse, les plus faibles
densités s’observent en Alsace, dans des départements ruraux du Centre et du Nord (les
Ardennes ont la plus faible densité avec 0,10) et à Paris. L’écart de densité s’accroît avec
des taux multipliés par 3 ou 4 dans certains départements de Languedoc-Roussillon. Mais il
faut noter aussi l’émergence de départements où les terminaux étaient presque absents en
1994 comme la Corrèze, l’Eure, l’Allier, le Jura où leur taux est multiplié par 10.
La géographie de la boulangerie artisanale présente de son côté des traits fortement
enracinés dans un passé qui sait se renouveler. Sa place forte est certes le Massif Central
où l’on se rapproche souvent d’une boulangerie pour 1.000 habitants. Dans ces
départements ruraux, elle s’est souvent diversifiée dans le multiservices, ce qui fait qu’un
département comme la Lozère, le plus dense en boulangeries, en perd très peu entre 1994
et 2002. En même temps, on constate un maillage fort de l’ensemble du territoire : à part la
Région parisienne, certains départements de l’Est et les grandes villes, on descend peu au
dessous d’une boulangerie pour 2.000 habitants.
L’autre trait à relever est le relatif déplacement des fortes densités d’emplois salariés au
bénéfice des régions frontalières de l’Est, d’Alsace-Moselle jusqu’aux Savoies. On retrouve
là l’influence du modèle germanique et suisse d’un artisanat fortement structuré proche de la
PME. L’analyse de la valeur ajoutée va naturellement dans le même sens, et fait apparaître
en plus Paris comme l’un des départements où la boulangerie présente la plus forte valeur
ajoutée par habitant (de même la boucherie).
Le très fort développement des terminaux de cuisson sur la façade méditerranéenne est
évidemment lié à l’activité touristique. Cependant, il est intéressant de noter qu’un
département très touristique comme la Vendée conserve un taux modeste de terminaux de
cuisson (0,85). Il faut sans doute rechercher une part d’explication dans une identité de
métier plus forte dans sa boulangerie artisanale, connue pour ses innovations commerciales
et industrielles22. En PACA et Languedoc-Roussillon, les taux de syndicalisation sont bas ; la
résistance au développement des terminaux de cuisson plus faible. C’est un trait assez
commun à l’ensemble des métiers artisanaux et qui peut donc expliquer plus généralement à
la fois l’instabilité du tissu des TPE (beaucoup de créations/disparitions) et l’ouverture de cet
espace aux nouvelles activités (cf. informatique).
21 CF Deuxième rapport intermédiaire
22 Voir à ce sujet l’ouvrage de S. Kaplan « le retour du bon pain », Perrin 2002, et ses développements sur « la
révolution du pain blanc ourdie dans les fournils de Vendée ».
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%