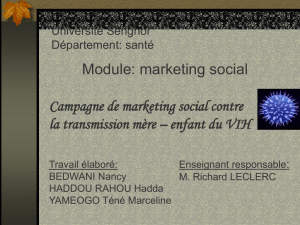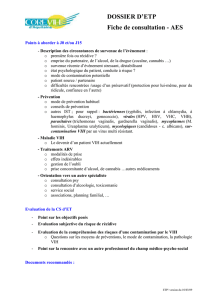ÉTABLISSEMENT DE LIENS ENTRE LES PERSONNES CHEZ QUI

LIGNES DIRECTRICES CLINIQUES TOUT AU LONG DU
CONTINUUM DE SOINS :
ÉTABLISSEMENT DE LIENS
ENTRE LES PERSONNES
CHEZ QUI UN DIAGNOSTIC
D’INFECTION À VIH A ÉTÉ
POSÉ ET LES SERVICES DE
SOINS ET DE TRAITEMENT
DE L’INFECTION À VIH
06
6.1 Introduction 86
6.2 Bonnes pratiques pour établir des liens avec les services de soins 86
6.3 Soins généraux pour les personnes vivant avec le VIH 86
6.4 Préparation des personnes vivant avec le VIH au traitement antirétroviral 89
6.5 À quoi s’attendre au cours des premiers mois sous traitement antirétroviral 90
Objectif de ce chapitre
Donner une vue d’ensemble des questions et des interventions en rapport avec les soins généraux
de l’infection à VIH pour les personnes depuis le moment où le diagnostic d’infection à VIH a été
posé jusqu’au moment où le TAR est mis en route, notamment des pratiques permettant d’établir des
liens entre les personnes chez qui un diagnostic d’infection à VIH a été posé et les services de soins
et de traitement de l’infection à VIH, des éléments composant l’ensemble de soins généraux et de la
préparation des patients pour commencer un TAR.

86 Lignes directrices unifiées sur l’utilisation des antirétroviraux pour le traitement et la prévention de l’infection à VIH
6.1 Introduction
Il est essentiel que les personnes vivant avec le VIH entrent le plus tôt possible dans la filière de soins. Cela
permet à la fois de réaliser une évaluation précoce pour déterminer si elles remplissent les critères pour
recevoir un TAR et de mettre en route rapidement un TAR, d’assurer un accès rapide aux interventions
destinées à prévenir de nouvelles transmissions du VIH, de prévenir la survenue d’autres infections et d’autres
comorbidités et de minimiser ainsi le nombre de perdus de vue. Le cadre stratégique de l’OMS de 2012
pour les programmes de conseil et de dépistage du VIH (1) souligne en particulier l’importance de veiller à
l’établissement de liens entre les programmes de conseil et de dépistage du VIH et les services de prévention,
de traitement, de soins et de soutien.
6.2 Bonnes pratiques pour établir des liens avec
les services de soins
Les interventions visant à améliorer les liens avec les services de soins doivent être évaluées de manière plus
rigoureuse. Des revues systématiques et des études d’observation suggèrent cependant que plusieurs bonnes
pratiques peuvent aider à améliorer les liens avec les services de soins (2-4). Il s’agit notamment d’intégrer
le conseil et le dépistage du VIH et les services de soins, de réaliser sur place ou immédiatement un test de
numération des CD4 en rendant le résultat le jour même, d’aider au transport si le site de TAR est éloigné du
site de conseil et de dépistage du VIH, d’impliquer les agents en charge de mener des actions communautaires
de proximité afin qu’ils identifient les personnes perdues de vue, d’assurer un soutien par les pairs ou par des
patients experts et d’utiliser les nouvelles technologies, comme l’envoi de messages SMS à l’aide d’un téléphone
portable.
6.3 Soins généraux pour les personnes vivant avec le VIH
En plus du TAR, les pays doivent définir un ensemble d’interventions de soins généraux de l’infection à VIH
destinées aux personnes vivant avec cette infection afin de réduire la transmission du VIH, de prévenir la maladie
et d’améliorer la qualité de vie de ces personnes. Toutes les personnes vivant avec le VIH ne remplissent pas les
critères pour recevoir un TAR et parmi celles qui les remplissent, toutes ne seront pas en mesure d’avoir un accès
immédiat à ce traitement. Certaines peuvent aussi choisir de reporter à plus tard la mise en route du TAR. L’entrée
dans la filière de soins permet de réaliser un suivi clinique et biologique rapproché, de faire une évaluation
précoce afin de déterminer si les critères pour recevoir un TAR sont remplis et de mettre en route un TAR en
temps opportun ; elle vise aussi à minimiser le nombre de perdus de vue. De nombreuses interventions en rapport
avec les soins sont pertinentes tout au long du continuum de soins, notamment pour les personnes exposées au
VIH ainsi que pour les personnes vivant avec le VIH avant la mise en route du TAR et au cours du TAR.
Les soins généraux comprennent la prévention de base de l’infection à VIH, la promotion de la santé des
personnes vivant avec le VIH ainsi que le dépistage, la prophylaxie et la prise en charge des co-infections et des
6. LIGNES DIRECTRICES CLINIQUES TOUT AU LONG DU
CONTINUUM DE SOINS :
ÉTABLISSEMENT DE LIENS ENTRE LES
PERSONNES CHEZ QUI UN DIAGNOSTIC
D’INFECTION À VIH A ÉTÉ POSÉ ET LES SERVICES
DE SOINS ET DE TRAITEMENT DE L’INFECTION À VIH

6 Lignes directrices cliniques tout au long du continuum de soins : établissement de liens entre les personnes
chez qui un diagnostic d’infection à VIH a été posé et les services de soins et de traitement de l’infection à VIH
87
6. Lignes directrices cliniques tout au long du continuum de soins : établissement de liens entre les personnes
chez qui un diagnostic d’infection à VIH a été posé et les services de soins et de traitement de l’infection à VIH
comorbidités liées au VIH. L’OMS a élaboré des orientations résumées sur les soins généraux et les interventions
de prévention (5-7) ; en 2008, l’OMS a recommandé un ensemble de 13 interventions de prévention pour l’adulte
et l’adolescent vivant avec le VIH en situation de ressources limitées (5). Ces interventions sont les suivantes :
1) conseil et soutien psychosociaux ; 2) partage du résultat avec un tiers et notification au partenaire ;
3) traitement préventif par le cotrimoxazole ; 4) conseil, dépistage et traitement préventif de la tuberculose ;
5) prévention des infections fongiques courantes ; 6) prévention des IST et soutien pour répondre aux
besoins en matière de santé génésique, y compris la prévention et le dépistage du cancer du col de l’utérus
; 7) prévention du paludisme (cotrimoxazole, moustiquaires et prévention du paludisme chez la femme
enceinte) ; 8) prévention de certaines maladies évitables par la vaccination ; 9) nutrition ; 10) planification
familiale ; 11) PTME ; 12) programmes d’échange d’aiguilles et de seringues pour les consommateurs de
drogue par injection ; et 13) accès à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène.
L’ensemble de soins généraux variera en fonction du type d’épidémie, des populations touchées et de la
prévalence des co-infections, des autres comorbidités et des pathologies. Un récapitulatif des éléments faisant
partie de l’ensemble de soins généraux pour les personnes vivant avec le VIH se trouve dans le Tableau 6.1. Un
récapitulatif des principales recommandations tirées des lignes directrices existantes de l’OMS sur le dépistage,
la prophylaxie et le calendrier du TAR en rapport avec les co-infections, les comorbidités et les autres pathologies
les plus courantes se trouve dans le sous-chapitre 8.1.
Tableau 6.1 Récapitulatif des principaux éléments des soins généraux tout au long
du continuum de soins de l’infection à VIH pour les personnes vivant avec le VIH
Service Au moment du
diagnostic de
l’infection à VIH
Au moment
de l’entrée
dans la filière
de soins
Au moment
de la mise
en route du
TAR
Quand le
patient est
stable sous
TAR
Au moment
d’un échec
thérapeutique et
du changement
de schéma d’ARV
Commentaire et
renvois dans le
document
Soins généraux
Détermination du
stade clinique de l’OMS
Pathologies anciennes
et actuelles liées à
l’infection à VIH
✓ ✓ ✓ Annexe 1
Évaluation du statut
par rapport à la
grossesse
Planification familiale
et contraception
PTME
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Sous-chapitre
8.2.6.1
Sous-chapitres
7.1.2 et 7.2.2
Aide au partage du
résultat avec un tiers
et à la notification au
partenaire
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Sous-chapitre
5.1.4
Conseil pour la
réduction des risques
et combinaison
des approches
de prévention de
l’infection à VIH
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Sous-chapitre
5.2.4
Dépistage, prévention
et prise en charge
des comorbidités et
des maladies non
transmissibles
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Sous-chapitre
8.2.1

88 Lignes directrices unifiées sur l’utilisation des antirétroviraux pour le traitement et la prévention de l’infection à VIH
Service Au moment du
diagnostic de
l’infection à VIH
Au moment
de l’entrée
dans la filière
de soins
Au moment
de la mise
en route du
TAR
Quand le
patient est
stable sous
TAR
Au moment
d’un échec
thérapeutique et
du changement
de schéma d’ARV
Commentaire et
renvois dans le
document
Soins généraux
Dépistage et prise en
charge des problèmes
de santé mentale et de
l’usage de substances
psychoactives
Conseil et soutien
psychosociaux
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Sous-chapitres
8.2.2 et 8.2.3
Prise en charge
symptomatique et
prise en charge de la
douleur
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Sous-chapitre
8.2.5
Évaluation et conseil
nutritionnels
✓ ✓ ✓ ✓ Sous-chapitre
8.2.4
Évaluation nutritionnelle,
de la croissance et du
développement de
l’enfant et de l’adolescent
Évaluation de
l’alimentation du
nourrisson et de l’enfant
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Sous-chapitres
7.1.3 et 8.2.4
Prévention et traitement des co-infections
Traitement préventif
par le cotrimoxazole
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Sous-chapitre
8.1.1
Dépistage intensifié de
la tuberculose
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Sous-chapitre
8.1.2
Traitement préventif
par l’isoniazide
✓ ✓ ✓ ✓ Sous-chapitre
8.1.2
Dépistage de la
cryptococcose et
prophylaxie des
infections fongiques
✓ ✓ Sous-chapitre
8.1.3
Dépistage de l’hépatite
B et de l’hépatite C
✓ ✓ ✓ Sous-chapitre
8.1.4
Prévention
du paludisme
(moustiquaires
imprégnées
d’insecticide et
prophylaxie)
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Sous-chapitre
8.1.5
Dépistage des
infections sexuellement
transmissibles
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Sous-chapitre
8.1.6
Tableau 6.1 (suite)

6 Lignes directrices cliniques tout au long du continuum de soins : établissement de liens entre les personnes
chez qui un diagnostic d’infection à VIH a été posé et les services de soins et de traitement de l’infection à VIH
89
6. Lignes directrices cliniques tout au long du continuum de soins : établissement de liens entre les personnes
chez qui un diagnostic d’infection à VIH a été posé et les services de soins et de traitement de l’infection à VIH
6.4 Préparation des personnes vivant avec le VIH au
traitement antirétroviral
Avant qu’une personne commence un TAR, il est important d’avoir une discussion approfondie avec elle. Cette discussion
cherchera à évaluer si elle souhaite la mise en route de ce traitement et si elle est prête pour cela ; elle sera aussi l’occasion
de lui présenter le schéma thérapeutique d’ARV, sa posologie et son calendrier, ses avantages probables et ses effets
indésirables possibles ainsi que le suivi et les visites de suivi nécessaires. Dans le cas d’un enfant vivant avec le VIH, cette
discussion doit directement impliquer la personne qui s’occupe de lui et inclure une discussion sur le partage du statut de
l’enfant par rapport au VIH (chapitre 5). Il fait partie des bonnes pratiques de refaire un test VIH avant la mise en route d’un
TAR pour s’assurer qu’une personne chez qui un diagnostic d’infection à VIH a été posé est bien infectée par le VIH. Lors de
la mise en route d’un TAR, il faut toujours tenir compte de l’état nutritionnel, des comorbidités et des possibles interactions
médicamenteuses pouvant être à l’origine de contre-indications ou impliquer des ajustements de dose.
Au bout du compte, le choix d’accepter ou de refuser le TAR appartient au patient ou à la personne qui s’occupe de lui ;
s’il choisit de reporter la mise en route du TAR, celui-ci peut être proposé à nouveau lors de visites ultérieures. En cas
de problèmes de santé mentale, d’usage de substances psychoactives ou d’autres problèmes pouvant faire obstacle à
l’observance, un soutien approprié doit être fourni et une évaluation doit être répétée régulièrement afin de déterminer si
la personne est prête pour une mise en route du TAR. Un large éventail de documents destinés à l’information des patients
ainsi qu’au soutien par la communauté et par les pairs peuvent aider les personnes à se préparer au TAR et à prendre une
décision quant à sa mise en route.
Les patients qui commencent le schéma d’ARV et les personnes qui s’occupent d’eux doivent comprendre que le premier
schéma de TAR est celui qui offre les meilleures chances d’obtenir une suppression de la charge virale et une reconstitution
immunitaire efficaces et que, pour réussir, le TAR doit être pris en suivant rigoureusement la prescription. Ils doivent être
informés que de nombreux effets indésirables sont temporaires ou peuvent être traités, et qu’il est souvent possible de
substituer les ARV qui posent problème. Il faut également demander régulièrement aux patients qui reçoivent un TAR
ou aux personnes qui s’occupent d’eux si d’autres médicaments sont pris, notamment des plantes médicinales et des
suppléments nutritionnels.
Les personnes qui reçoivent un TAR doivent comprendre que même si les ARV réduisent le risque de transmission du
VIH, ils ne sont pas suffisants pour empêcher la contamination d’autres personnes. Afin de prévenir la transmission du
VIH à d’autres, elles doivent recevoir un conseil sur les pratiques sexuelles à moindre risque (notamment l’utilisation du
préservatif) et éviter les autres actions associées à un risque, comme le partage du matériel d’injection.
Service Au moment du
diagnostic de
l’infection à VIH
Au moment
de l’entrée
dans la filière
de soins
Au moment
de la mise
en route du
TAR
Quand le
patient est
stable sous
TAR
Au moment
d’un échec
thérapeutique et
du changement
de schéma d’ARV
Commentaire et
renvois dans le
document
Prévention et
dépistage du cancer du
col de l’utérus
✓ ✓ ✓ ✓ Sous-chapitre
8.1.7
Évaluation pour
rechercher des
maladies évitables par
la vaccination
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Sous-chapitre
8.1.7
Préparation des
personnes au TAR
✓ ✓ Sous-chapitre
6.4
Préparation,
évaluation et soutien
de l’observance du
traitement
✓ ✓ ✓ Sous-chapitres
6.4 et 9.2
Notification des
médicaments en cours
✓ ✓ ✓ ✓ Sous-chapitre
7.4.6
Tableau 6.1 (suite)
 6
6
1
/
6
100%