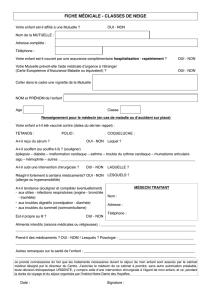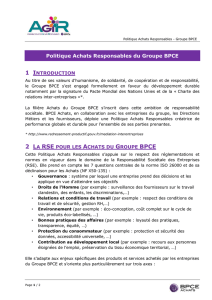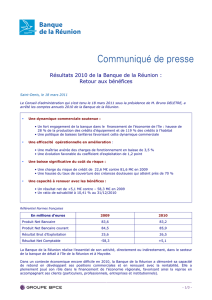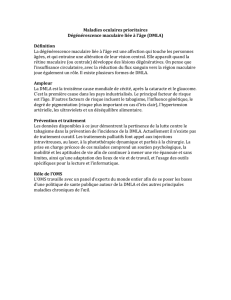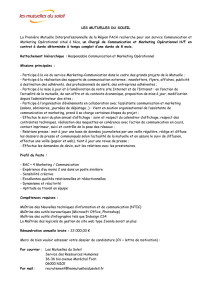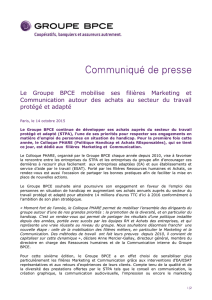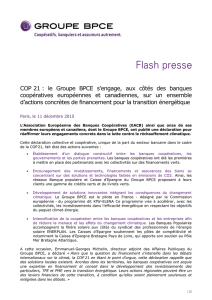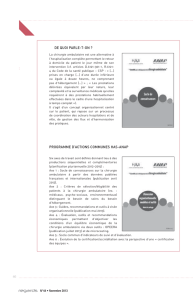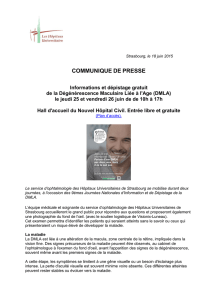INFARCTUS DU MYOCARDE : - Ensemble Protection Sociale

INFARCTUS
DU MYOCARDE :
LES FEMMES AUSSI
pages 20 et 21
N° 221/877 - OCTOBRE 2015
PARLONS-EN
Etienne Arets :
L’hémochromatose
Pages 4 et 5
PRÉVENTION
Attention
au moustique tigre
Pages 12 et 13
Pages 22 et 23
Médecine
La dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA),
est d’ores et déjà devenue la première cause
de handicap visuel chez les plus de 50 ans.
PROTECTION PRÉVENTION SANTÉ

4-5 [RESEAU] Parlons-en
Il y a déjà… quelques années, Etienne Arets
(CE CAZ) avait évoqué dans La Revue l’hémochro-
matose dont il était atteint. Il revient aujourd’hui sur
les évolutions dans le dépistage et la prise en charge
de cette maladie génétique.
6-7 [RESEAU] Votre mutuelle
> Partenariat avec le réseau de soins Santéclair
> Perte d’autonomie/dépendance : l’offre Edéo
de Mutex
> Droits mutuelle santé des enfants : rappel de
ce qu’il faut savoir.
8 [RESEAU] Groupe BPCE Sports
Quelques résultats d’avant l’été, et le challenge
tennis de table qui a eu lieu mi-septembre. L’an
prochain, l’association sportive organise ses troi-
sièmes Olympiades !
9-11 [NOTRE SANTE] Système de soins
> Ce qu’il faut savoir, en bref, sur le fonctionne-
ment du système de soins en France.
> Le dossier pharmaceutique, outil de prévention
du risque d’interaction médicamenteuse.
> Confronté à un refus de soins, que peut faire un
médecin ?
12-13 [NOTRE SANTE] Prévention
Le moustique tigre, vecteur des virus du chikungu-
nya et de la dengue chez l’homme, s’installe en
France. Comment s’en protéger ?
14-15 [NOTRE SANTE] En bref
Quelques « brèves » sur des sujets qui touchent la
santé, pour se tenir au courant dans un domaine qui
évolue sans cesse.
16-24 [NOTRE SANTE] Médecine
> La pratique de la médecine ambulatoire pro-
gresse en France.
> L’herpès labial, ou bouton de fièvre, ne se guérit
pas. Heureusement, des traitements limitent les
récidives, leur durée et leur agressivité.
> L’infarctus du myocarde concerne également les
femmes, pour lesquelles il est généralement plus
grave et plus mortel.
> La dégénérescence maculaire liée à l’âge
(DMLA), est d’ores et déjà devenue la première
cause de handicap visuel chez les plus de 50 ans.
> Environ six millions de Français souffrent d’un
dysfonctionnement de cette petite glande qui ne
pèse que 10 grammes mais régule tout notre orga-
nisme : la thyroïde.
LA REVUE
7 rue Léon Patoux
CS 51032
51686 Reims cedex 2
Tél. 03 26 77 66 00
Fax 03 26 85 04 31
ÉDITÉE PAR :
BPCE Mutuelle
7 rue Léon Patoux
CS 51032
51686 Reims cedex 2
Tél. 03 26 77 66 00
Fax 03 26 85 04 31
Internet : www.bpcemutuelle.fr
DIRECTEUR
DE LA PUBLICATION :
Hervé TILLARD
DIRECTEUR
DE LA RÉDACTION :
Eric LE LAY
SECRÉTAIRE
DE RÉDACTION :
Jacques RIVIÈRE
PHOTOGRAPHIES :
BSIP ; FNMF (NATHANAËL
MERGUI /GÉRARD
MONICO) ; MEDIA FOR
MEDICAL ; CIEM
(THINKSTOCK /
SHUTTERSTOCK).
ILLUSTRATION :
Christine LESUEUR
ONT COLLABORÉ
À CE NUMÉRO :
Michel COLADON,
Isabelle COSTON,
Delphine DELARUE,
NUTRINEWS,
Vanessa PAGEOT-FRANCOISE,
Aliisa WALTARI.
COMITÉ
DE RÉDACTION :
Hervé TILLARD,
Gérard HOCQUART,
Eric LE LAY,
Véronique ROCHETTE,
Jacques RIVIÈRE.
PUBLICITÉ :
nous contacter
PETITES ANNONCES :
à adresser
7, rue Léon Patoux
CS 51032
51686 Reims cedex 2.
Tél. : 03 26 77 66 46
TIRAGE BIMESTRIEL :
63 000 exemplaires
CONCEPTION
ET RÉALISATION :
IPPAC - Tél. : 03 25 87 08 34
IMPRESSION :
SIB IMPRIMERIE
pour le compte
des Editions de l'Epargne,
ZI de la Liane, BP 343,
62205 Boulogne-sur-Mer
Tél. : 03 21 87 88 89
COMMISSION
PARITAIRE
N° 1118 M 06701
ISSN : 0751-1809
ABONNEMENT : 6 €
Prix au numéro : 1,20 €
DÉPÔT LÉGAL : 2319.
sommaire
[ ]
LA REVUE | N° 221/877 | OCTOBRE 2015
INFARCTUS
DU MYOCARDE :
LES FEMMES AUSSI
pages 20 et 21
N° 221/877 - OCTOBRE 2015
PARLONS-EN
Etienne Arets :
L’hémochromatose
Pages 4 et 5
PRÉVENTION
Attention
au moustique tigre
Pages 12 et 13
Pages 22 et 23
Médecine
La dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA),
est d’ores et déjà devenue la première cause
de handicap visuel chez les plus de 50 ans.
PROTECTION PRÉVENTION SANTÉ
12-13
16-17
4-5
| N° 221/877 | OCTOBRE 2015
2
20-21
25

Amélioration
des prestations :
une réalité
au 1er janvier 2016
Depuis le printemps et le lancement de l'offre dépendance, le Conseil
d'administration a beaucoup œuvré pour « mettre en musique » plusieurs
dossiers attendus et les rendre opérationnels dès le 1er janvier prochain.
Nous avons tout d'abord voulu faire baisser les restes à charge
des adhérents pour leurs dépenses à partir de l'année prochaine,
donc améliorer votre budget, notamment en matière d'optique,
de soins dentaires (y compris les implants) et audioprothèse en adhérant
à Santéclair. Ce réseau de soins est en effet à même de vous proposer
des professionnels de santé partenaires près de chez vous (plus de 3 000
opticiens répartis sur toute la France par exemple) garantissant la qualité
des soins et des tarifs très inférieurs au marché (lire l’article en page 6).
C'est une première bonne nouvelle…
Ensuite, dans le cadre d'une réflexion globale sur la mise en conformité
réglementaire et d’évolution des garanties en santé pour les contrats
complémentaires des salariés, les administrateurs de BPCE Mutuelle
ont « planché » pendant plusieurs mois sur des évolutions de prestations
au 1er janvier prochain afin de proposer une nouvelle grille de garanties en
santé avec de nouvelles prestations et des prestations existantes améliorées.
En 2016, l'ensemble de nos adhérents à un contrat complémentaire
d'entreprise (hors CFF) seront donc mieux couvert notamment
en « dentaire, hospitalisation, pharmacie à 15 %, médecine douce, chirurgie
optique ou encore audioprothèse ». C'est tout simplement la plus forte
amélioration de prestation que ce contrat ait connu depuis… 1995 !
Une deuxième bonne nouvelle…
Nous y consacrerons un dossier spécial dans notre numéro de décembre.
Et pour que les adhérents au contrat ASV « his torique », souscrit
massivement par les retraités, ne soient pas en reste, BPCE Mutuelle
améliore aussi les prestations de ce contrat dans les mêmes conditions,
tout en le rendant compatible avec la réglementation sur les contrats
« responsables », histoire de ne pas être pénalisé par un doublement
de la taxe sur les contrats d'assurance…
Une troisième bonne nouvelle…
[ ]
édito
Hervé TILLARD
Président du conseil d’administration de BPCE Mutuelle
25 [SOCIETE] Pratique
Droit à l’oubli : les personnes guéries d’un cancer
pourront désormais emprunter comme n’importe
quel citoyen en France.
26-27 [SOCIETE] Alimentation
> Les femmes et les hommes ne consomment pas
de la même manière. Une lente progression vers
« l’égalité » se dessine cependant…
> Le « Memento Alimentation 2015 » du ministère de
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt
constitue un aperçu chiffré de notre consomma-
tion annuelle d’aliments, de boissons, et de ce qu’il
nous en coûte…
28-29 [RESEAU] Loisirs
> Mots fléchés, lettrix, sudoku : c’est à vous de jouer !
> Les vacances dans nos résidences c’est avec Cent-
pourcentvacances (www.centpourcentvacances.fr).
30-31 [RESEAU] Petites annonces
| N° 221/877 | OCTOBRE 2015 3
25
27

Dans le n° 151 de La Revue (juin 2003), Etienne Arets avait eu l'occasion d'expliquer
comment on avait diagnostiqué chez lui l'hémochromatose, et comment il était soigné.
Quelques années plus tard, il va bien, merci, et fait le point sur tout ce qui entoure cette maladie.
Hémochromatose :
retour sur un cas vécu
L'
hémochromatose, en quelques mots, c'est un
excès de fer dans l'organisme.
Il en résulte une augmentation de l'absorption
intestinale du fer : chez les personnes touchées par la
maladie, la quantité de fer absorbée est environ cinq
fois supérieure à la normale. Ce fer est dans un premier
temps transporté dans le sang. Lorsqu'il y est présent
en trop grande quantité, il va progressivement s'accu-
muler dans tous les organes (cœur, foie, articulations),
entraînant des dégénérescences graves.
L'hémochromatose est une maladie paradoxale :
- elle touche 1 personne sur 300, mais peu de malades
(200 000 en France) le savent ;
- le diagnostic est assez simple, mais peu de médecins
y pensent ;
- elle se confirme par une analyse génétique, mais se
soigne comme au XVIIe siècle par des saignées ;
- diagnostiquée très tôt elle reste bénigne, mais non
corrigée elle tue (2 000 personnes par an).
Avec de la chance et une détection pas trop tardive, on
s'en sort avec des douleurs articulaires (poignée de main
douloureuse, inflammation des gros orteils, fatigue
régulière), mais rien qui rende la vie insupportable. Dans
les cas moins chanceux on supporte mal les saignées, la
fatigue est chronique, physique et psychique, les articu-
lations si douloureuses qu'elles deviennent un handicap
et la cirrhose s’installe sans boire… Double peine !
n QUELLES NOUVEAUTÉS
SUR LA MALADIE ?
On sait maintenant que près de 90 % des cas d'hémo-
chromatose sont liés à une mutation particulière
(C282Y) affectant le gène HFE. Cette mutation provoque
un déficit dans la production d'une protéine impliquée
dans le contrôle du métabolisme du fer, l’hepcidine,
sécrétée par le foie et dont le rôle est de réguler l'ab-
sorption du fer par le corps. Lorsqu'elle n'est plus
sécrétée, le fer va se déposer dans tous les organes et
en détruire petit à petit les membranes et les noyaux
par oxydation.
Depuis la découverte de la maladie au début du
XXème siècle, et malgré la découverte de l'origine géné-
tique en 1976 ou du gène responsable en 1996, le
remède reste la suppression de cet excès de fer par des
« saignées » régulières de 400 à 500 ml de façon plus
ou moins fréquente, toutes les semaines dans le trai-
tement d'attaque qui peut durer d'un mois à un an, et
plus espacées ensuite (tous les 3 mois).
Ce traitement ne permet pas de guérir définitivement
la maladie mais de contrôler la quantité de fer dans
l'organisme. Cependant, si les saignées sont très efficaces,
elles restent toutefois contraignantes et désagréables.
La seule autre médication passe par des chélateurs du
fer qui captent directement le fer en surcharge pour
l'éliminer par les urines. Ce type de traitement reste
exceptionnel et indiqué pour les rares cas où les saignées
sont impossibles en raison du mauvais état veineux.
L’autre voie en cours d‘investigation est le traitement
de la cause.
Une thérapie basée sur la complémentation en hepcidine
ou sur un produit qui en augmenterait la fabrication
pourrait constituer, à l'avenir, un nouvel espoir pour le
traitement de l'hémochromatose.
En effet, un tel traitement serait susceptible non seu-
lement de corriger l’hyperabsorption intestinale du fer,
cause de la maladie, mais aussi d’induire une redistri-
bution du fer déjà accumulé, et donc d’en réduire la
toxicité.
n
D’AUTRES RECHERCHES SONT EN COURS
En effet, si les saignées soulagent la majorité des com-
plications, les douleurs ostéo-articulaires peuvent
| n° 221/877 | octobre 2015
4
EtiEnnE ArEts (caisse d'epargne côte d'azur)
RÉSEAU Parlons-en
Pour EtiEnnE ArEts,
lE Progrès dAns
lA PrisE En chArgE Et
lE trAitEmEnt dE
l’hémochromAtosE
nE PEut vEnir,
Pour l’instAnt,
quE d’un déPistAgE
systémAtiquE
PrécocE chEz
l’AdultE.

| n° 221/877 | octobre 2015 5
persister alors que l’excès de fer a été retiré. Cette
énigme pousse les chercheurs à enquêter sur les méca-
nismes qui induisent les lésions articulaires.
D’autre part, il apparaît que pour un même défaut
génétique, certains patients sont très affectés par la
maladie et d’autres beaucoup moins. « Ces inégalités
laissent suspecter l’existence de facteurs, internes et
externes, susceptibles de moduler la maladie. » Des
recherches sur l’influence de facteurs externes, comme
la consommation d’alcool, sont également conduites.
Enfin, l’existence d’anomalies des métabolismes gluci-
diques et lipidiques, qui moduleraient le métabolisme
du fer et aggraveraient les lésions (notamment au
niveau hépatique), est une autre piste étudiée.
Dans l'hémochromatose, il n'y a pas d'autre option
thérapeutique, aucun régime alimentaire ne permet, à
lui seul, d'éviter ou de limiter le nombre de saignées.
Il est cependant recommandé d'éviter l'excès de boissons
alcoolisées, ainsi que la vitamine C en complément
alimentaire. D'autre part, la consommation de fruits
de mer crus, en particulier les huîtres qui peuvent
contenir une bactérie appelée « Vibrio vulnificus » qui
peut être mortelle pour les personnes ayant une hémo-
chromatose, est à éviter ! Faites bien cuire tous vos
fruits de mer. A contrario, il est recommandé de boire
du thé au moment des repas.
n
POURQUOI NE PAS FAIRE
UN DÉPISTAGE SYSTÉMATIQUE ?
L'hémochromatose répond aux critères d'un dépistage
systématique de grande envergure : maladie fréquente
dans la population, qui peut être dépistée par un test
fiable et sûr permettant une prise en charge qui évite
des complications graves, de lourdes dépenses médi-
cales, et améliore la survie.
La Haute Autorité de Santé a étudié, en 1999 et en
2004, la faisabilité et le bénéfice en termes de santé
publique d'un dépistage génétique à la naissance. Cette
piste n'a pas été retenue du fait de son coût, et comme
la maladie ne se manifeste qu'à l'âge adulte, le délai
entre le diagnostic et la prise en charge risque d'entraî-
ner une perte d'efficacité.
Seul le dépistage familial est accepté par la Sécurité
sociale. S’il est plus pertinent, puisque partant d'un
sujet atteint, il est plus compliqué à mettre en œuvre
car il repose sur le volontariat. Seul le patient peut
prévenir sa famille, son médecin ne le peut pas. Le
malade peut hésiter à « avouer » sa maladie génétique,
même si un décret de juin 2013 lui en fait obligation,
et les autres membres de la famille peuvent hésiter ou
tarder à faire les examens.
Il faut œuvrer pour que soit mis en place le dépistage
systématique chez l'adulte. La meilleure attitude semble
être d'introduire le bilan martial, le dosage du coefficient
de saturation dans les bilans de santé, et de proposer
le test génétique en cas d'augmentation confirmée.
N'en doutons pas, le seul progrès dans l'avenir ne peut
venir que d'un dépistage précoce.
n
VERS DES « DONS SAIGNÉES » ?
La saignée thérapeutique étant le traitement de base
de l'hémochromatose, le potentiel que représente l'uti-
lisation du sang des malades à des fins transfusionnelles
est une question d'intérêt majeur pour pallier le manque
de sang. Durant des années, il y a eu débat sur les
conditions d'éligibilité au don du sang des malades
hémochromatosiques et sur l'aspect éthique du don
saignée. Deux questions se posaient : le sang des
malades est-il sans danger pour les receveurs ? Le don
de sang peut-il être considéré comme volontaire chez
ces patients ?
Une réponse a été apportée en France, avec l'arrêté du
12 janvier 2009 fixant les critères de sélection des
donneurs de sang : les patients porteurs d'une hémo-
chromatose génétique ne sont plus contre-indiqués au
don du sang. Le Canada avait pris cette décision il y a
plus de 10 ans…
Les saignées peuvent alors être transformées en « don
saignée », le patient étant alors orienté vers un site de
l'Etablissement Français du Sang (EFS) comprenant un
centre de santé et un site de collecte. L'ouverture des
centres de santé de l'EFS aux patients devait se faire
au fur et à mesure d'affranchissement des contraintes
réglementaires liées à la mise en place de cette nouvelle
organisation (qualification du personnel, agrément des
locaux…). Quel dommage que cela n'aille pas plus vite
- le « don saignée » n'est pas encore possible dans les
Alpes-Maritimes, par exemple - car, chaque année, ce
sont au minimum 4 dons du sang par malade qui sont
perdus. Si on multiplie par le nombre de malades et
que l'on rapproche cela des appels aux dons fait durant
toute l'année, ne serait-ce qu’en PACA, on peut se poser
bien des questions sur le fonctionnement de notre
système de santé !
En attendant que l’institution rationalise ses actions,
chacun d’entre nous peut sauver des vies en parlant de
cette maladie autour de soi.
Et que tous ceux qui ont des contacts politiques n'hé-
sitent pas à plaider en faveur du dépistage et de l'accrois-
sement des possibilités des « dons saignée ».
CONTACTS :
Association Hémochromatose France
BP 7777,
30 912 Nîmes cedex
Tél. : 04 66 64 52 22 ou 09 75 49 14 52
E-mail : [email protected]
Site internet : http://hemochromatose.fr
Etienne Arets
Tél. : 04 93 18 41 32
E-mail : [email protected]gne.fr
][
Dans ses formes avancées, l'hémochromatose fait partie
des 30 affections longue durée (ALD 30) qui donnent
lieu à une prise en charge à 100 % par la Sécurité sociale.
Dans les formes graves, les malades ont la possibilité
d'obtenir une allocation d'adulte handicapé en déposant
un dossier auprès de la Maison Départementale du
Handicap. Dans les formes plus modérées, on a juste
droit à la RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Tra-
vailleur Handicapé) ce qui aide l'employeur à atteindre
ses quotas, et permet au malade d'obtenir les aménage-
ments de poste nécessaires à sa pathologie.
UnE AffEction longUE dUréE
Depuis la
découverte de
la maladie
au début du
XXème siècle,
et malgré
la découverte
de l'origine
génétique
en 1976 ou
du gène
responsable en
1996, le remède
reste la
suppression
de cet excès
de fer par des
« saignées »
régulières...
❝
❝
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
1
/
32
100%